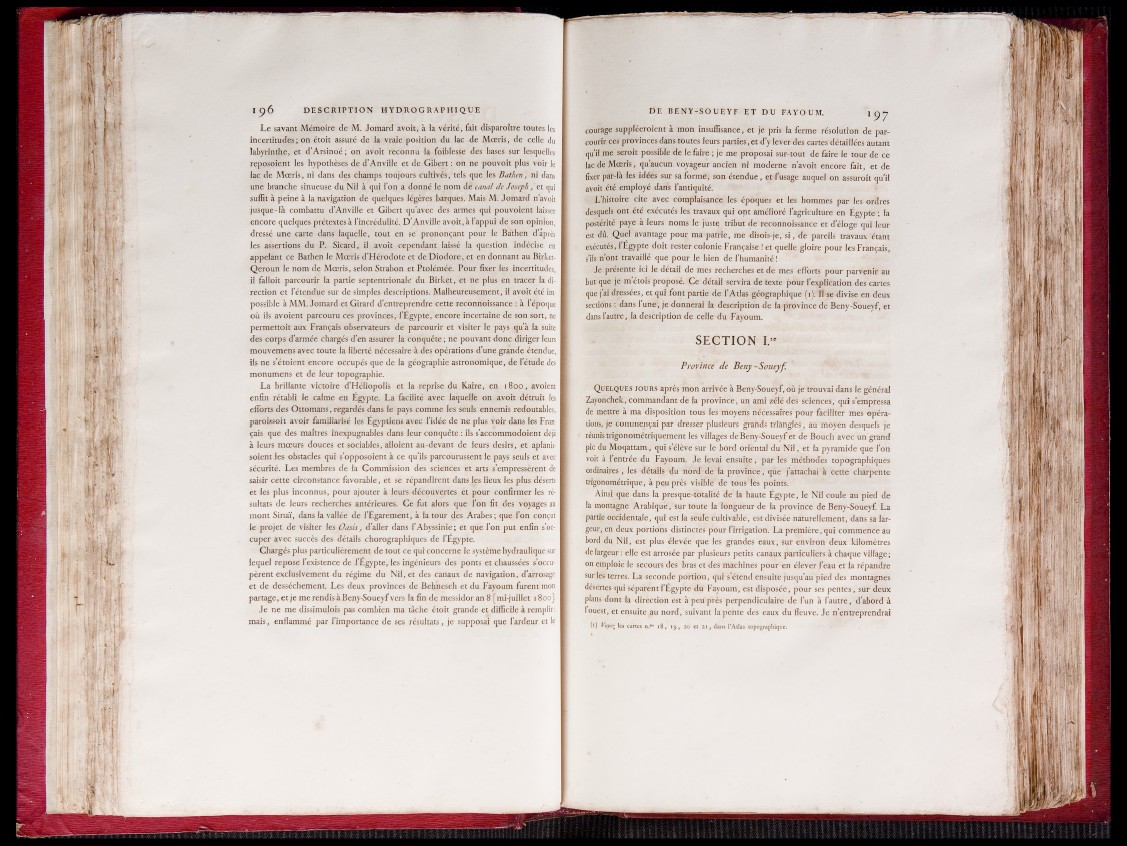
Le savant Mémoire de M. Jomard avoit, à la vérité, fait disparoître toutes les
incertitudes ; on étoit assuré de la vraie position du lac de Mceris, de celle du
labyrinthe, et d’Arsinoé ; on avoit reconnu la foiblesse des bases sur lesquelles
reposoient les hypothèses de d’Anville et de Gibert : on ne pouvoir plus voir le
lac de Mceris, ni dans des champs toujours cultivés, tels que les Bathen, ni dans
une branche sinueuse du Nil à qui l’on a donné le nom de canal de J o sep h et qui
suffit à peine à la navigation de quelques légères barques. Mais M. Jomard n’avoit
jusque-là combattu d’Anville et Gibert qu’avec des armes qui pouvoient laisser
encore quelques prétextes à l’incrédulité. D ’Anville avoit, à l’appui de son opinion,
dressé une carte dans laquelle, tout en se prononçant pour le Bathen d’après
les assertions du P. Sicard, il avoit cependant laissé la question indécise en
appelant ce Bathen le Mceris d’Hérodote et de Diodore, et en donnant au Birket-
Qeroun le nom de Mceris, selon Strabon et Ptolémée. Pour fixer les incertitudes,
il falloit parcourir la partie septentrionale du Birket, et ne plus en tracer la direction
et l’étendue sur de simples descriptions. Malheureusement, il avoit été im
possible à MM. Jomard et Girard d’entreprendre cette reconnoissance : à l’époque
où ils avoient parcouru ces provinces, l'Egypte, encore incertaine de son sort, ne
permettoit aux Français observateurs de parcourir et visiter le pays qu’à la suite
des corps d’armée chargés d’en assurer la conquête ; ne pouvant donc diriger leurs
mouvemens avec toute la liberté nécessaire à des opérations d’une grande étendue,
ils ne s’étoient encore occupés que de la géographie astronomique, de l’étude des
monumens et de leur topographie.
La brillante victoire d’Héliopolis et la reprise du Faire, en 1800, avoient
enfin rétabli le calme en Egypte. La facilité avec laquelle on avoit détruit les
efforts des Ottomans, regardés dans le pays comme les seuls ennemis redoutables,
paroissoit avoir familiarisé les Égyptiens avec l’idée de ne plus voir dans les Français
que des maîtres inexpugnables dans leur conquête : ils s’accommodoient déjà
à leurs moeurs douces et sociables, alloient au-devant de leurs désirs, et aplanis-
soient les obstacles qui s’opposoient à ce qu’ils parcourussent le pays seuls et avec
sécurité. Les membres de la Commission des sciences et arts s’empressèrent de
saisir cette circonstance favorable, et se répandirent dans les lieux les plus déserts
et les plus inconnus, pour ajouter à leurs découvertes et pour confirmer les résultats
de leurs recherches antérieures. Ce fut alors que l’on fit des voyages an
mont Sinaï, dans la vallée de l’Egarement, à la tour des Arabes ; que l’on conçut
le projet de visiter les Oasis, d’aller dans l’Abyssinie ; et que l’on put enfin s’occuper
avec succès des détails chorographiques de l’Egypte.
Chargés plus particulièrement de tout ce qui concerne le système hydraulique sur
lequel repose l’existence de l’Egypte, les ingénieurs des ponts et chaussées s’occupèrent
exclusivement du régime du Nil, et des canaux de navigation, d’arrosage
et de dessèchement. Les deux provinces de Bebneseh et du Fayoum furent mon
partage, et je me rendis à Beny-Soueyf vers la fin de messidor an 8 [mi-juillet 1800].
Je ne me dissimulois pas combien ma tâche étoit grande et difficile à remplir:
mais, enflammé par l’importance de ses résultats, je supposai que l’ardeur et le
courage suppleeroient a mon insuffisance, et je pris la ferme résolution de parcourir
ces provinces dans toutes leurs parties, et d’y lever des canes détaillées autant
qu’il me seroit possible de le faire ; je me proposai sur-tout de faire le tour de ce
lac de Mceris, qu’aucun voyageur ancien ni moderne n’avoit encore fait, et de
fixer par-là les idées sur sa forme, son étendue, et l’usage auquel on assuroit qu’il
avoit été employé dans l’antiquité.
L’htétoire cite avec complaisance les époques et les hommes par les ordres
desquels ont été exécutés les travaux qui ont amélioré l’agriculture en Egypte ; la
postérité paye à leurs noms le juste tribut de reconnoissance et d’éloge qui leur
est dû. Quel avantage pour ma patrie, me disois-je, s i , de pareils travaux étant
exécutés, l’Egypte doit rester colonie Française ! et quelle gloire pour les Français,
s’ils n’ont travaillé que pour le bien de l’humanité !
Je présente ici le détail de mes recherches et de mes efforts pour parvenir au
but que je m’étois proposé. Ce détail servira de texte pour l’explication des cartes
que j’ai dressées, et qui font partie de l’Atlas géographique (1). 11 se divise en deux
sections : dans 1 une, je donnerai la description de la province de Beny-Soueyf, et
dans l’autre, la description de celle du Fayoum.
SECTION Ve
Province de Beny-Soueyf.
Q u elq ues jo u r s après mon arrivée à Beny-Soueyf, où je trouvai dans le général
Zayonchek, commandant de la province, un ami zélé des sciences, qui s’empressa
de mettre à ma disposition tous les moyens nécessaires pour faciliter mes opérations,
je commençai par dresser plusieurs grands triangles, au moyen desquels je
réunis trigonométriquement les villages de Beny-Soueyf et de Bouch avec un grand
pic du Moqattam, qui s’élève sur le bord oriental du N il, et la pyramide que l’on
voit à l’entrée du Fayoum. Je levai ensuite, par les méthodes topographiques
ordinaires, les détails du nord de la province, que j’attachai à cette charpente
trigonométrique, à peu près visible de tous les points.
Ainsi que dans la presque-totalité de la haute Egypte, le Nil coule au pied de
la montagne Arabique, sur toute la longueur de la province de Beny-Soueyf. La
partie occidentale, qui est la seule cultivable, est divisée naturellement, dans sa largeur,
en deux portions distinctes pour l’irrigation. La première, qui commence au
bord du Nil, est plus élevée que les grandes eaux, sur environ deux kilomètres
de largeur : elle est arrosée par plusieurs petits canaux particuliers à chaque village;
on emploie le secours des bras et des machines pour en élever l’eau et la répandre
sur les terres. La seconde portion, qui s’étend ensuite jusqu’au pied des montagnes
désertes qui séparent l’Egypte du Fayoum, est disposée, pour ses pentes, sur deux
plans dont la direction est à peu près perpendiculaire de l’un à l’autre, d’abord à
I ouest, et ensuite au nord, suivant la pente des eaux du fleuve. Je n’entreprendrai
(1) Voyiez les cartes n.°‘ 18, 19 , 20 et 2 1 , dans (’Atlas topographique.