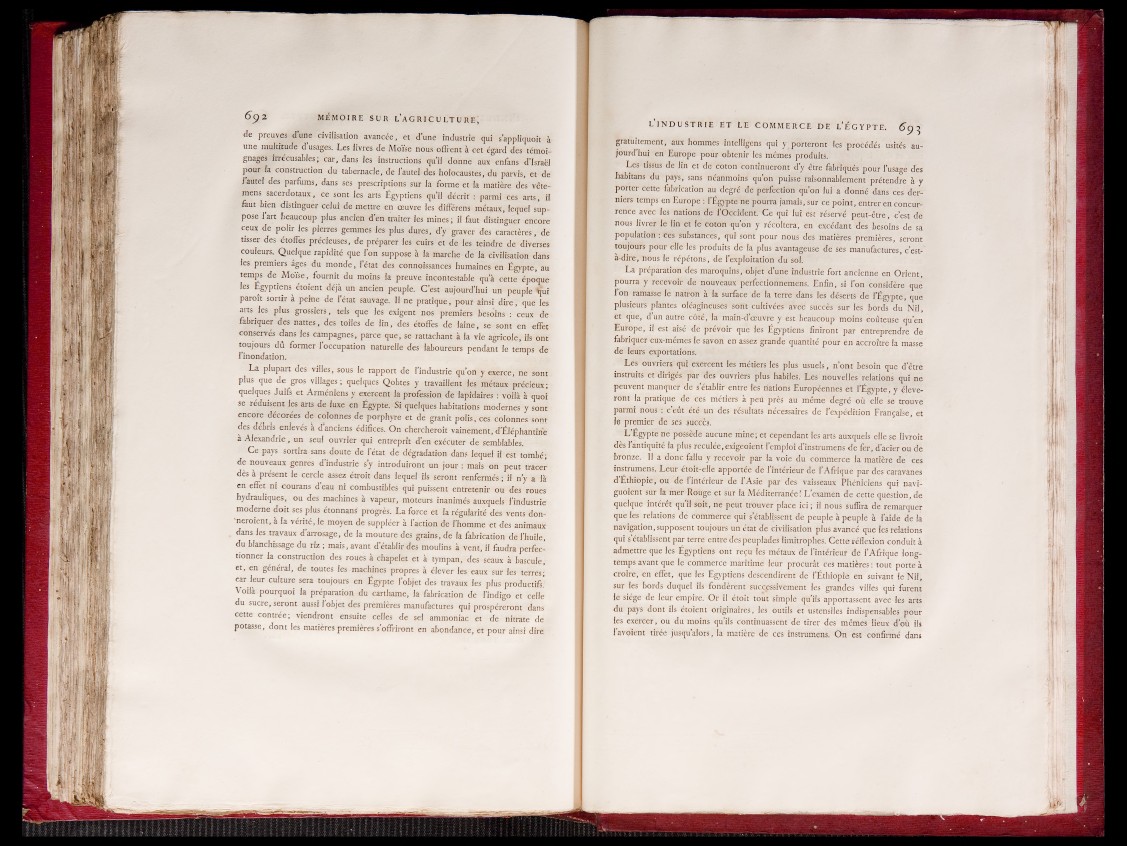
de preuves dune civilisation avancée, et d’une industrie qui s’appliquoit à
une multitude d usages. Les livres de Moïse nous offrent à cet égard des témoignages
irrécusables; car, dans les instructions qu’il donne aux enfans d’Israël
pour la construction du tabernacle, de l’autel des holocaustes, du parvis, et de
1 autel des parfums, dans ses prescriptions sur la forme et la matière des vête-
mens sacerdotaux, ce sont les arts Égyptiens qu’il décrit' : parmi ces arts, il
faut bien distinguer celui de mettre en oeuvre les différens métaux, lequel suppose
l’art beaucoup plus ancien d’en traiter les mines ; il fkut distinguer encore
ceux de polir les pierres gemmes les plus dures, d’y graver des caractères, de
tisser des étoffes précieuses, de préparer les cuirs et de les teindre de diverses
couleurs. Quelque rapidité que l’on suppose à la marche de la civilisation dans
les premiers âges du monde, l’état des connoissances humaines en Égypte, au
temps de Moïse, fournit du moins la preuve incontestable qu’à cette époque
les Egyptiens^ étoient déjà un ancien peuple. C ’est aujourd’hui un peuple t[ui
paroît sortir à peine de l’état sauvage. Il ne pratique, pour ainsi dire, que les
arts les plus grossiers, tels que les exigent nos premiers besoins : ceux de
fabriquer des nattes, des toiles de lin, des étoffes de laine, se sont en effet
conservés dans les campagnes, parce que, se rattachant à la vie agricole, ils ont
toujours dû former l’occupation naturelle des laboureurs pendant le temps de
l’inondation.
La plupart des villes, sous le rapport de l’industrie qu’on y exerce, ne sont
plus que de gros villages; quelques Qobtes y travaillent les métaux précieux;
quelques Juifs et Arméniens y exercent la profession de lapidaires : voilà à quoi
se réduisent les arts de luxe en Égypte. Si quelques habitations modernes y sont
encore décorées de colonnes de porphyre et de granit polis, ces colonnes sont
des débris enlevés à d anciens édifices. On chercheroit vainement, d’Éléphantine
à Alexandrie, un seul ouvrier qui entreprît d’en exécuter de semblables.
Ce pays sortira sans doute de l’état de dégradation dans lequel il est tombé;
de nouveaux genres d’industrie s’y introduiront un jour : mais on peut tracer
des a présent le cercle assez étroit dans lequel ils seront renfermés ; il n’y a là
en effet ni courans d eau ni combustibles qui puissent entretenir ou des roues
hydrauliques, ou des machines à vapeur, moteurs inanimés auxquels l’industrie
moderne doit ses plus étonnans progrès. La force et la régularité des vents don-
'neroient, à la vérité, le moyen de suppléer à l’action de l’homme et des animaux
dans les travaux d’arrosage, de la mouture des grains, de la fabrication de l’huile,
du blanchissage du riz ; mais, avant d’établir des moulins à vent, il faudra perfectionner
la construction des roues à chapelet et à tympan, des seaux à bascule,
et, en général, de toutes les machines propres à élever les eaux sur les terres;
car leur culture sera toujours en Égypte l’objet des travaux les plus productifs.
Voilà pourquoi la préparation du carthame, la fabrication de l’indigo et celle
du sucre, seront aussi l’objet des premières manufactures qui prospéreront dans
cette contrée; viendront ensuite celles de sel ammoniac et de nitrate de
potasse, dont les matières premières s’offriront en abondance, et pour ainsi dire
gratuitement, aux hommes intelligens qui y porteront les procédés usités au-
jourd hui en Europe pour obtenir les mêmes produits.
Les tissus de lin et de coton continueront d’y être fabriqués pour l’usage des
habitans du pays, sans néanmoins qu’on puisse raisonnablement prétendre à y
porter cette fabrication au degré de perfection qu’on lui a donné dans ces derniers
temps en Europe : l’Égypte ne pourra jamais, sur ce point, entrer en concurrence
avec les nations de 1 Occident. Ce qui lui est réservé peut-être, c’est de
nous livrer le lin et le coton qu’on y récoltera, en excédant des besoins de sa
population : ces substances, qui sont pour nous des matières premières, seront
toujours pour elle les produits de la plus avantageuse de ses manufactures, c'est-
à-dire, nous le répétons, de l’exploitation du sol.
La préparation des maroquins, objet d’une industrie fort ancienne en Orient,
pourra y recevoir de nouveaux perfectionnemens. Enfin, si l’on considère que
l’on ramasse le natron à la surface de la terre dans les déserts de l’Égypte, que
plusieurs plantes oléagineuses sont cultivées avec succès sur les bords du Nil,
et que, d un autre côte, la main-d oeuvre y est beaucoup moins coûteuse qu’en
Europe, il est aisé de prévoir que les Égyptiens finiront par entreprendre de
fabriquer eux-mêmes le savon en assez grande quantité pour en accroître la m w
de leurs exportations.
Les ouvriers qui exercent les métiers les plus usuels, n’ont besoin que d’être
instruits et dirigés par des ouvriers plus habiles. Les nouvelles relations qui ne
peuvent manquer de s établir entre les nations Européennes et l’Égypte, y élèveront
la pratique de ces métiers à peil près au même degré où elle se trouve
parmi nous : c’eût été un des résultats nécessaires de l’expédition Française, et
le premier de ses succès.
é Égypte ne possède aucune mine; et cependant les arts auxquels elle se livroit
dès l'antiquité la plus reculée, exigeoient l’emploi d’instrumens de fer, d’acier ou de
bronze. Il a donc fallu y recevoir par la voie du commerce la matière de ces
instrumens. Leur etoit-elle apportée de 1 intérieur de 1 Afrique par des caravanes
d Éthiopie, ou de 1 intérieur de l’Asie par des vaisseaux Phéniciens qui navi-
guoient sur la mer Rouge et sur la Méditerranée! L ’examen de cette question, de
quelque intérêt qu il soit, ne peut trouver place ici ; il nous suffira de remarquer
que les relations de commerce qui s’établissent de peuple à peuple à l’aide de la
navigation, supposent toujours un état de civilisation plus avancé que les relations
qui s établissent par terre entre des peuplades limitrophes. Cette réflexion conduit à
admettre que les Égyptiens ont reçu les métaux de l’intérieur de {’Afrique longtemps
avant que le commerce maritime leur procurât ces matières: tout porte à
croire, en effet, que les Egyptiens descendirent de l’Éthiopie en suivant le Nil,
sur les bords duquel ils fondèrent successivement les grandes villes qui furent
le siege de leur empire. Or il etoit tout simple qu’ils apportassent avec les arts
du pays dont ils étoient originaires, les outils et ustensiles indispensables pour
les exercer, ou du moins qu’ils continuassent de tirer des mêmes lieux d’où ils
lavoient tirée jusqu’alors, la matière de ces instrumens. On est confirmé dans