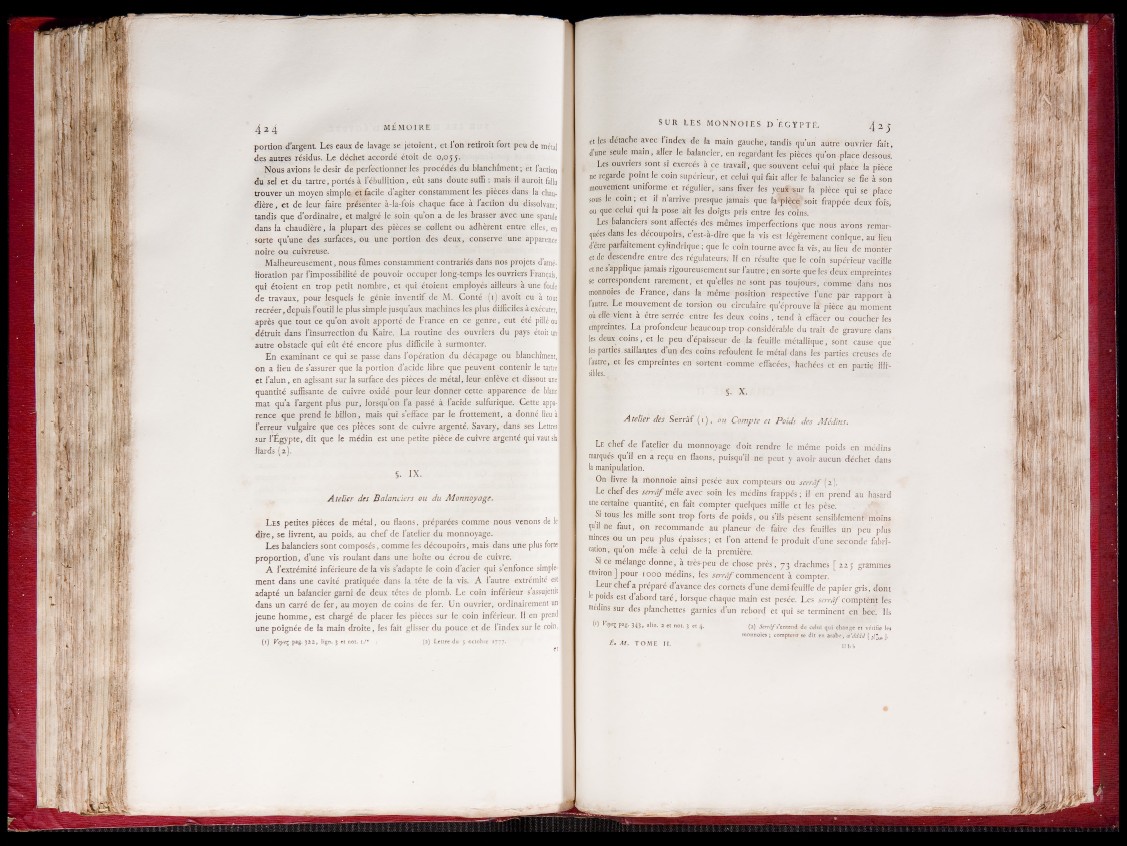
portion d’argent. Les eaux de lavage se jetoient, et l’on retiroit fort peu de tnctal
des autres résidus. Le déchet accordé étoit de 0,055.
Nous avions le désir de perfectionner les procédés du blanchiment ; et l’action
du sel et du tartre, portés à l’ébullition, eût sans doute suffi : mais il auroit fallu
trouver un moyen simple et facile d’agiter constamment les pièces dans la chaudière
, et de leur faire présenter à-la-fois chaque face à 1 action du dissolvant ;
tandis que d’ordinaire, et malgré le soin qu’on a de les brasser avec une spatule
dans la chaudière, la plupart des pièces se collent ou adhèrent entre elles, en
sorte qu’une des surfaces, ou une portion des deux, conserve une apparence
noire ou cuivreuse.
Malheureusement, nous fûmes constamment contrariés dans nos projets d’amélioration
par l’impossibilité de pouvoir occuper long-temps les ouvriers Français,
qui étoient en trop petit nombre, et qui étoient employés ailleurs à une foulei
de travaux, pour lesquels le génie inventif de M. Conté (1) avoit eu à tout
recréer, depuis l’outil le plus simple jusqu’aux machines les plus difficiles à exécuter,
après que tout ce qu’on avoit apporté de France en ce genre, eut été pillé ou
détruit dans l’insurrection du Kaire. La routine des ouvriers du pays étoit un-
autre obstacle qui eût été encore plus difficile à surmonter.
En examinant ce qui se passe dans l’opération du décapage ou blanchiment,
on a lieu de s’assurer que la portion d’acide libre que peuvent contenir le tartre
et l’alun, en agissant sur la surface des pièces de métal, leur enlève et dissout une
quantité suffisante de cuivre oxidé pour leur donner cette apparence de blanc
mat qu’a l’argent plus pur, lorsqu’on l’a passé à l’acide sulfurique. Cette apparence
que prend le billon, mais qui s’efface par le frottement, a donné lieu à
l’erreur vulgaire que ces pièces sont de cuivre argenté. Savary, dans ses Lettres
sur l’Égypte, dit que le médin est une petite pièce de cuivre argenté qui vaut six
liards (2).
s. IX.
Atelier des Balanciers ou du Monnayage.
L es petites pièces de métal, ou flaons, préparées comme nous venons de le
dire, se livrent, au poids, au chef de l’atelier du monnoyage.
Les balanciers sont composés, comme les découpoirs, mais dans une plus forte
proportion, d’une vis roulant dans une boîte ou écrou de cuivre.
A l’extrémité inférieure de la vis s’adapte le coin d’acier qui s’enfonce simplement
dans une cavité pratiquée dans la tête de la vis. A l’autre extrémité est
adapté un balancier garni de deux têtes de plomb. Le coin inférieur s’assujettit
dans un carré de fer, au moyen de coins de fer. Un ouvrier, ordinairement un
jeune homme, est chargé de placer les pièces sur le coin inférieur. Il en prend
une poignée de la main droite, les fait glisser du pouce et de l’index sur le coin,
(1) Voye£ pag. 322, Iign. 3 et not. 1/* 1 (2) Lettre du j octobre 1777.
et les détache avec 1 index de la main gauche, tandis qu’un autre ouvrier fait,
d’une seule main, aller le balancier, en regardant les pièces qu’on place dessous.
Les ouvriers sont si exercés à ce travail, que souvent celui qui place la pièce
ne regarde point le coin supérieur, et celui qui fait aller le balancier se fie à son
mouvement uniforme et régulier, sans fixer les yeux -Sur la pièce qui se place
sous le coin ; et il n’arrive presque jamais que la^pièce soit frappée deux fois,
ou que celui qui la pose ait les doigts pris entre les coins,
Les balanciers sont affectés des mêmes imperfections que nous avons remarquées
dans les découpoirs, cest-a-dire que la vis est légèrement conique, au lieu
dêtre parfaitement cylindrique; que le coin tourne avec la vis, au lieu de monter
et de descendre entre des régulateurs. 11 en résulte que le coin supérieur vacille
et ne s’applique jamais rigoureusement sur l’autre; en sorte que les deux empreintes
se correspondent rarement, et qu’elles ne sont pas toujours, comme dans nos
monnoies de France, dans la meme position respective l’une par rapport à
i autre. Le mouvement de torsion ou circulaire qu’éprouve la pièce au moment
ou elle vient a etre serree entre les deux coins , tend à effacer ou coucher les
empreintes. La profondeur beaucoup trop considérable du trait de gravure dans
les deux coins, et le peu d épaisseur de la feuille métallique, sont cause que
les parties.saillantes d'un des coins refoulent le métal dans les parties creuses de
lautre, et les empreintes en sortent comme effacées, hachées et en partie illisibles.
,
i X.
Atelier des Serrâf (t), ou Compte et Poids des Médins.
Le chef de 1 atelier du monnoyage doit rendre le même poids en médins
marqués qu’il en a reçu en flaons, puisqu’il ne peut y avoir aucun déchet dans
la manipulation.
On livre la monnoie ainsi pesée aux compteurs ou serrâf (2).
Le chef des sen-âfmëin avec soin les médins frappés; il en prend au hasard
une certaine quantité, en fait compter quelques mille et les pèse.
Si tous les mille sont trop forts de poids, ou s’ils pèsent sensiblement moins
qu’il ne faut, on recommande au planeur de faire des feuilles un peu plus
minces ou un peu plus épaisses ; et l’on attend le produit d’une seconde fabri-
cation, qu on meie à celui de la première.
Si ce mélangé donne, a très-peu de chose près, 73 drachmes [ 225 grammes
environ] pour 1000 médins, les serrâf commencent à compter.
Leur chef a préparé d’avance des cornets d’une demi-feuille de papier gris, dont
le poids est d’abord taré, lorsque chaque main est pesée. Les serrâf comptent les
médins sur des planchettes garnies d’un rebord et qui se terminent en bec. Ils
(0 I V î pag. 343, alin. 2 et not. 3 et 4. (2) Serrâf s’entend de celui qui change et vérifie le«
monnoies ; compteur se dit en arabe, a’ddàd [ ].
£• M. T O M E I I . H h h