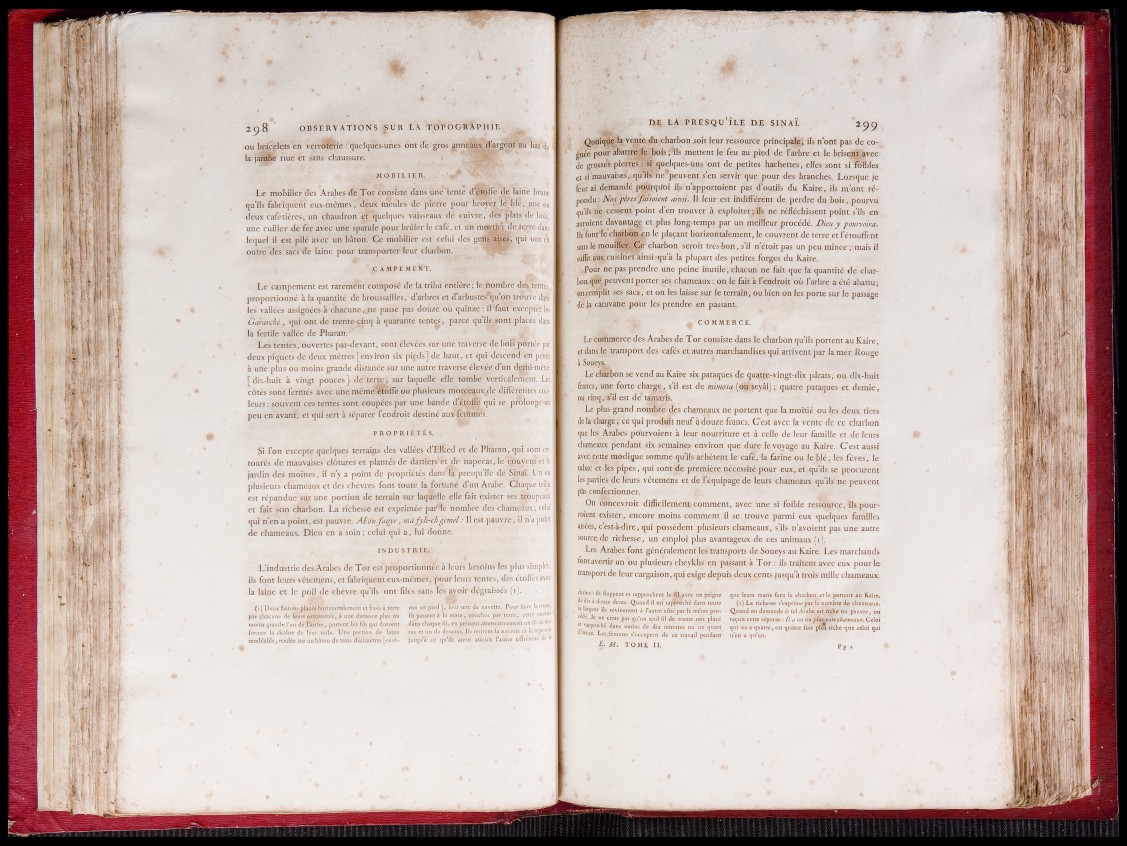
2 9 8 o b s e r v a t i o n s § u r L A t o p o g r a p h i e
ou bracelets en verroterie : quelques-unes ont de gros anneaux d’argent au bas de
la jambe nue et sans chaussure.
M O B I L I E R .
Le mobilier des Arabes de T o r consiste dans une tente d’étoffe de laine brune
qu’ils fabriquent eux-mêmes, deux meules de pierre pour broyer le blé, une ou
deux cafetières, un chaudron et quelques vaisseaux de cuivre, dès plats de bois,
une cuiller de fer avec une spatule pour brûler le café, et un mortier de .terre dans
lequel il est pilé avec un bâton. Ce mobilier est celui des gens aisés,.qui ont en
outre des sacs'de laine pour transporter leur charbon.
’ , C A M P E M t S T .
Le campement est rarement composé de la tribu entière; le nombre descentes, I
proportionné à la quantité de broussailles, d’arbres et d’arbustes*qu’on trouve dans j |
les vallées assignées à chacune,.ne passe pas douze ou quinze : il‘faut excepté/les ■
Gararché, qui ont de trente-cinq à quarante tentes, parce qu’ils sont placés dans
la fertile vallée de Pharan.
Les tentes, ouvertes par-devant, sont élevées sur une traverse de bois portée par1
deux piquets de deux mètres [environ six pieds] de haut, et qui descend en petite i
à une plus ou moins grande distance sur une autre traverse élevée d’un depii-mètre I
[dix-huit à vingt pouces] de terre; sur laquelle elle tombe verticalement. Les
côtés sont fermés avec une même etôffe ou plusieurs morceaux.dc différentes cou-1
leurs : souvent ces tentes sont coupées par une bande d’éipffe qui se prolonge'« i
peu en avant, et qui sert à séparer l’endroit destiné aux femmes.
P R O P R I É T É S .
Si l’on excepte quelques terrains des vallées cI’Elked et de Pharan, qui sont entourés
de mauvaises clôtures et plantés de dattiers’ et de napecas, !e couvent et le
jardin des moines, il n’y a point de propriétés dans Là presqu’île 4e Sinaï. Un ou
plusieurs chameaux et des chèvres font toute la fortuné d’un Arabe. Chaque tribu
est répandue sur une portion de terrain sur laquelle elle fait exister ses troupeaux
et fait son charbon. La richesse est exprimée parle nombre des chameaux ; celui
qui n’en a point, est pauvre. Aboufaqyr, mâfyh-chgemel : Il est pauvre, il n a point
de chameaux. Dieu en a soin ; celui qui a , lui donne.
I N D U S T R I E ; !
L ’industrie des Arabes de T o r estproportionnée à leurs besoins les plus simples;
ils font leurs vêtemens, et fabriquent eux-mêmes, pour leurs tentes, des étoffes avec
la laine et le poil de chèvre qu’ils ont filés sans les avoir dégraissés (i).
(i) Deux bâtons placés horizontalement et fixés à terre
par chacune de leurs extrémités, à une distance plus ou
moins grande l’un de l’autre, portent les fils qui doivent
former la chaîne de leur toile. Une portion de laine
semblable, roulée sur un bâton de trois décimètres [environ
un pied 1, leur sert de navette. Pour faire latrarne,
ils passent à la main, couchés par terre, cette navette1
dans chaque fil, en prenant alternativement un fil du dessus
et un du dessous, lis retirent la navette et la repassent
jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’autre extrémité de I*
D E L A P R E S Q U ’ Î L E D E S I N A Ï . 2 9 9
Q u o iq u e la vente, du charbon soit leur ressource principale, ils n’ont pas de cognée
pour abattre le bois ; ils mettent le feu au pied de l’arbre et le brisent avec
de grosses pierres : si quelques-uns ont de petites hachettes, elles sont si fôibles
et si mauvaises, qu’ils ne peuvent's’en servir que pour des branches. Lorsque je
leur ai demandé pourqifoi i[s n’apportoient pas d’outils du Kaire, ils m’ont répondu
: Nos pères faïsoient ainsi. Il leur est indifférent de perdre du bois , pourvu
qu’ils 11e cessent point d’en trouver à exploiter ; ils ne réfléchissent point s’ils en-
auroient davantage et plus long-temps par un meilleur procédé. Dieu y powvoira.
iis fonp le charbonmn le plaçant horizontalement, le couvrent de terre et l’étouffent
s a n s le mouiller. Ce charbon seroit très-bon, s’il n’étoit pas un peu mince; mais il
s u f f i t aux cuisines ainsi *qu’à la plupart des petites forges du Kaire.
Pour ne pas prendre une peine inutile, chacun ne fait que la quantité de charbon
que peuvent porter ses chameaux ; on le fait à l’endroit où l’arbre a été abattu;
onrenïplit ses sacs, et on les.laisse sur le terrain, ou bien on les porte sur le passage
dé Ja caravane pour les prendre en passant.
C O M M E R C E .
Le commerce des Arabes de Tor consiste dans le charbon qu’ils portent au Kaire,
et dans le transport des cafés et autres marchandises qui arrivent par la mer Rouge
à Soueys.
Le charbon se vend au Kaire six pataquès de quatre-vingt-dix pârats, ou dix-huit
francs, une forte charge , s’il est de mimosa (ou seyâl) ; quatre pataquès et demie,
ou cinq, s’il est dé tamaris.
Le plus grand nombre des chameaux ne portent que la moitié ou les deux tiers
de la charge ; cé qui produit neuf à douze francs. Cest avec la vente de ce charbon
que les Arabes pourvoient à leur nourriture et à celle de leur famille et de leurs
chameaux pendant six semaines environ que dure le voyage au Kaire. C ’est aussi
avec cette modique somme qu’ils achètent le café, la farine ou le blé, les fèves, le
tabac et les pipes, qui sont de première nécessité pour eux, et qu’ils se procurent
les parties de leurs vêtemens et de l’équipage de leurs chameaux qu’ils ne peuvent
jfïts confectionner.
On concevroit difficilement comment, avec une si foible ressource, ils pourraient
exister, encore moins comment il se.trouve parmi eux quelques familles
aisées, c’est-à-dire, qui possèdent plusieurs chameaux, s’ils n’avoient pas une autre
source de richesse, un emploi plus avantageux de ces animaux (1).
Les Arabes font généralement les transports de Soueys au Kaire. Les marchands
font avertir un ou plusieurs cheykhs en passant à T or : ils traitent avec eux pour le
transport de leur cargaison, qui exige depuis deux cents jusqu’à trois mille chameaux.
chaîne : ils frappent et rapprochent le fil avec un peigne que leurs maris font le charbon et le portent au Kaire.
de dix a douze dents. Quand il est rapproché dans toute (l) La richesse s’exprime par le nombre de chameaux,
sa largeur iis reviennent à l’autre côté par ie même pro- Quand on demande si tel Arabe est riche ou pauvre, on
cédé. Je ne crois pas qu’un seui fil de trame soit placé reçoit cette réponse : l i a un ou plusieurs chameaux. Celui
et rapproché dans moins de dix minutes ou un quart qui en a quatre, est quatre fois p i * riche que celui qui
heure. Les,femmes s'occupent de ce travail pendant n'en a qu’un.
É. M . T O M E II. p p a