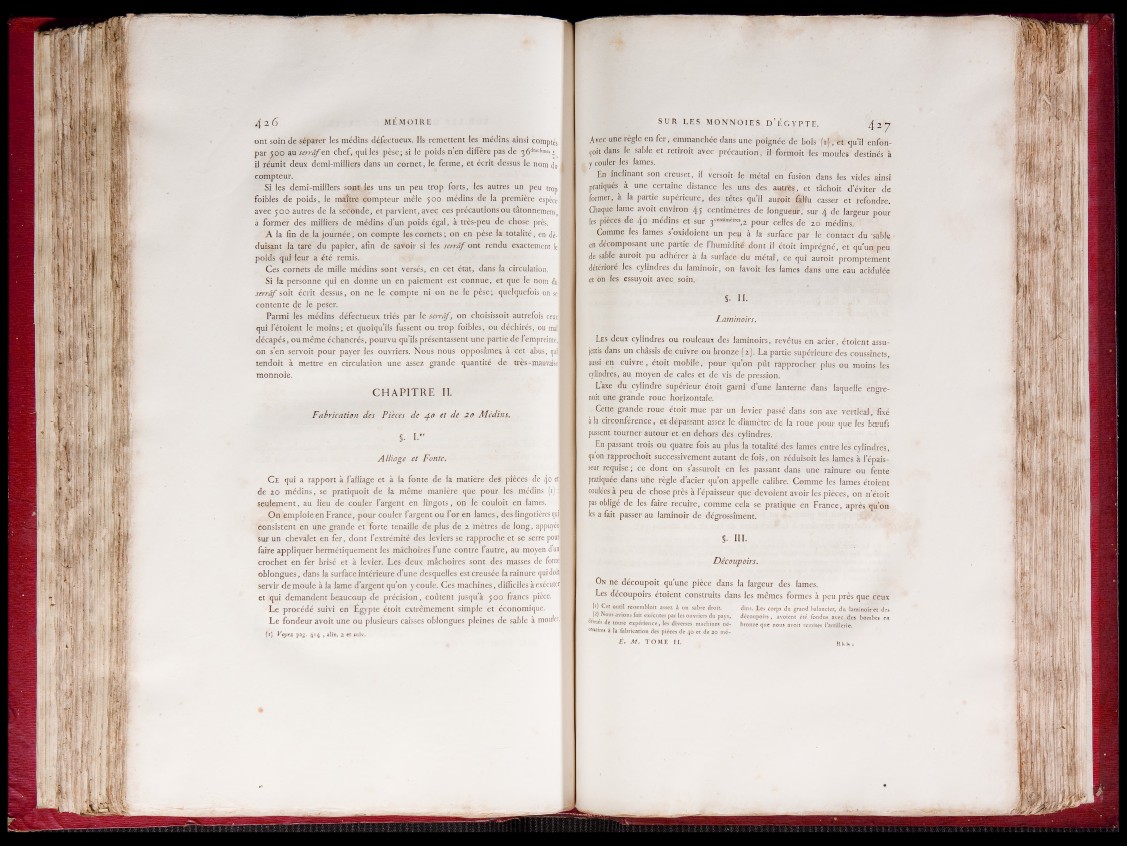
ont soin de séparer les rnédins défectueux. Ils remettent les médins ainsi comptés
par 500 au serrâf en chef, qui les pèse ; si le poids n’en diffère pas de ^6dr,ch”'«i
il réunit deux demi-milliers dans un cornet, le ferme, et écrit dessus le nom du I
compteur.
Si les demi-milliers sont les uns un peu trop forts, les autres un peu trop
foibles de poids, le maître compteur mêle 500 médins de la première espèce]
avec 500 autres de la seconde, et parvient, avec ces précautions ou tâtonnemens, I
à former des milliers de médins d’un poids égal, à très-peu de chose près.
A la fin de la journée, on compte les cornets ; on en pèse la totalité, en dé-1
cluisant la tare du papier, afin de savoir si les serrâf ont rendu exactement le]
poids qui leur a été remis.
Ces cornets de mille médins sont versés, en cet état, dans la circulation.
Si la personne qui en donne un en paiement est connue, et que le nom du]
serrâf soit écrit dessus, on ne le compte ni on ne le pèse; quelquefois on sel
contente de le peser.
Parmi les médins défectueux triés par le serrâf, on choisissoit autrefois ceux1
qui l’étoient le moins; et quoiqu’ils fussent ou trop foibles, ou déchirés, ou mal]
décapés, ou même échancrés, pourvu qu’ils présentassent une partie de l’empreinte,I
on s’en servoit pour payer les ouvriers. Nous nous opposâmes à cet abus, qui r
tendoit à mettre en circulation une assez grande quantité de très-mauvaise«
monnoie.
CHAPITRE II.
Fabrication des Pièces de 4.0 et de 20 Médins.
§• I."
A lliage et Fonte.
C e qui a rapport à l’alliage et à la fonte de la matière des pièces de 40 et
de 20 médins, se pratiquoit de la même manière que pour les médins (1) 1
seulement, au lieu de couler l’argent en lingots, on le couloit en lames.
On emploie en France, pour couler l’argent ou l’or en lames, des lingotières qui
consistent en une grande et forte tenaille de plus de 2 mètres de long, appuyée!
sur un chevalet en fer, dont l’extrémité des leviers se rapproche et se serre poutj
faire appliquer hermétiquement les mâchoires l’une contre l’autre, au moyen d uni
crochet en fer brisé et à levier. Les deux mâchoires sont des masses de fonte
oblongues, dans la surface intérieure d’une desquelles est creusée la rainure qui doit
servir démoulé à la lame d’argent qu’on y coule. Ces machines, difficiles à exécuter
et qui demandent beaucoup de précision, coûtent jusqu’à 500 francs pièce.
Le procédé suivi en Egypte étoit extrêmement simple et économique.
Le fondeur avoit une ou plusieurs caisses oblongues pleines de sable à mouler.1
(1} Voyez pag. 4 14 > aHn. - et *uiv.
Avec une règle en fer, emmanchée dans une poignée de bois (i<), et qu’il enfon-
çoit dans le sable et retiroit avec précaution, il formoit les moules destinés à
y couler les lames.
En inclinant son creuset, il versoit le métal en fusion dans les vides ainsi
pratiqués à une certaine distance les uns des. autrês, et tâchoit d’éviter de
former, à la partie supérieure, des têtes qu’il auroit fallu casser et refondre.
Chaque lame avoit environ 4 5 centimètres de longueur, sur 4 de largeur pour
les pièces de 4.0 médins et sur p0ur celles de 20 médins.-
Comme les lames soxidoient un peu à la surface par le contact du 'sable
en décomposant une partie de 1 humidité dont il étoit imprégné, et qu’un peu
de sable auroit pu adhérer à la surface du métal, ce qui auroit promptement
détérioré les cylindres du laminoir, on lavoit les lames dans une eau acidulée
et on les essuyoit avec soin.
§. II.
Laminoirs.
Les deux cylindres ou rouleaux des laminoirs, revêtus en acier, étoient assujettis
dans un châssis de cuivre ou bronze (z). La partie supérieure des coussinets
aussi en cuivre, étoit mobile, pour qu’on pût rapprocher plus ou moins les
cylindres, au moyen de cales et de vis de pression.
L’axe du cylindre supérieur étoit garni d’une lanterne dans laquelle engre-
noit une grande roue horizontale.
Cette grande roue étoit mue par un levier passé dans son axe vertical, fixé
à la cil-conférence, et dépassant assez le diamètre de la roue pour que les boeufs
pussent tourner autour et en dehors des cylindres.
En passant trois ou quatre fois au plus la totalité des lames entre les cylindres,
qu’on rapprochoit successivement autant de fois, on réduisoit les lames à l’épaisseur
requise ; ce dont 6n s’assuroit en les passant dans une rainure ou fente
pratiquée dans une règle d’acier qu’on appelle calibre. Comme les lames étoient
coulees a peu de chose près à l’épaisseur que devoient avoir les pièces, on n’étoit
pas obligé de les faire recuire, comme cela se pratique en France, après qu'on
les a fait passer au laminoir de dégrossïment.
§. III.
Découpoirs.
On ne découpoit qu’une pièce dans la largeur des lames.
Les découpoirs étoient construits dans les mêmes formes à peu près que ceux
(1) Cet outil ressembloit assez à un sabre droit. dins. Les corps du grand balancier, du laminoir et des
(a) Nous avions fait exécuter par les ouvriers du pays, découpoirs, avoient été fondus avec des bombes en
Mués de tome expérience, les diverses machines né- bronze que nous avoit remises l’artillerie.
«Maires a la fabrication des pièces de 40 et de 20 meÊ
. M . T O M E II. H h h l