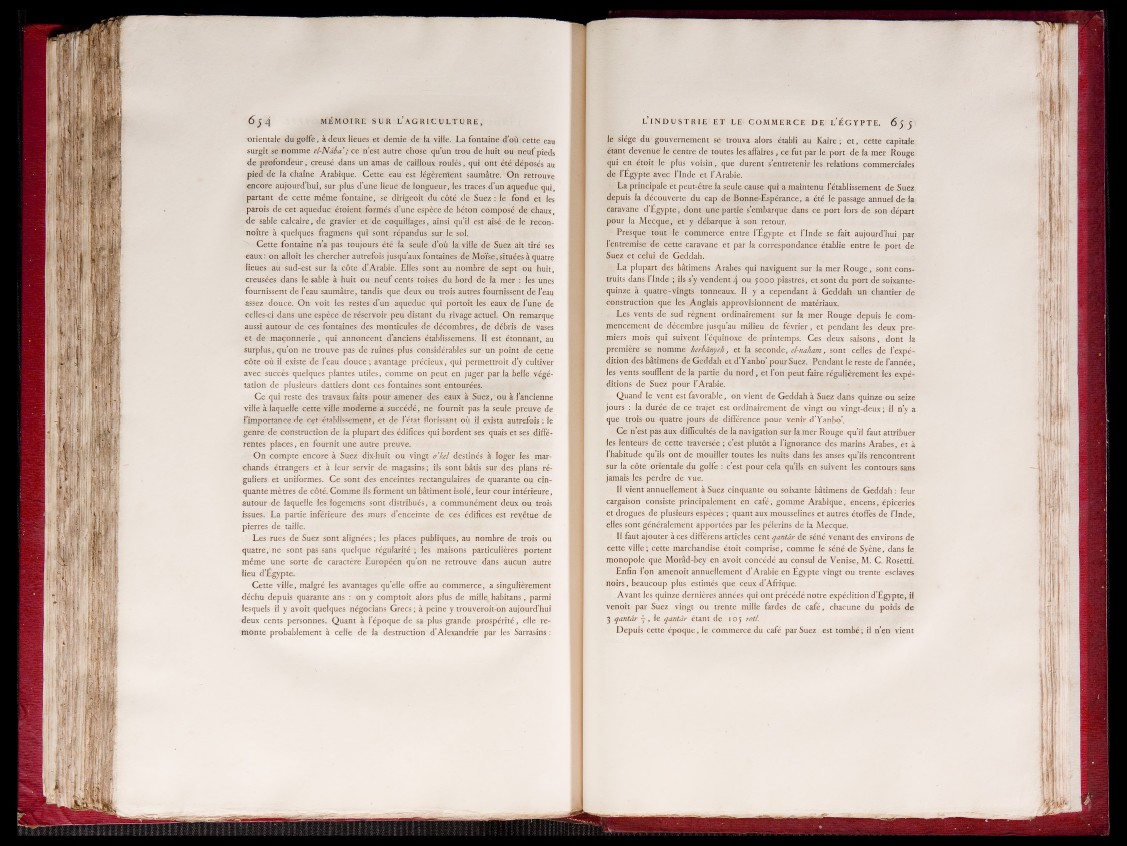
■orientale du golfe, à deux lieues et demie de la ville. La fontaine d’où cette eau
surgit se nomme rl-Nâba ; ce n’est autre chose qu’un trou de huit ou neuf pieds
de profondeur, creusé dans un amas de cailloux roulés, qui ont été déposés au
pied de la chaîne Arabique. Cette eau est légèrem'ent saumâtre. On retrouve
encore aujourd’hui, sur plus d’une lieue de longueur, les traces d’un aqueduc qui,
partant de cette même fontaine, se dirigeoit du côté de Suez : le fond et les
parois de cet aqueduc étoient formés d’une espèce de béton composé de chaux,
de sable calcaire, de gravier et de coquillages, ainsi qu’il est aisé de le recon-
noître à quelques fragmens qui sont répandus sur le sol.
| Cette fontaine n’a pas toujours été la seule d’où la ville de Suez ait tiré ses
eaux: on alioit les chercher autrefois jusqu’aux fontaines de Moïse, situées à quatre
lieues au sud-est sur la côte d’Arabie. Elles sont au nombre de sept ou huit,
creusées dans le sable à huit ou neuf cents toises du bord de la mer : les unes
fournissent de l’eau saumâtre, tandis que deux ou trois autres fournissent de l’eau
assez douce. On voit les restes d’un aqueduc qui portoit les eaux de l’une de
celles-ci dans une espèce de réservoir peu distant du rivage actuel. On remarque
aussi autour de ces fontaines des monticules de décombres, de débris de vases
et de maçonnerie, qui annoncent d’anciens établissemens. Il est étonnant, au
surplus, qu’on ne trouve pas de ruines plus considérables sur un point de cette
côte où il existe de l’eau douce ; avantage précieux, qui permettrait d’y cultiver
avec succès quelques plantes utiles, comme on peut en juger par la belle végétation
de plusieurs dattiers dont ces fontaines sont entourées.
Ce qui reste des travaux faits pour amener des eaux à Suez, ou à l’ancienne
ville à laquelle cette ville moderne a succédé, ne fournit pas la seule preuve de
l’importance de cet établissement, et de l’état florissant où il exista autrefois : le
genre de construction de la plupart des édifices qui bordent ses quais et ses différentes
places, en fournit une autre preuve.
On compte encore à Suez dix-huit ou vingt o’kel destinés à loger les marchands
étrangers et à leur servir de magasins ; ils sont bâtis sur des plans réguliers
et uniformes. Ce sont des enceintes rectangulaires de quarante ou cinquante
mètres de côté. Comme ils forment un bâtiment isolé, leur cour intérieure,
autour de laquelle les logemens sont distribués, a communément deux ou trois
issues. La partie inférieure des murs d’enceinte de ces édifices est revêtue de
pierres de taille.
Les rues de Suez sont alignées; les places publiques, au nombre de trois ou
quatre, ne sont pas sans quelque régularité ; les maisons particulières portent
même une sorte de caractère Européen qu’on ne retrouve dans aucun autre
lieu d’Egypte.
Cette ville, malgré les avantages qu’elle offre au commerce, a singulièrement
déchu depuis quarante ans : on y comptoit alors plus de mille, habitans, parmi
lesquels il y avoit quelques négocians Grecs ; à peine y trouveroit-on aujourd’hui
deux cents personnes. Quant à l’époque de sa plus grande prospérité, elle remonte
probablement à celle de la destruction d’Alexandrie par les Sarrasins :
le siège du gouvernement se trouva alors établi au Kaire ; e t, cette capitale
étant devenue le centre de toutes les affaires, ce fut par le port de la mer Rouge
qui en étoit le plus voisin, que durent s’entretenir les relations commerciales
de l’Egypte avec l’Inde et l’Arabie.
La principale et peut-être la seule cause qui a maintenu l’établissement de Suez
depuis la découverte du cap de Bonne-Espérance, a été le passage annuel de la
caravane d’Egypte, dont une partie s’embarque dans ce port lors de son départ
pour la Mecque, et y débarque à son retour.
Presque tout le commerce entre l’Egypte et l’Inde se fait aujourd’hui par
l’entremise de cette caravane et par la correspondance établie entre le port de
Suez et celui de Geddah.
La plupart des bâtimens Arabes qui naviguent sur la mer Rouge, sont construits
dans l’Inde ; ils s’y vendent 4 ou 5000 piastres, et sont du port de soixante-
quinze à quatre-vingts tonneaux. Il y a cependant à Geddah un chantier de
construction que les Anglais approvisionnent de matériaux.
Les vents de sud régnent ordinairement sur la mer Rouge depuis le commencement
de décembre jusqu’au milieu de février, et pendant les deux premiers
mois qui suivent lequinoxe de printemps. Ces deux saisons, dont la
première se nomme lierbânyeh, et la seconde, el-naliam, sont celles de l’expédition
des bâtimens de Geddah et d’Yanbo’ pour Suez. Pendant le reste de l’année,
les vents soufflent de la partie du nord, et l’on peut faire régulièrement les expéditions
de Suez pour l’Arabie.
Quand le vent est favorable, on vient de Geddah à Suez dans quinze ou seize
jours : la durée de ce trajet est ordinairement de vingt ou vingt-deux ; il n’y a
que trois ou quatre jours de différence pour venir d’Yanbo’.
Ce n’est pas aux difficultés de la navigation sur la mer Rouge qu’il faut attribuer
les lenteurs de cette traversée ; c’est plutôt à l’ignorance des marins Arabes, et à
l’habitude qu’ils ont de mouiller toutes les nuits dans les anses qu’ils rencontrent
sur la côte orientale du golfe : c’est pour cela qu’ils en suivent les contours sans
jamais les perdre de vue.
Il vient annuellement à Suez cinquante ou soixante bâtimens de Geddah : leur
cargaison consiste principalement en café, gomme Arabique, encens, épiceries
et drogues de plusieurs espèces ; quant aux mousselines et autres étoffes de l’Inde,
elles sont généralement apportées par les pèlerins de la Mecque.
Il faut ajouter à ces différens articles cent qantâr de séné venant des environs de
cette ville ; cette marchandise étoit comprise, comme le séné de Syène, dans le
monopole que Morâd-bey en avoit concédé au consul de Venise, M. C. Rosetti.
Enfin l’on amenoit annuellement d’Arabie en Egypte vingt ou trente esclaves
noirs, beaucoup plus estimés que ceux d’Afrique.
Avant les quinze dernières années qui ont précédé notre expédition d’Egypte, il
venoit par Suez vingt ou trente mille fardes de café, chacune du poids de
3 qantâr -j-, le qantâr étant de 105 rotl.
Depuis cette époque, le commerce du café par Suez est tombé ; il n’en vient