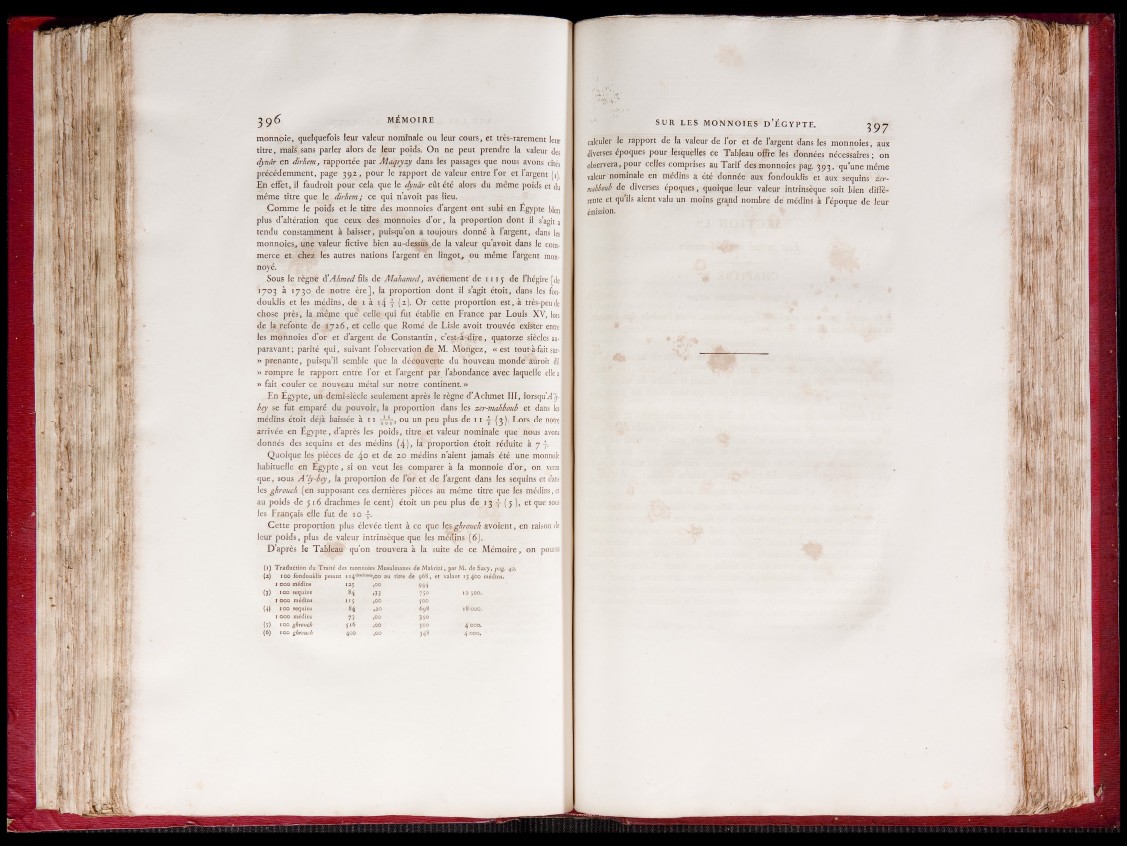
monnoie, quelquefois leur valeur nominale ou leur cours, et très-rarement leur
titre, mais sans parler alors de leur poids. On ne peut prendre la valeur des
dynâr en dlrhem, rapportée par Maqryzy dans les passages que nous avons cités
précédemment, page 392, pour le rapport de valeur entre l’or et l’argent (1)
En effet, il fàudroit pour cela que le dynâr eût été alors du même poids et du
même titre que le dir/iem; ce qui n’avoit pas lieu.
Comme le poids et le titre des monnoies d’argent ont subi en Égypte Lien
plus d’altération que ceux des monnoies d’o r , la proportion dont il s’agit a
tendu constamment à baisser, puisqu’on a toujours donné à l’argent, dans les
monnoies., une valeur fictive bien au-dessus de la valeur qu’avoit dans le commerce
et chez les autres nations l’argent en lingot, ou même l’argent mon-
noyé.
Sous le règne S Ahmed fils de Mohamed, avènement de 1 11 y de l’hégire [de
1703 à 1730 de notre ère], la proportion dont il s’agit étoit, dans les fon-
douklis et les médins, de 1 à i 4 j (2). Or cette proportion est, à très-peu de
chose près, la même que celle qui fut établie en France par Louis XV, Ion
de la refonte de 1726, et celle que Romé de Lisie avoit trouvée exister entre
les monnoies d’or et d’argent de Constantin, c’estrà-dire, quatorze siècles auparavant;
parité qui, suivant l’observation de M. Môngèz, «est tout-à-faitsur-
» prenante, puisqu’il semble que la découverte du nouveau monde aùroit dû
» rompre le rapport entre l’or et l’argent par l’abondance avec laquelle elle a
» fait couler ce nouveau métal sur notre continent. »
En Égypte, un demi-siècle seulement après le règne d’Achmet III, lorsqu’vi'^-
bey se fut emparé du pouvoir, la proportion dans les zer-mahboub et dans les
médins étoit déjà baissée à 11 ou un peu plus de 11 -f- ( 3 ). Lors de notre
arrivée en Égypte, d’après les poids, titre et valeur nominale que nous avons
donnés des sequins et des médins (4 ), la proportion étoit réduite à 7 f.
Quoique les pièces de 4 o et de 20 médins n’aient jamais été une monnoie
habituelle en Égypte, si on veut les comparer à la monnoie d’or, on verrai
que, sous A ’iy-bey, la proportion de l’or et de l’argent dans les sequins et dans]
les ghrouch (en supposant ces dernières pièces au même titre que les médins, et
au poids de y 16 drachmes le cent) étoit un peu plus de 1 3 7 ( 5 ) , et tlue sous
les Français elle fut de 10 j .
Cette proportion plus élevée tient à ce que les ghrouch avoient, en raison de
leur poids, plus de valeur intrinsèque que les mét[ins (6).
D ’après le Tableau qu’on trouvera à la suite de ce Mémoire, on pourra
(1) Traduction du Traité des monnoies Musulmanes de Makrizi, par M. de Sacy, pag. 42.
(2) 100 fondouklis pesant 1 i4 ‘,r*chmc*,oo au titre de 968, et valant 13400 médins.
i 000 médins 125 ,00 944
(3) 100 sequins 84 »33 750 12 500.
1 000 médins u f ,00 500
(4) 100 sequins 84 ,20 698 18 000.
1 000 médins 73 ,00 350
(S ) 100 ghrouch 516 ,00 500 4 000.
(<S) 100 ghrouch 400 ,00 348 4 000.
calculer le rapport de la valeur de 1 or et de l’argent dans les monnoies, aux
diverses époques pour lesquelles ce Tabjeau offre les données nécessaires ; on
observera, pour celles comprises au Tarif des monnoies pag. 393, qu’une même
valeur nominale en médins a été donnée aux fondouklis et aux sequins zer-
mahboub de diverses époques, quoique leur valeur intrinsèque soit bien différente
et qu’ils aient valu un moins grand nombre de médins à l’époque de leur
émission.