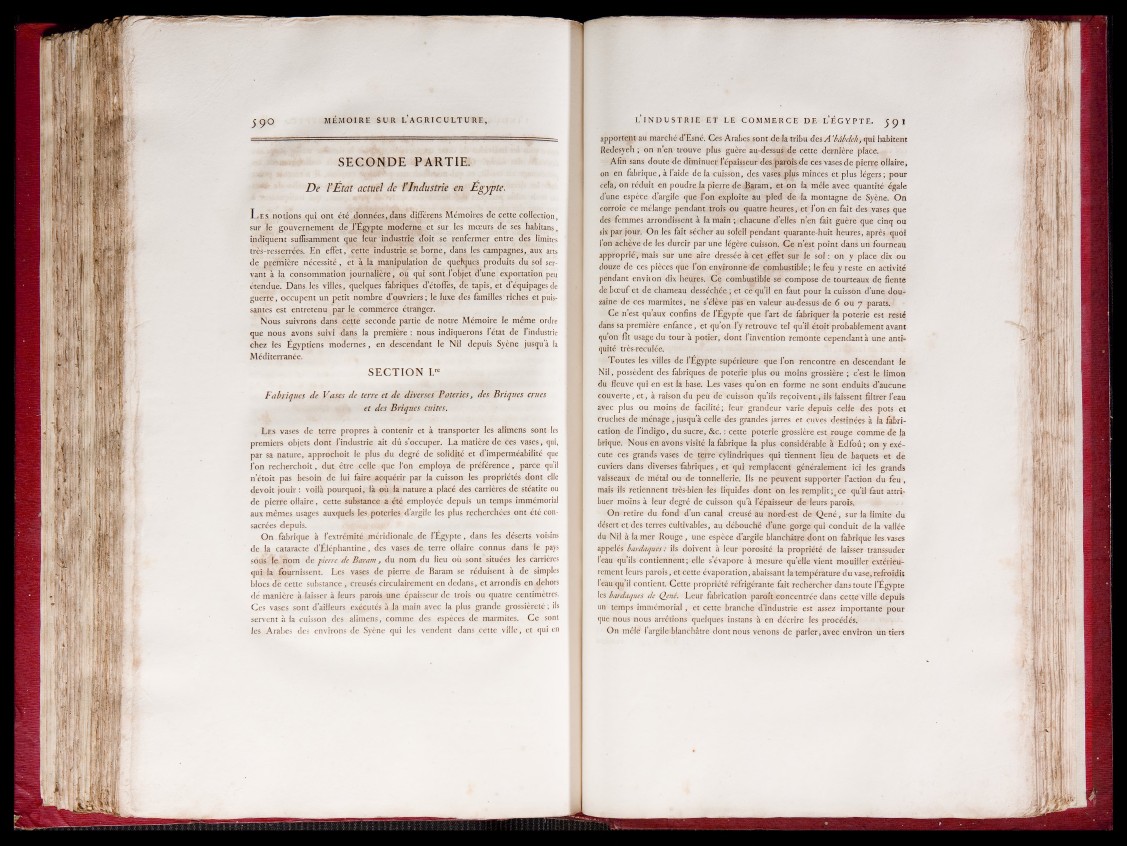
SECONDE PARTIE.
De l’État actuel de l’Industrie en Egypte.
L es notions qui ont été données,dans différcns Mémoires de cette collection,
sur le gouvernement de l’Egypte moderne et sur les moeurs de ses Iiabitans,
indiquent suffisamment que leur industrie doit se renfermer entre des limites
très-resserrées. En effet, cette industrie se borne, dans les campagnes, aux arts
de première nécessité, et à la manipulation de quelques produits du sol servant
à la consommation journalière, ou qui sont l’objet d’une exportation peu
étendue. Dans les villes, quelques fabriques d’étoffes, de tapis, et d’équipages de
guerre, occupent un petit nombre d’ouvriers; le luxe des familles'riches et puissantes
est entretenu par le commerce étranger.
Nous suivrons dans cette seconde partie de notre Mémoire le même ordre
que nous avons suivi dans la première : nous indiquerons l’état de l’industrie
chez les Égyptiens modernes, en descendant le Nil depuis Syène jusqu'à la
Méditerranée.
S E C T I O N I . re
Fabriques de Vases de terre et de diverses Poteries, des Briques crues
et des Briques cuites.
L es vases de terre propres à contenir et à transporter les alimens sont les
premiers objets dont l’industrie ait dû s’occuper. La matière de ces vases, qui,
par sa nature, approchoit le plus du degré de solidité et d’imperméabilité que
l’on recherchoit, dut être celle que l’on employa de préférence , parce qu’il
n’étoit pas besoin de lui faire acquérir par la cuisson les propriétés dont elle
devoit jouir : voilà pourquoi, là où la nature a placé des carrières de stéatite ou
de pierre ollaire, cette substance a été employée depuis un temps immémorial
aux mêmes usages auxquels les poteries d’argile les plus recherchées ont été consacrées
depuis.
On fabrique à l’extrémité méridionale de l’Egypte , dans les déserts voisins
de la cataracte d’Éléphantine, des vases de terre ollaire connus dans le pays
sous le nom de pierre de Baram, du nom du lieu où sont situées les carrières
qui la fournissent. Les vases de pierre de Baram se réduisent à de simples
blocs de cette substance , creusés circulairement en dedans, et arrondis en dehors
dé manière à laisser à leurs parois une épaisseur de trois ou quatre centimètres.
Ces vases sont d’ailleurs exécutés à la main avec la plus grande grossièreté ; ils
servent à la cuisson des alimens, comme des espèces de marmites. Ce sont
les Arabes des environs de Syène qui les vendent dans cette ville, et qui en
apportent au marché d’Esné. Ces Arabes sont de la tribu des A 'bâbdcli, qui habitent
Redesyeh ; on n’en trouve plus guère au-dessus de cette dernière place.
Afin sans doute de diminuer l’épaisseur des parois de ces vases de pierre ollaire,
on en fabrique, à l’aide delà cuisson, des vases plus minces et plus légers; pour
cela, on réduit en poudre la pierre de Baram, et on la mêle avec quantité égale
d’une espèce d’argile que l’on exploite au pied de la montagne de Syène. On
corroie ce mélange pendant trois ou quatre heures, et l’on en fait des vases que
des femmes arrondissent à la main ; chacune d’elles n’en fait guère que cinq ou
six par jour. On les fait sécher au soleil pendant quarante-huit heures, après quoi
l’on achève de les durcir par une légère cuisson. C e n’est point dans un fourneau
approprié, mais sur une aire dressée à cet effet sur le sol : on y place dix ou
douze de ces pièces que l’on environne de combustible; le feu y reste en activité
pendant environ dix heures. Ce combustible se compose de tourteaux de fiente
de boeuf et de chameau desséchée ; et cè qu’il en faut pour la cuisson d'une douzaine
de ces marmites, ne s’élève pas en valeur au-dessus de 6 ou 7 parats.
Ce n est qu’aux confins de l’Egypte que l’art de fabriquer la poterie est resté
dans sa première enfance, et qu’on l’y retrouve tel qu’il étoit probablement avant
qu’on fît usage du tour à potier, dont l’invention remonte cependant à une antiquité
très-reculée.
Toutes les villes de l’Egypte supérieure que l’on rencontre en descendant le
Nil, possèdent des fabriques de poterie plus ou moins grossière ; c’est le limon
du fleuve qui en est la base. Les vases qu’on en forme ne sont enduits d’aucune
couverte, e t , à raison du peu de cuisson qu’ils reçoivent, ils laissent filtrer l’eau
avec plus ou moins de facilité; leur grandeur varie depuis celle des pots et
cruches de ménage, jusqu’à celle des grandes jarres et cuves destinées à la fabrication
de l’indigo, du sucre, &c. : cette poterie grossière est rouge comme de la
brique. Nous en avons visité la fabrique la plus considérable à Edfoû ; on y exécute
ces grands vases de terre cylindriques qui tiennent lieu de baquets et de
cuviers dans diverses fabriques, et qui remplacent généralement ici les grands
vaisseaux de métal ou de tonnellerie. Us ne peuvent supporter l’action du feu ,
mais ils retiennent très-bien les liquides dont on les remplit ; ce qu’il faut attribuer
moins à leur degré de cuisson qu’à l’épaisseur de leurs parois.
On retire du fond d’un canal creusé au nord-est de Qené, sur la limite du
désert et des terres cultivables, au débouché d’une gorge qui conduit de la vallée
du Nil à la mer Rouge , une espèce d’argile blanchâtre dont on fabrique les.vases
appelés bardaques; ils doivent à leur porosité la propriété de laisser transsuder
leau qu’ils contiennent; elle s’évapore à mesure qu’elle vient mouiller extérieurement
leurs parois, et cette évaporation, abaissant la température du vase, refroidit 1 eau qu il contient. Cette propriété réfrigérante fait rechercher dans toute l’Egypte
les bardtiques de Qené. Leur fabrication paroît concentrée dans cette ville depuis
un temps immémorial , et cette branche d’industrie est assez importante pour
que nous nous arrêtions quelques instans à en décrire les procédés.
On mêle l’argile blanchâtre dont nous venons de parler, avec environ un tiers