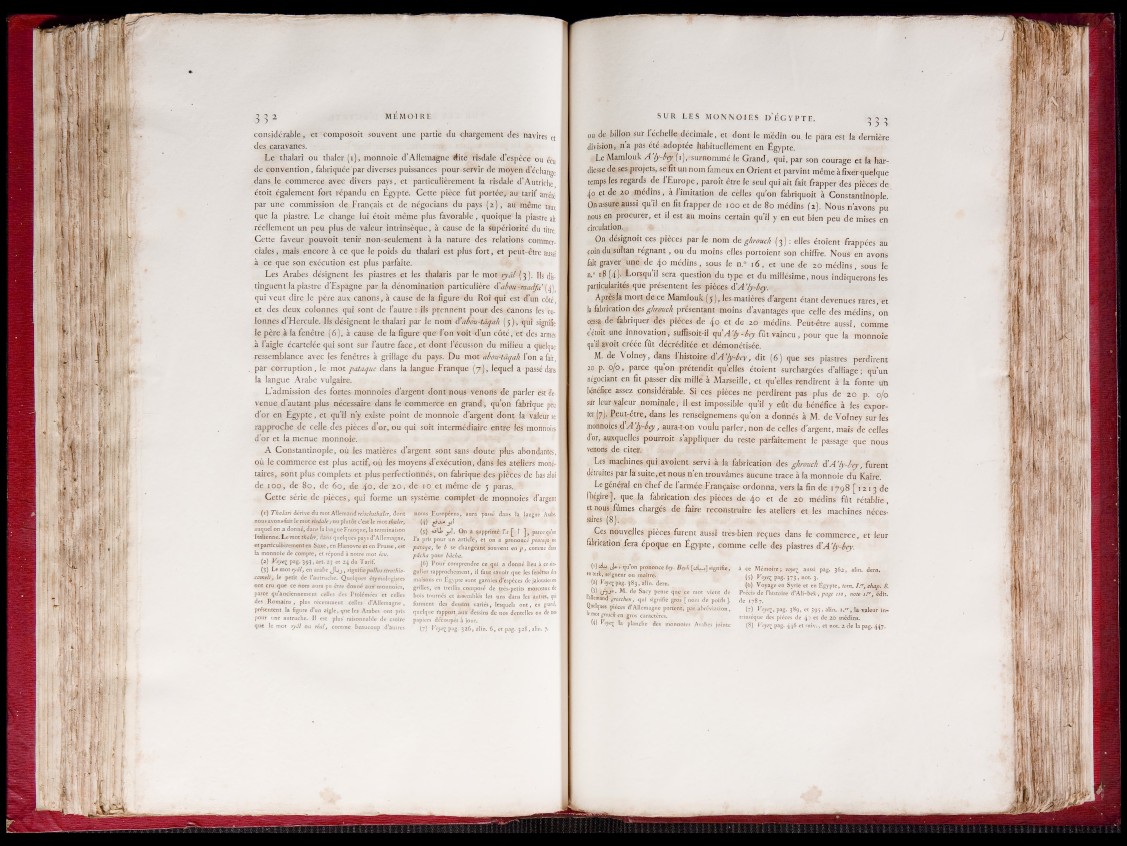
3 3 2 MEMOIRE
considérable, et composoit souvent une partie du chargement des navires et
des caravanes.
Le thalari ou thaler (i), monnoie d’Allemagne dite risdale d’espèce ou écti
de convention, fabriquée par diverses puissances pour servir de moyen d’échange
dans le commerce avec divers pays, et particulièrement la risdale d'Autriche
étoit également fort répandu en Egypte. Cette pièce fut portée, au tarif arrêté
par une commission de Français et de négocians du pays (2 ), au même taux
que la piastre. Le change lui étoit même plus favorable, quoique la piastre ait
réellement un peu plus de valeur intrinsèque, à cause de la supériorité du titre
Cette faveur pouvoit tenir non-seulement à la nature des relations commerciales
, mais encore à ce que le poids du thalari est plus fort, et peut-être aussi
à ce que son exécution est plus parfaite.
Les Arabes désignent les piastres et les thalaris par le mot ryâl (3). Ils (j}s. I
tinguent la piastre d’Espagne par la dénomination particulière A'abou-nuidfa [^\\
qui veut dire le père aux canons, à cause de la figure du Roi qui est d’un côté I
et des deux colonnes qui sont de l’autre : ils prennent pour des canons les co-1
lonnes d’HercuIe. Ils désignent le thalari par le nom d’abou-tâqah (y), -qui signifie I
le père à la fenêtre (6), à cause de la figure que l’on voit d’un côté, et des armes I
à l’aigle écartelée qui sont sur l’autre face, et dont l’écusson du milieu a quelque I
ressemblance avec les fenêtres à grillage du pays. Du mot abou-tâqah l’on a fait, I
par corruption , le mot pataque dans la langue Franque (7 ), lequel a-passé dans I
la langue Arabe vulgaire.
L’admission des fortes monnoies d’argent dont nous venons de parler est de-
venue d’autant plus nécessaire dans le commerce en grand, qu’on fabrique peu I
d’or en Egypte, et qu’il n’y existe point de monnoie d’argent dont la valeur se I
rapproche de celle des pièces d’or, ou qui soit intermédiaire entre les monnoies I
d’or et la menue monnoie.
A Constantinople, où les matières d’argent sont sans doute plus abondantes, I
où le commerce est plus actif, où les moyens d’exécution, dans les ateliers moné-1
taires, sont plus complets et plus perfectionnés, on fabrique des pièces de basaloi I
de 100, de 80, de 60, de 4o> de 20, de 10 et même de y paras. -
Cette série de pièces, qui forme un système complet de monnoies d’argent I
(1) Thalari dérive du mot Allemand reischsthàler, dont noms Européens, faura* passé dans la langue Arabe. 1
nous avonsfait le mot risdale; ou plutôt c’est le mot thaler, (4) j j !
auquel on a donné, dans la tangue Franque, la terminaison (j) «U, ^ 1, Q „ a supprimé. I’,r [ | ïl parce qu'on I
Italienne. Le mot thaler, dans quelques pays d’Allemagne, l'a pris pour un article, et on a prononcé poutaqa « I
et particulièrement en Saxe, en Hanovre et en Prusse, est pataqa, le h se changeant souvent en p , comme dans I
la monnoie de compte, et répond à notre mot écu. pâcha pour bâcha.
(2) Voye^ pag. 395, art. 23 et 24 du Tarif. (6) Pou f comprendre ce qui a donné lieu à ce sin- j
(3) Le mot ryâl, en arabe signifiepullusstruthio- gulier rapprochement, il faut savoir que les fenêtres des I
camelij le petit de 1 autruche. Quelques étymologistes maisons en Égypte sont garnies d’espèces de jalousies ou j
ont cru que ce nom aura pu être donné au^ monnoies, grilles, en treillis composé de très-petits morceaux de
parce qu anciennement celles des Ptolémées et celles bois tournés et assemblés les uns dans les autres, qui j
des Romains , plus récemment celles d’Allemagne , forment des dessin* variés, lesquels ont, en grand, j
présentent la figure dun aigle, que les Arabes ont pris quelque l'apport aux dessins de nos dentelles ou de noi
pour une autruche. II est plus' raisonnable de croire papiers découpés à jour.
que le mot ryâl ou réal, comme beaucoup d’autres (7) Voyei pag. 326, a lin. 6, et pag. 328, aliti. 7.
j
S U R L E S M O N N O I E S O É G Y P T E . 3 3 ? 3 3 3
ou de billon sur I éc belle décimale, et dont le médin ou, le para est la dernière
division, na pas été adoptée habituellement en Égypte.
Le Mamlouk A ly-bey fi),¡surnomme le Grand, qui, par son courage et la hardiesse
de ses projets, se fit un nom fameux en Orient et parvint même à fixer quelque
temps les regards de l’Europe, paroît être le seul qui ait fait frapper des pièces de
4° et de 20 médins, à l’imitation de celles qu’on fabriquoit à Constantinople.
On assure aussi qu’il en fit frapper de 100 et de 80 médins (2). Nous n’avons pu
nous en procurer, et il est au moins certain qu’il y en eut bien peu de mises en
circulation.
On designoit ces pièces par le nom dt ghrouch (3) : elles étoient frappées au
coin du sultan régnant, ou du moins elles portoient son chiffre. Nous en avons
fait graver une de 4o médins, sous le n.° 16 , et une de 20 médins, sous le
n." 18 (4 ). Lorsqu’il sera question du type et du millésime, nous indiquerons les
particularités que présentent les pièces ÿA'ly-bey.
Après la mort de ce Mamlouk (y), les matières d’argent étant devenues rares, et
la fabrication des ghrouch présentant moins d’avantages que celle des médins, on
cessa de fabriquer des pièces de 4.0 et de 20 médins. Peut-être aussi, comme
cétoit une innovation, suffisoit-il tyi A'ly-bey fut vaincu , pour que la monnoie
qu’il avoit créée fût décréditée et démonétisée.
M. de Volney, dans ¡histoire d’A'ly-bey, dit (6) que ses piastres perdirent
20 p. 0/0, parce qu on prétendit qu’elles étoient surchargées d’alliage ; qu’un
négociant en fit passer dix mille à Marseille, et qu’elles rendirent à la fonte uti
bénéfice assez considérable. Si ces pièces ne perdirent pas plus de 20 p. 0/0
sur leur valeur nominale, il est impossible qu’il y eût du bénéfice à les exporter
(7), Peut-être, dans les renseignemens qu’on a donnés à M. de Volney sur les
monnoies d A ly-bey, aura-t-on voulu parler, non de celles d’argent, mais de celles
dor, auxquelles pourroit s appliquer du reste parfaitement le passage que nous
venons de citer.
Les machines qui avoient servi à la fabrication des ghrouch & A"ly-bey, furent
détruites par la suite, et nous n en trouvâmes aucune trace à la monnoie du Kaire.
Le général en chef de 1 armée Française ordonna, vers la fin de 1798 [ 12 i 3 de
I hégire*], que la fabrication des pièces de 4<3 et de 20 médins fût rétablie ,
et nous fumes charges de faire reconstruire les ateliers et les machines nécessaires
(8).
Ces nouvelles pièces furent aussi tres-bien reçues dans le commerce, et leur
fabrication fera époque en Égypte, comme celle des piastres d’A ’ly-bey.
t'ijèsi d * ’ tIu’° " prononcehey. Beyk [uL-j]signifie, à ce Mémoire; vojvj aussi pag. 36a, alin. dern.
t" turk, seigneur ou mairre. (s) Voyez pag. 373, not. 3.
(a) I oyeçpag. 383, alin. dern. (û) Voyage en Syrie et en Égypte, tom. I.n, cliap. S.
H w . M. de Sacy pense que ce mot vient de Précis de l’histoire d’Ali-bek, page 1,0, note t . " , édit.
allemand groschen, qui signifie gros [nom de poids], de 1787.
Quelques pièces d’Allemagne portent, par abréviation, (7) Foyrj, pag. 389, et 395, alin. t . " , Ja valeur int
moi groschçn gros caractères. % trinsèque des pièces de 4 5 et de 20 médins.
(4) Voyez ,a planche des monnoies Arabes jointe (8) Voyei pag. 446 et suiv., et not. 2 de la pag. 447.