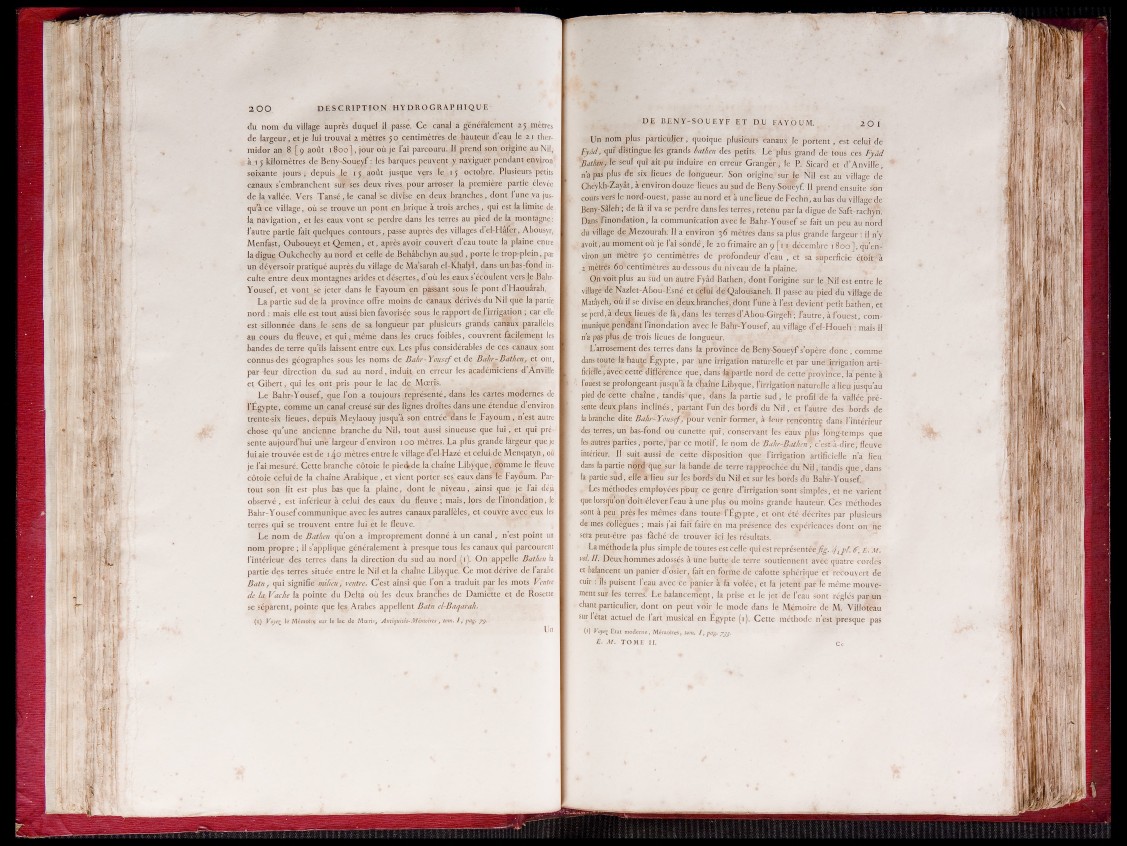
200 D E S C R I P T I O N H Y D R O G R A P H I Q U E
4f.
r' -■
¿À1Bip
'!E|Je
du nom du village auprès duquel il passe. Ce canal a généralement 25 mètres
de largeur, et je lui trouvai 2 mètres 50 centimètres de hauteur d eau le 21 thermidor
an 8 [9 août 1800], jour où je l’ai parcouru. Il prend son origine au Nil,;
à 15 kilomètres de Beny-Soueyf : les barques peuvent y naviguer pendant environ
soixante jours , depuis Je. 1 y août jusque vers le 15 octobre. Plusieurs petits
canaux s’embranchent sur ses deux rives pour arroser la première partie clevée
de la vallée. Vers Tansé, le canal se divise en deux branches, dont I une va jusqu’à
ce village, où se trouve un pont en brique à trois arches, qui est la limite de
la navigation, et les eaux vont se perdre dans les terres au pied de la montagne:
l’autre partie fait quelques contours, passe auprès des villages del-Hâfer, Abousyr,
Menfast, Ouhoueyt etQemen, et, après avoir couvert d eau toute la plaine entre
la digue Oukchechy au nord et celle de Behâbchyn au sud, porte le trop-plein, par
un déversoir pratiqué auprès du village de Ma’sarah el-Khalyl, dans un bas-fond inculte
entre deux montagnes arides et désertes, d’où les eaux s’écoulent vers le Bahr-
Yousef, et vont se jeter dans le Fayoum en passant sous le pont d’Haouârah.
La partie sud de la province offre moins de canaux dérivés du Nil que la partie
nord : mais elle est tout aussi bien favorisée sous le rapport de 1 irrigation ; car elle
est sillonnée dans le sens de sa longueur par plusieurs grands canaux parallèles
au cours du fleuve, et qui, même dans les crues foibles, couvrent facilement les
bandes de terre qu’ils laissent entre eux. Les plus considérables de ces canaux sont
cormusdes géographes sous les noms de Bahr- Youscf et de Bahr-Bathen, et ont,
par leur direction du sud au nord, induit en erreur les académiciens d Anville
et Gibert, qui les ont pris pour le lac de Moeris.
Le Bahr-Yousef, que l’on a toujours représenté, dans les cartes modernes de
1 Egypte, comme un canal creusé sur des lignes droites dans une étendue d environ
trente-six lieues, depuis Meylaouy jusqu’à son entrééldans le Fayoum, n est autre
chose qu’une ancienne branche du Nil, tout aussi sinueuse que lu i, et qui présente
aujourd’hui une largeur d’environ 100 mètres. La plus grande largeur que je
lui aie trouvée est de 14o mètres entre le village d’el-Hazé et celui de Menqatyn, où
je l’ai mesuré. Cette branche côtoie le piecfc de la chaîne Libÿque, nomme le fleuve
côtoie celui de la chaîne Arabique , et vient porter ses' eaux dans lé' Fayoum. Partout
son lit est plus bas que la plaine, dont le niveau, .ainsi que je l’ai déjà
observé, est inférieur à celui des eaux du fleuve ; mais, lors de l’inondation, le
Bahr-Yousef communique avec les autres canaux parallèles, et couvre avec eux les
terres qui se trouvent entre lui et le fleuve.
L e nom de Bathen qu’on a improprement donné à un canal, n’est point un
nom propre ; il s’applique généralement à presque tous les canaux qui parcourent
l’intérieur des terres dans la direction du sud au nord (1). On appelle Batlien la
partie des terres située entre le Nil et la chaîne Libyque. Ce mot dérive de l’arabe
Bain, qui signifie milieu, ventre. C’est ainsi que l’on a traduit par les mots Ventre
de la Vache la pointe du Delta où les deux branches de Damiette et de Rosette
se séparent, pointe que les Arabes appellent Batn el-Baqarah.
( t ) Voye^ le' M émoirç sur le lac de Moeris, Antiquités.M'¿/noires , tom. 1 ; pag. 7 3 <
Un
g l
ii |lII M
11 i F G -ï
l
p[ 1i
D E B E N Y - S O U E Y F E T D U F A Y O UM . . 2 0 1
Un nom plus particulier, quoique plusieurs canaux Je portent, est celui de
Fyâd, qui distingue les grands bathen des petits. Le plus grand de tous ces Fyâd
Batlien, le seul qui ait pu induire en erreur Grangèr, le P. Sicard et d’Anville,
n’a pas plus de six lieues de longueur. Son origine sur le Nil est au village de
Cheykh-Zayât, à environ douze lieues au sud de Beny Soufcyf II prend ensuite sbn
cours vers le nord-ouest, passe au nord et à une lieue de Fechn, au bas du village de
Beny-Sâleh ; de là il va se perdre dans les terres, retenu par la digue de Saft-rachyn.
Dans l’inondation, la communication avec le Bahr-Yousef se fait un peu au nord
dû village de Mezourah: Il a environ 36 mètres dans sa plus grande largeur : il n’y
avoit.au moment où je l’ai sondé, le 20 frimaire an 9 [1 1 décembre 1800], qu’environ
}ffl mètre 5 0 centimètres de profondeur d’eau , et sa superficie étoif a
2 îqètres 60’ centimètres au-dessous du niveau de la plaine.
On voit plus au sud un autre Fyâd Bathen, dont l’origine sur le Nil est entre le
village'de Nazlet-Abou-Esné et celui de Qalousaneh. Il passe au pied du village de
Màtâyëh, où il se divise en deux,branches, dont l’une à l’est devient petit bathen, et
se perd, à: dieux lieues de là, dans les terres d’Abou-Girgeh ; l’autre, à l’ouest, communique
pendant l’inondation avec le Bahr-Yousef, au village d’el-Houeh : mais il
n’a pas plus de trois lieues de longueur.
L’arrosement des terres dans la province de Beny-Soueyf s’opère donc, comme
dans toute la haute Egypte, par une irrigation naturelle et par une irrigation artificielle
, avec cetté différence que, dans la partie nord de cette province, la pente à
l’ouest se prolongeant jusqu’à la chaîne Libyque, l’irrigation naturelle a lieu jusqu’au
pied de cette chaîne, tandis "que, dans la partie sud, le profil de la vallée présente
deux plans inclinés, partant l’un des bords du N il, et l’autre des bords de
la branche dite Bahr-Yousef, pour venir former, à leur rencontre dans l’intérieur
des terres, un bas-fond ou cunette qui, conservant les eaux plus long temps que
les,autres parties, porte/par ce motif, le nom de Bahr-Bathen,c’est-a-dire, fleuve
intérieur. Il suit aussi de cette disposition que l’irrigation artificielle n’a lieu
dans la partie nordque.sur la bande de terre rapprochée du N il, tandis que, dans
la partie sud, elle â lieu sur les bords du Nil et sur les bords du Bahr-Yousef.
Les méthodes employées pour ce genre d’irrigation sont simples, et ne varient
que lorsqu’on doit élever l’eau à une plus ou moins grande hauteur. Ces méthodes
sont à peu près les mêmes dans toute l’Egypte, et ont été décrites par plusieurs
de mes collègues ; mais j ai fait faire en ma présence des expériences dont on ne
sera peut-être pas fâché de trouver ici les résultats.
La méthode la plus simple de toutes est celle qui est représentée Jig. 4iP l m.
vol;II. Deux hommes adossés à une butte de terre soutiennent avec quatre cordes
et balancent un panier d osier, fait en forme de calotte sphérique et recouvert de
cuir : ils puisent 1 eau avec ce panier à la volée, et la jetent par le même mouvement
sur les terres. Le balancement, la prise et le jet de l’eau sont réglés par-un
chant particulier, dont on peut voir le mode dans le Mémoire de M. Villoteau
sur 1 état actuel de l’art musical en Egypte (1). Cette méthode n’est presque pas
( 0 Voye^ État moderne, Mémoires, tom. I , pag,-733.
Ê . M . T O M E IL Ce