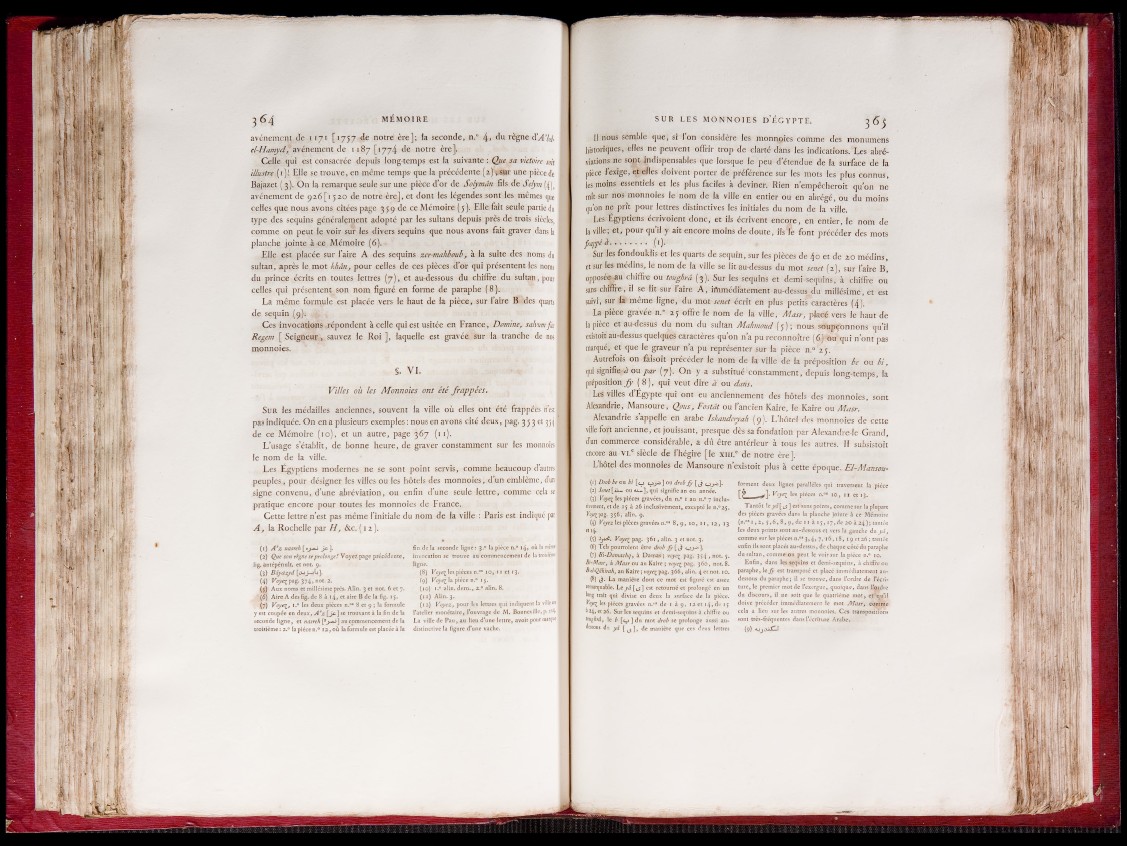
avcneinent de 1 171 [1 7 5 7 de notre ère]; la seconde, n." 4 > du règne d'A ’id-
el-Hamyd/avènement de 1 187 [1774 de notre ère].
Celle qui est consacrée depuis long temps est la suivante : Qiie sa victoire ¡oit
illustre (1)! Elle se trouve, en même temps- que la précédente (aj-çsuv une pièce de
Bajazet (3). On la remarque seule sur une pièce d’or de Solymân fils de Selym (4),
avènement de 926 [1 y20 de notre ère], et dont les légendes sont les mêmes que
celles que nous avons citées page 3 y 9 de ce Mémoire ( y ). Elle fait seule partie du
type des sequins généralement adopté par les sultans depuis près de trois siècles,
comme on peut le voir sur les divers sequins que nous avons fait graver dans la
planche jointe à ce Mémoire (6).» !
Elle est placée sur l’aire A des sequins zcr-mahboub, à la suite des noms du
sultan, après le mot khân, pour celles de ces pièces d’or qui présentent les noms
du prince écrits en toutes lettres (7 ), et au-dessous du chiffre du sultan, pour
celles qui présentent son nom figuré en forme de paraphe (8).
La même formule est placée vers le haut de la pièce, sur faire B odes quarts
de sequin (9}.
Ces invocations répondent à celle qui est usitée en France, Domine, salvumf,tt
Regern [ Seigneur , sauvez le Roi ], laquelle est gravée sur la tranche de nos
monnoies.
§. VI.
Villes où les Monnoies ont été frappées.
Sur les médailles anciennes, souvent la ville où elles ont été frappées ri’estl
pas indiquée. On en a plusieurs exemples : nous en avons cité deux, pag. 3y 3 et 35] I
de ce Mémoire (10), et un autre, page 367 (11).
L ’usage s’établit, de bonne heure, de graver constamment sur les monnoiesl
le nom de la ville.
Les Égyptiens modernes ne se sont point servis, comme beaucoup d’autresI
peuples, pour désigner les villes ou les hôtels des monnoies, d’un emblème, dun
signe convenu, d’une abréviation, ou enfin d’une seule lettre, comme cela sel
pratique encore pour toutes les monnoies de France.
Cette lettre n’est pas même l’initiale du nom de la ville : Paris est indiqué pari
A , la Rochelle par H , &c. (12).
(1) A * z nasreh [mmi je . ]. fin de la seconde ligne: 3.0 la pièce n.® 14» où la merael
(2) Que son règne se prolonge! Voyez page précédente, invocation se trouve au commencement de la troisième I
lig. antépénult. et not. 9. ligne.
(3) Bâyazyd [oj^-sÇ]. (8) Voyez les pièces n.°* j o , 11 et 13.
(4) Voyez pag. 374, not. 2. fç) Voyez la pièce n.® 15.
(5) Aux noms et millésime près. Afin. 3 et not. 6 et 7. (10) 1.® afin, dern., 2.® afin. 8.
(6) AireA desfig. de 8 à 14, et aire B de la fig. 15. (11) Alin. 3.
(7) Voyez» i.° les deux pièces n.°* 8 et 9 ; la formule (12) Voyez, pour les lettres qui indiquent la ville oui
y est coupée en deux, A ’z Li* ] se trouvant à la fin de la l’atelier monétaire, l’ouvrage de M. Bonneville, p. wij. I
seconde ligne, et nasreh au commencement de la La ville de Pau, au fieu d’une lettre, avoit pour marque 1
troisième : 2.0 la pièce n.® 12, où la formule est placée à la distinctive la figure d’une vache.
[1 nous semble que, si Ion considère les monnaies comme des monumens
historiques, elles ne peuvent offrir trop de clarté dans les indications. Les abréviations
ne sont indispensables que lorsque le peu d’étendue de la surface de la
piece 1 exige, et elles doivent porter de préférence sur les mots les plus connus,
les moins essentiels et les plus faciles à deviner. Rien n’empécheroit qu’on ne
mît sur nos monnoies le nom de la ville en entier ou en abrégé, ou du moins
qu’on ne prît pour lettres distinctives les initiales du nom de la ville.
Les Égyptiens écrivoient donc, et ils écrivent encore, en entier, le nom de
la ville; et, pour qu’il y ait encore moins de doute, ilsŸe font précéder des mots
frappl à ................. (i).
Sur les fondouklis et les quarts de sequin, sur les pièces de 4o et de 20 médins,
et sur les médins, le nom de la ville se lit au-dessus du mot senet (2), sur faire B,
opposé^au chiffre ou toughrâ (3). Sur les sequins et demi-sequins, à chiffre ou
sans chiffre, il se lit sur laire A , rftimediatement au-dessus du millésime, et est
suivi, sur la même ligne, du mot senet écrit en plus petits caractères (4).
La pièce gravée n.” 25 offre le nom de la ville, Masr, placé vers le haut de
la piece et au-dessus du nom du sultan Mahmoud (y ); nous soupçonnons qu’il
existoit au-dessus quelques caractères qu on n a pu reconnoître (6) ou' qui n’ont pas
marqué, et que le graveur n’a pu représenter sur la pièce n.° '25.
Autrefois on faisoit précéder le nom de la ville de la préposition be ou b i,
qui signifie-.« ou par (7). On y a substitue constamment, depuis long-temps, la
préposition jy ( 8 ), qui veut dire à ou dans.
Les villes dÉgypte qui ont eu anciennement des hôtels des monnoies, sont
Alexandrie, Mansoure, Qous, Postât ou I ancien Kaire, le Kaire ou Masr.
Alexandrie s appelle en arabe Iskandeiyah ( 9 ). L hôtel des monnoies de cette
ville foit ancienne, et jouissant, presque dès sa fondation par Aïexandre-Je Grand,
dun commerce considérable, a du etre antérieur à tous les autres. Il subsistoit
encore au v i.' siècle de l’hégire [le xm.e de notre ère].
L’hôtel des monnoies de Mansoure n’existoit plus à cette époque. El-Mansou-
(1) Drob be ou bi [<_, c j> * ]ou drob jy [ j forment deux lignes parallèles qui traversent la pièce
(2) JVnêf[*À-» ou qui signifie an ou année. rô> 1 t/- i ; i .*/ , / j . , <L__—^ • Voyez les 13 pièces n.°* io , n et 13. ) les pièces gravées, du n.® 1 au n.® 7 inclusivement,
et de 15 à 26 inclusivement, excepté le n.®2$. Tantôt le fj ] est sans points, comme sur la plupart
Voyez pag. 356 , afin. 9. des pièces gravées dans la planche jointe à ce Mémoire
(4) Voyez les pièces gravées n.°* 8 ,9 , 10, 1 1 , 12, 13 (n,°*1 » 2» 5>6, 8, 9, de 11 à 1 5 , 1 7 ,de 20 à 24); tantôt
et 14. les deux points sont au-dessous et vers la gauche du yâ,
(s) Voyez PaS* » a^'n- 3 et not- 3* comme sur les pièces n.°* 3,4, 7,*16,18, 19 e t26 ; tantôt
(6) Tels pourraient être drob / y [d enfin ils sont placés au-dessus, de chaque côté du paraphe
(7) Bi-Damachq, à Damas; voyez Pa§* 354 , not. 5. du sultan, comme on peut le voir sur la pièce n.® 10.
Bi-Masr, à Masr ou au Kaire ; voyez pag. 360, not. 8. Enfin, dans les sequins et demi-sequins, à chiffre ou
B-el-Qahirah, au Kaire; voyez pag. 366, alin. 4 et not. 10. paraphe, \tjÿ est transposé et placé immédiatement au-
(8) jj. La manière dont ce mot est figuré est assez dessous du paraphe; il se trouve, dans l’ordre de l’écriremarquable.
h t yâ [<^] est retourné et prolonge en un turc> Ie premier mot de l’exergue, quoique, dans l’ordre
long trait qui divise en deux la surface de la pièce. du discours, il ne soit que le quatrième mot, etfqu’il
Voyez l°s pièces gravées n.us de 1 à 9, 12 et 14, de 15 doive précéder immédiatement le mot Masr, comme
a24, et 26. Sur les sequins et demi-sequins à chiffre ou cela a fiçu sur les autres monnoies. Ces transpositions
touçhrâ, le b [u>]du mot drob se prolonge aussi au- sonl très-fréquentes dans l’écriture Arabe.
dessous du yâ [ ^ ] , de manière que ces deux lettres (9)