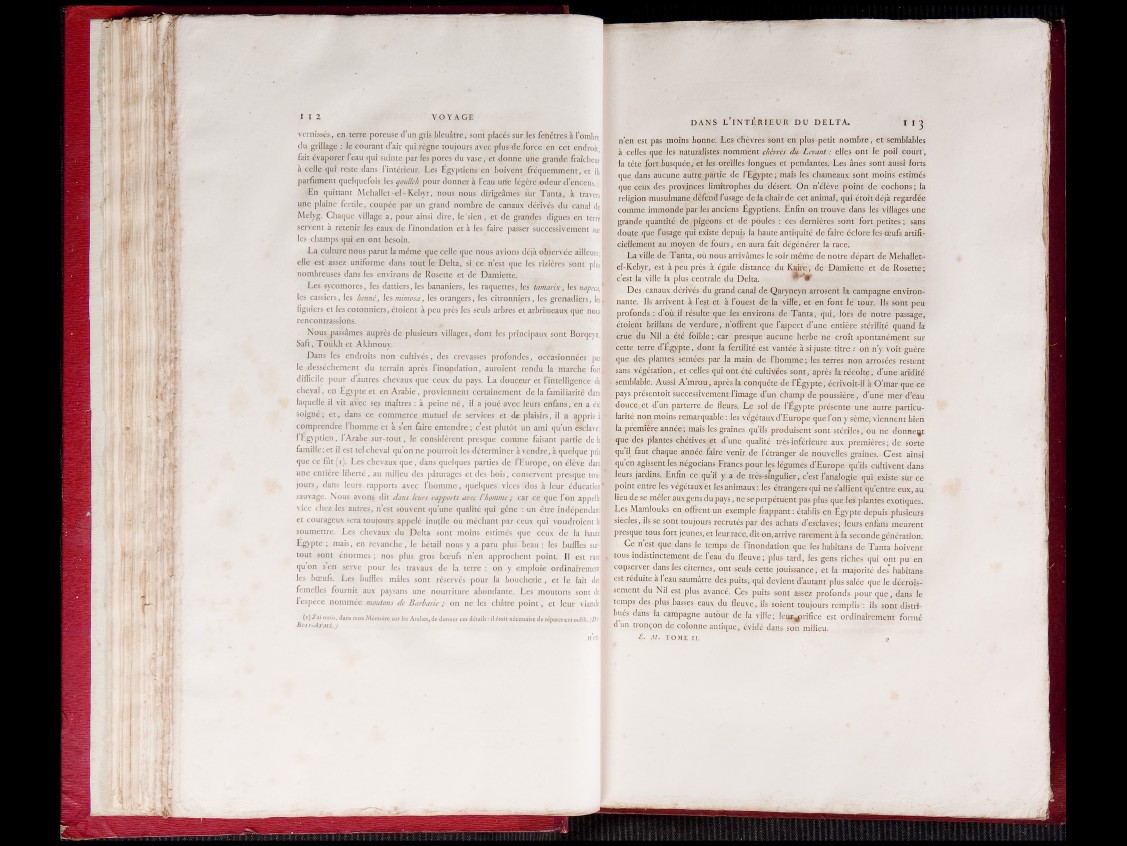
vernissés, en terre poreuse d’un gris bleuâtre, sont placés sur les fenêtres à l’ombre I
du grillage : le courant d’air qui règne toujours avec plus de force en cet endroit I
fait évaporer l’eau qui suinte par les pores du vase, et donne une grande fraîcheur I
à celle qui reste dans l’intérieur. Les Égyptiens en boivent fréquemment, et ils I
parfument quelquefois les qoiilleh pour donner à l’eau une légère odeur d’encens. I
En quittant Mehallet-el-Kebyr, nous nous dirigeâmes sur Tanta, à travers!
une plaine fertile, coupée par un grand nombre de canaux dérivés du canal de,
Melyg. Chaque village a, pour ainsi dire, le sien, et de grandes digues en terre!
servent a retenir les eaux de l’inondation et à les faire passer successivement sut|
les -champs qui en ont besoin.
La culture nous parut la même que celle que nous avions déjà observée ailleurs;!
elle est assez uniforme dans tout le Delta, si ce n’est que les rizières sont plus
nombreuses dans les environs de Rosette et de Damiette.
Les sycomores, les dattiers, les bananiers, les raquettes, les tamarix, les napeca, |
les cassiers, les henné, les mimosa, les orangers, les citronniers, les grenadiers, les!
figuiers et les cotonniers, étoient à peu près les seuls arbres et arbrisseaux que nous|
rencontrassions.
Nous passâmes auprès de plusieurs villages, dont les principaux sont Borqeyn,!
Sait, Toukli et Akhnouy.
Dans les endroits non cultivés, des crevasses profondes, occasionnées par.
le dessèchement du terrain après l’inondation, auroient rendu la marche fort!
difficile pour d’autres chevaux que ceux du pays. La douceur et l’intelligence du
cheval, en Egypte et en Arabie, proviennent certainement de la familiarité dam
laquelle il vit avec ses maîtres : à peine né, il a joué avec leurs enfans, en a été
soigné; e t, dans ce commerce mutuel de services et de plaisirs, il a appris à !
comprendre l’homme et à s’en faire entendre ; c’est plutôt un ami qu’un esclave: 1 Egyptien, 1 Arabe sur-tout, le considèrent presque comme faisant partie de li
famille; et il est tel cheval qu’on ne pourrait les déterminer à vendre, à quelque prit'
que ce fut(i). Les chevaux que, dans quelques parties de l’Europe, on élève dans
une entière liberté, au milieu des pâturages et des bois, conservent presque tou-:
jours, dans leurs rapports avec l’homme, quelques vices dus à leur éducation'
sauvage. Nous avons dit dans leurs rapports avec l ’homme ; car ce que l’on appelle!
vice chez les autres, n’est souvent qu’une qualité qui gêne : un être indépendant
et courageux sera toujours appelé inutile ou méchant par ceux qui voudraient l e !
soumettre. Les chevaux du Delta sont moins estimés que ceux de la haute
Egypte ; mais, en revanche, le bétail nous y a paru plus beau : les buffles sur-!
tout sont énormes ; nos plus gros boeufs n’en approchent point. Il est rare!
quon s en serve pour les travaux de la terre : on y emploie ordinairement!
les boeufs. Les buffles mâles sont réservés pour la boucherie , et le lait des!
femelles fournit aux paysans une nourriture abondante. Les moutons sont de 1 espèce nommée moutons de Barbarie ; on ne les châtre po in t, et leur viande I
(i) J ai omis, dans mon Mémoire sur les Arabes, de donner ces détails: il étoit nécessaire de réparer cet oubli. (Du I
B o is -A y m L )
n’en est pas moins bonne. Les chèvres sont en plus petit nombre, et semblables
à celles que les naturalistes nomment chèvres du Levant : elles ont le poil court,
la tête fort busquée, et les oreilles longues et pendantes. Les ânes sont aussi forts
que.dans aucune autre partie de l’Egypte; mais les chameaux sont moins estimés
que ceux des provinces limitrophes du désert. On n’élève point de cochons ; la
religion musulmane défend l’usage de la chair de cet animal, qui étoit déjà regardée
comme immonde par les anciens Égyptiens. Enfin on trouve dans les villages une
grande quantité de pigeons et de poulés : ces dernières sont fort petites ; sans
doute que l’usage qui existe depuis la haute antiquité de faire éclore les oeufs artificiellement
au moyen de fours, en aura fait dégénérer la race.
La ville de Tanta, où nous arrivâmes le soir même de notre départ de Mehallet-
el-Kebyr, est à peu près à égale distance du K â r e , de Damiette et de Rosette ;
c’est la ville la plus centrale du Delta. w*9
Des canaux dérivés du grand canal de Qaryneyn arrosent la campagne environnante.
Ils arrivent à l’est et à l’ouest de la ville, et en font le tour. Ils sont peu
profonds ; d’où il résulte que les environs de Tanta, qui, lors de notre passage,
étoient brillans de verdure, n’offient que l'aspect d’une entière stérilité quand la
crue du Nil a été foible ; car presque aucune herbe ne croît spontanément sur
cette terre d’Egypte, dont la fertilité est vantée à si juste titre : on n’y voit guère
que des plantes semees par la main de I homme ; les terres non arrosées restent
sans végétation, et celles qui ont été cultivées sont, après la récolte, d’une aridité
semblable. Aussi Amrou, après la conquête de l’Egypte, écrivoit-il à O mar que ce
pays presentoit successivement 1 image d’un champ de poussière, d’uné mer d’eau
douce .et dun parterre de fleurs. Le sol de 1 Egypte présente une autre particularité
non moins remarquable : les végétaux d’Europe que l’on y sème, viennent bien
la première année; mais les graines qu’ils produisent sont stériles, ou ne donnent
que des plantes chetives et dune qualité très-inférieure aux premières; de sorte
qu il faut chaque année faire venir de l’én-anger de nouvelles graines. C ’est ainsi
quen agissent les negocians Francs pour les légumes d’Europe qu’ils cultivent dans
leurs jardins. Enfin ce qu il y a de très-singulier, c’est l’analogie qui existe sùr ce
point entre les végétaux et les animaux : les étrangers qui ne s’allient qu’entre eux, au
lieu de se meler aux gens du pays, ne se perpétuent pas plus que les plantes exotiques.
Les Mamlouks en offrent un exemple frappant : établis en Egypte depuis plusieurs
siècles, ils se sont toujours recrutés par des achats d’esclaves; leurs enfans meurent
piesque tous fort jeunes, et leur race, dit-on, arrive rarement à la seconde génération.
Ce n est que dans le temps de 1 inondation que les habitans de Tanta boivent
tous indistinctement de leau du fleuve; plus tard, les gens riches qui ont pu en
copserver dans les citernes, ont seuls cette jouissance, et la majorité des* habitans
est réduite à 1 eau saumâtre des puits, qui devient d’autant plus salée que le décroissement
du Nil est plus avance. Ces puits sont assez profonds pour que, dans le
temps des plus basses eaux du fleuve, ils soient toujours remplis : ils sont distribués
dans la campagne autour de la ville; leiuqgmfîce est ordinairement formé
dun tronçon de colonne antique, évidé dans son milieu