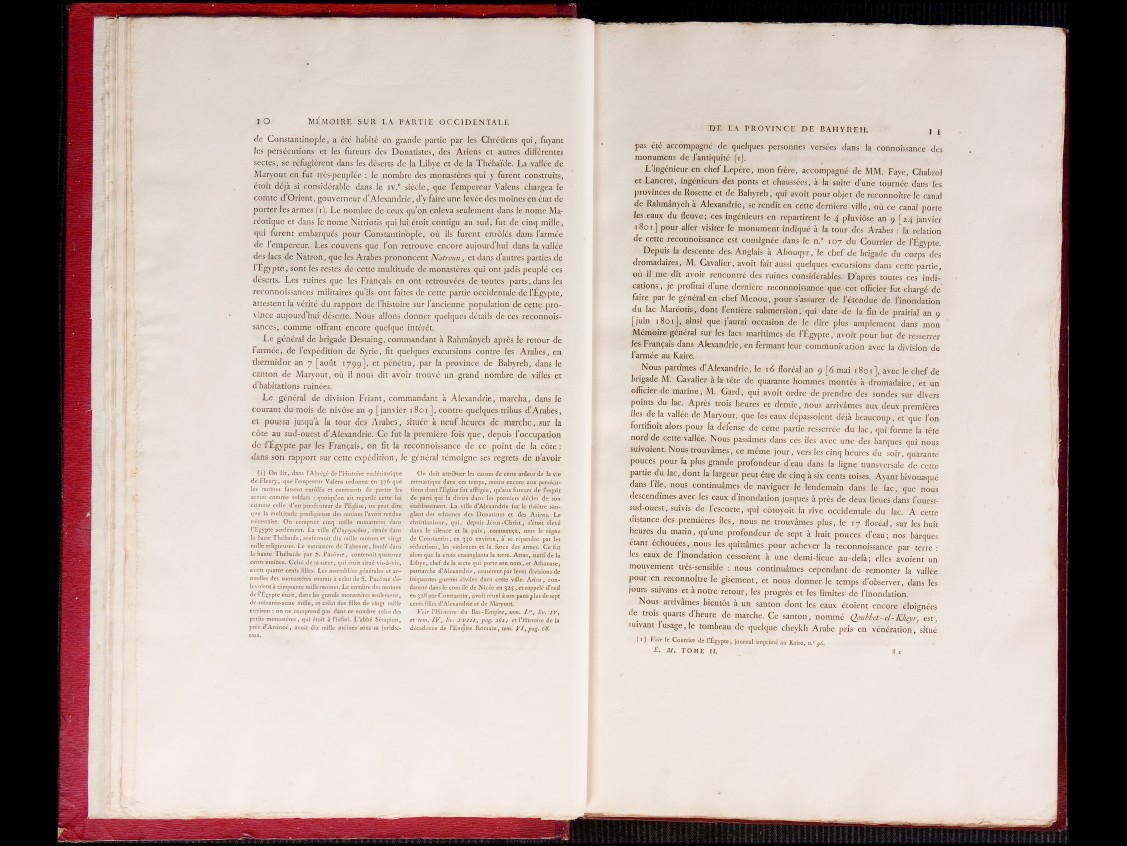
<Je Constantinople, a été habité en grande partie par les Chrétiens qui, fuyant
les persécutions et les fureurs des Donatistes, des Ariens et autres différentes
sectes, se réfugièrent dans les déserts de la Libye et de la Thébaïde. La vallée de
Maryout en fut très-peuplée : le nombre des monastères qui y furent construits,
étoit déjà si considérable dans le iv.c siècle, que l’empereur Valens chargea le
comte d Orient, gouverneur d’Alexandrie, d’y faire une levée des moines en état de
porter les armes (i). Le nombre de ceux qu’on enleva seulement dans le nome Ma-
réotique et dans le nome Nitriotis qui lui étoit contigu au sud, fut de cinq mille,
qui furent embarqués pour Constantinople, où ils furent enrôlés dans l’armce
de 1 emperëur. Les couvens que l’on retrouve encore aujourd’hui dans la vallée
des lacs de Natron, que les Arabes prononcent Natroun, et dans d’autres parties de
1 Egypte, sont les restes de cette multitude de monastères qui ont jadis peuplé ces
déserts. Les ruines que les Français en ont retrouvées de toutes parts, dans les
reconnoissances militaires qu’ils ont faites de cette partie occidentale de l’Égypte,
attestent la vérité du rapport de l’histoire sur l’ancienne population de cette province
aujourd’hui déserte. Nous allons donner quelques détails de ces reconnoissances,
comme offrant encore quelque intérêt.
Le général de brigade Destaing, commandant à Rahmânyeh après le retour de
l’armée, de l’expédition de Syrie, fit quelques excursions contre les Arabes, en
thermidor an 7 [août 1799], et pénétra, par la province de Bahyreh, dans le
canton de Maryout, où il nous dit avoir trouvé un grand nombre de villes et
d’habitations ruinées.
L e général de division Friant, commandant à Alexandrie, marcha, dans le
courant du mois de nivôse an 9 [janvier 1801 ], contre quelques tribus d’Arabes,
et poussa jusqu’à la tour des Arabes, située à neuf heures de marche, sur la
côte au sud-ouest d’Alexandrie. Ce fut la première fois que, depuis l’occupation
de l’Egypte par les Français, on fit la reconnoissance de ce point de la côte :
dans son rapport sur cette expédition, le général témoigne ses regrets de n’avoir
(1) On lit, dans FAbrégé de l’Histoire ecclésiastique
On doit attribuer les causes de cette ardeur de la vie
de Fleury, que l’empereur Valens ordonna en 376 que
monastique dans ces temps, moins encore aux persécutions
les moines fussent enrôlés et contraints de porter les
dont l’Eglise fut affligée, qu’aux fureurs de l’esprit
armes comme soldats : quoiqu’on ait regardé cette loi
de parti qui la divisa dans les premiers siècles de son
comme celle d’un persécuteur de l’Église, on peut dire
établissement. La ville d’Alexandrie fut le théâtre sanglant
que la multitude prodigieuse des moines I’avoit rendue
des schismes des Donatistes et des Ariens. Le
nécessaire. On comptoit cinq mille monastères dans
christianisme, qui, depuis Jésus-Christ, s’étoit élevé
l’Egypte seulement. La ville SOxyrynchus, située dans
dans le silence et la paix, commença, sous le régne
la basse Thébaïde, renfermoit dix mille moines et vingt
de Constantin, en 330 environ, à se répandre par les
mille religieuses. Le monastère de Tabenne, fondé dans
séductions, lés violences et la force des armes. Ce fut
la haute Thébaïde par S. Pacôme, contenoit quatorze
alors que la croix ensanglanta la terre. Arius, natif de la
cents moines. Celui de sa soeur, qui étoit situé vis-à-vis,
Libye, chef de la secte qui porte son nom, et Athanase,
avoir quatre cents filles. Les assemblées générales et an-
patriarche d’Alexandrie, causèrent par leurs divisions de
1 nuelles des monastères soumis à celui de S. Pacôme s’é-
fréquentes guerres civiles dans cette ville. Arius, condamné
levoient à cinquante mille moines. Le nombre des moines
dans le concile de Nicée en 325, et rappelé d’exil
de l’Egypte étoit, dans les grands monastères seulement,
en 328 par Constantin, avoit réuni àson parti plus de sept
de soixante-seize mille, et celui des filles de vingt mille
cents filles d’Alexandrie et de Maryout.
environ : on ne comprend pas dans ce nombre celui des
Voir l’Histoire du Bas-Empire, tom. liv. I V ,
perits monastères, qui étoit à l’infini. L’abbé Sérapion,
prés d’Arsinoé, avoit dix mille moines sous sa juridiction.
et tom. I V , liv. X V I I I , pag. 262/ et l’Histoire de l,a
décadence de l’Empire Romain, tom. V I , pag. 68.
pas été accompagné Je quelques personnes versées dans la connoissance des
monumens de l’antiquité (i).
L ’ingénieur en chef Lepère, mon frère, accompagné de MM. Faye, Chabrol
et Lancret, ingénieurs des ponts et chaussées, a la suite d une tournée dans les
provinces de Rosette et de Bahyreh, qui avoit pour objet de reconnoître le canal
de Rahmânyeh à Alexandrie, se rendit en cette dernière ville, où ce canal porte
les eaux du fleuve; ces ingénieurs en repartirent le 4 pluviôse an 9 [24 janvier
1801 ] pour aller visiter le monument indiqué à la tour des Arabes : la relation
de cette reconnoissance est consignée dans le n.° 107 du Courrier de l’Égypte.
Depuis la descente des. Anglais a Abouqyr, le chef de brigade du corps des
dromadaires, M. Cavalier, avoit fait aussi quelques »excursions dans cette partie,
où il me dit avoir rencontré des ruines considérables. D ’après toutes ces indications
, je profitai d’une dernière reconnoissance que cet officier fut chargé de
faire par le général en chef Menou, pour s’assurer de l’étendue de l’inondation
du lac Maréotis, dont l’entière submersion, qui date de la fin de prairial an 9
[juin 1801], ainsi que j aurai occasion de le dire plus amplement dans mon
Mémoire général sur les lacs maritimes de l’Égypte, avoit pour but de resserrer
les Français dans Alexandrie, en fermant leur communication avec la division de
l’armée au Kaire.
Nous partîmes d’Alexandrie, le 16 floréal an 9 [6 mai 1801], avec le chef de
brigade M. Cavalier à la tête de quarante hommes montés à dromadaire, et un
officier de marine, M. Gard, qui avoit ordre de prendre des sondes sur divers
points du lac. Apres trois heures et demie, nous arrivâmes aux deux premières
tles de la vallée de Maryout, que les eaux dépassoient déjà beaucoup, et que l’on
fortifioit alors.pour la défense de cette partie resserrée du lac, qui forme la tête
nord de cette vallée. Nous passâmes dans ces îles avec une des barques qui nous
suivoient. Nous trouvâmes, ce même jour, vers les cinq heures du soir, quarante
pouces pour la plus grande profondeur d’eau dans la ligne transversale de cette
partie du lac, dont la largeur peut être de cinq à six cents toises. Ayant bivouaqué
dans lîle, nous continuâmes de naviguer le lendemain dans le lac, que nous
descendîmes avec les eaux d inondation jusqties à près de deux lieues dans l’ouest-
sud-ouest, suivis de l’escorte, qui côtoyoit la rive occidentale du lac. A Cette
distance des premières îles, nous ne trouvâmes plus, le 17 floréal, sur les huit
heures du matin, qu une profondeur de sept à huit pouces d’eau; nos barques
étant échouées, nous les quittâmes pour achever la reconnoissance par terre :
les eaux de 1 inondation cessoient à une demi-lieue au-delà; elles avoient un
mouvement très-sensible : nous continuâmes cependant de remonter la vallée
pour -en reconnoître le gisement, et nous donner le temps d’observer, dans les
jours suivans et à notre retour, les progrès et les limites de l’inondation.
Nous-arrivâmes bientôt à un santon dont les eaux étoient encore éloignées
de trois quarts d’heure de marche. Ce santon, nommé Qoubbet-el-Kbeyr, est,
suivant 1 usage, le tombeau de quelque cheykh Arabe pris en vénération, situé
( 1 ) Voir le Courrier de i’Égypte, journal imprimé au Kaire, n.° $6.
Ê . M . T O M E I I . • B a