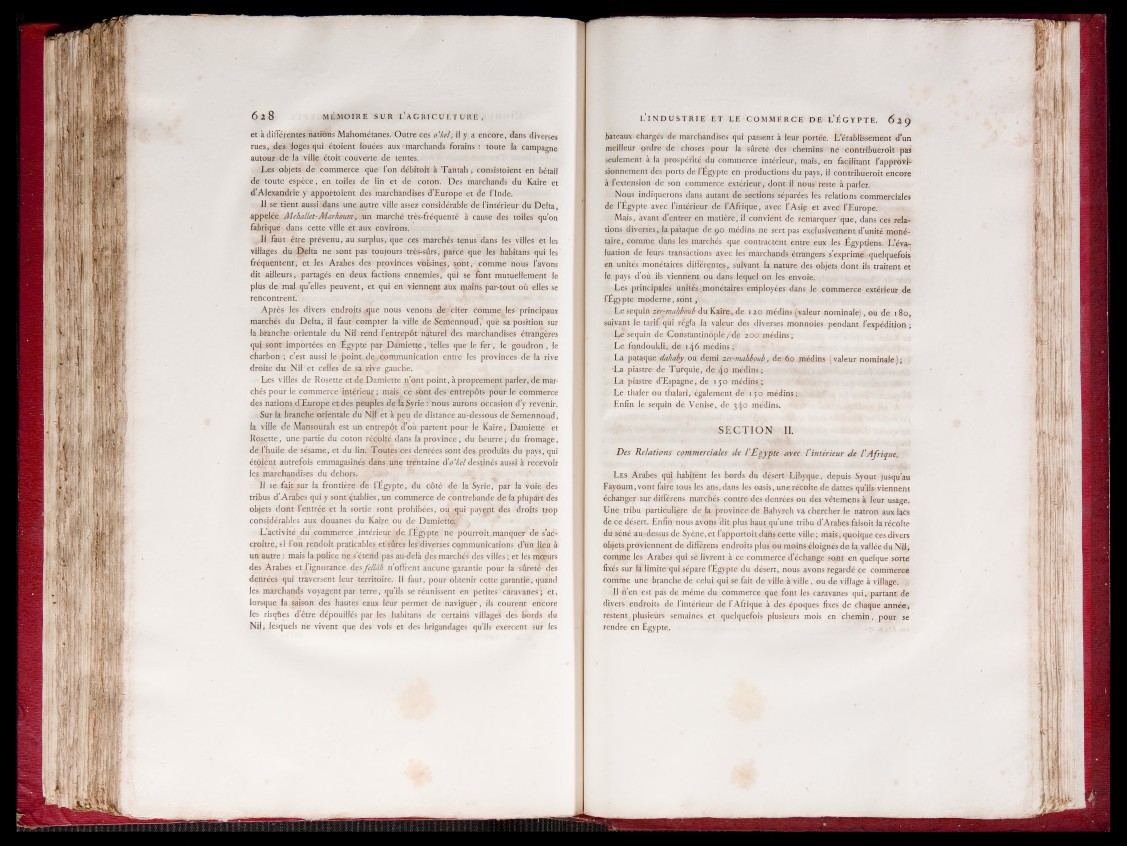
et à différentes nations Mahométanes. Outre ces o'ket, il y a encore, dans diverses
rues, des loges qui étoient louées aux marchands forains : toute la campagne
autour de la ville étoit couverte de tentes.
Les objets de commerce que l’on débitoit à Tantah, consistoient en bétail
de toute espèce, en toiles de lin et de coton. Des marchands du Kaire et
d’Alexandrie y apportoient des marchandises d’Europe et de l'Inde.
II se tient aussi dans une autre ville assez considérable de l’intérieur du Delta,
appelée Meliallet-Marhoum, un marché très-fréquenté à cause des toiles qu’on
fabrique dans cette ville et aux environs.
Il faut être prévenu, au surplus, que ces marchés tenus dans les villes et les
villages du Delta ne sont pas toujours très-sûrs, parce que les habitans qui les
fréquentenr, et les Arabes des provinces voisines, sont,- comme nous l’avons
dit ailleurs, partagés en deux factions ennemies, qui se font mutuellement le
plus de mal quelles peuvent, et qui en viennent aux mains par-tout où elles se
rencontrent.
Après les divers endroits .que nous venons de citer comme les principaux
marchés du Delta, il faut compter la ville de Semennoud' quë sa position sur
la branche orientale du Nil rend l’entrepôt naturel des marchandises étrangères
qui sont importées en Egypte par Damiette, telles que le fe r , le goudron , le
charbon ; c’est aussi le point de. communication entre les provinces de la rive
droite du Nil et celles de sa rive gauche.
Les villes de Rosette et de Damiette n’ont point, à proprement parler, de marchés
pour le commerce intérieur ; mais ce sont des entrepôts pour le commerce
des nations d’Europe et des peuples de la Syrie : nous aurons occasion d’y revenir.
Sur la branche orientale du Nil et à peu de distance au-dessous de Semennoud,
la ville de Mansourah est un entrepôt d’où partent pour le Kaire, Damiette et
Rosette, une partie du coton réçolté dans la province, du beurre ; du fromage,
de l’huile de sésame, et du lin. Toutes ces denrées sont des produits du pays, qui
étoient autrefois emmagasinés dans une trentaine d’o'kel destinés aussi à recevoir
les marchandises du dehors.
Il se fait sur la frontière de l’Egypte, du côté de la Syrie, par la voie des
tribus d’Arabes qui y sont établies, un commerce de contrebande de la plupart des
objets dont l’entrée et la sortie sont prohibées, ou qui payent des droits trop
considérables aux douanes du Kaire ou de Damiette;
L ’activité du commerce intérieur de l’Egypte ne pourrait manquer de s’accroître,
si l’on rendoit praticables et sûres les diverses communications d’un lieu à
un autre ; mais la police ne s’étend pas au-delà des marchés des villes ; et les moeurs
des Arabes et l’ignorance des fellâh n’offrent aucune garantie pour la sûreté des
denrées qui traversent leur territoire. II faut, pour obtenir cette garantie, quand
les marchands voyagent par terre, qu’ils se réunissent en petites caravanes ; et,
lorsque la saison des hautes eaux leur permet de naviguer, ils courent encore
les risqfies d’être dépouillés par les habitans de certains villages des bords du
Nil, lesquels ne vivent que des vois et des brigandages qu’ils exercent sur les
bateaux charges de marchandises qui passent à leur portée. L’établissement d’un
meilleur ordre de choses pour la sûreté des chemins ne contribueroit pas
seulement à la prospérité du commerce intérieur, mais, en facilitant l’apprdvK'
sionnement des ports de l’Egypte en productions du pays, il contribueroit encore
à l’extension de son commerce extérieur, dont il nous reste à parler.
Nous indiquerons dans autant de sections séparées les relations commerciales
de l’Egypte avec l’intérieur de l’Afrique, avec l’Asip et avec l’Europe.
Mais, avant d’entrer en matière, il convient de remarquer que, dans ces relations
diverses, la pataque de 90 médins ne sert pas exclusivement d’unité monétaire,
comme dans les marchés que contractent entre eux les Égyptiens. L ’évaluation
de leurs transactions avec les marchands étrangers s’exprime quelquefois
en unités monétaires différentes, suivant la nature des objets dont ils traitent et
le pays d’où ils viennent ou dans lequel on les envoie,
Les principales unités monétaires employées dans le commerce extérieur de
l’Egypte moderne, sont,
Le sequin zerrmahboub du Kaire, de 120 médins (valeur nominale), ou de 180,
suivant le tarif qui régla la valeur des diverses monnoies pendant l’expédition ;
Le sequin de Constantinople,«de 200 médins;
Le fondoukli, de 146 médins;
La pataque daliaby ou demi zer-mahboub, de 60 médins (valeur nominale);
•La piastre de Turquie, de 4o médins ;
La piastre d’Espagne, de 1 jo médins;
Le thaler ou thalari, également de 1 50 médins;
Enfin le sequin de Venise, de 340 médins.
S E C T I O N II.
Des Relations commerciales de l'E g yp te avec l ’intérieur de l'A frique.
Les Arabes qui habitent les bords du désert Libyque, depuis Syout jusqu’au
Fayoum, vont faire tous les ans, dans les oasis, une récolte de dattes qu’ils-viennent
échanger sur différens marchés contre des denrées ou des vêtemens à leur usage.
Une tribu particulière de la province de Bahyreh va chercher le natron aux lats
de ce désert. Enfin nous avons dit plus haut qu’une tribu d’Arabes faisoit la récolte
du séné au-dessus de Syène, et l’apportoit dans cette ville ; mais, quoique ces divers
objets proviennent de différens endroits plus ou moins éloignés de la vallée du Nil,
comme les Arabes qui se livrent à ce commerce d’échange sont en quelque sorte
fixés sur la limite qui sépare l’Egypte du désert, nous avons regardé ce commerce
comme une branche de celui qui se fait de ville à ville , ou de village à village.
Il n’en est pas de même du commerce que font les caravanes qui, partant de
divers endroits de l’intérieur de l’Afrique à des époques fixes de chaque année,
restent plusieurs semaines et quelquefois plusieurs mois en chemin, pour se
rendre en Egypte.