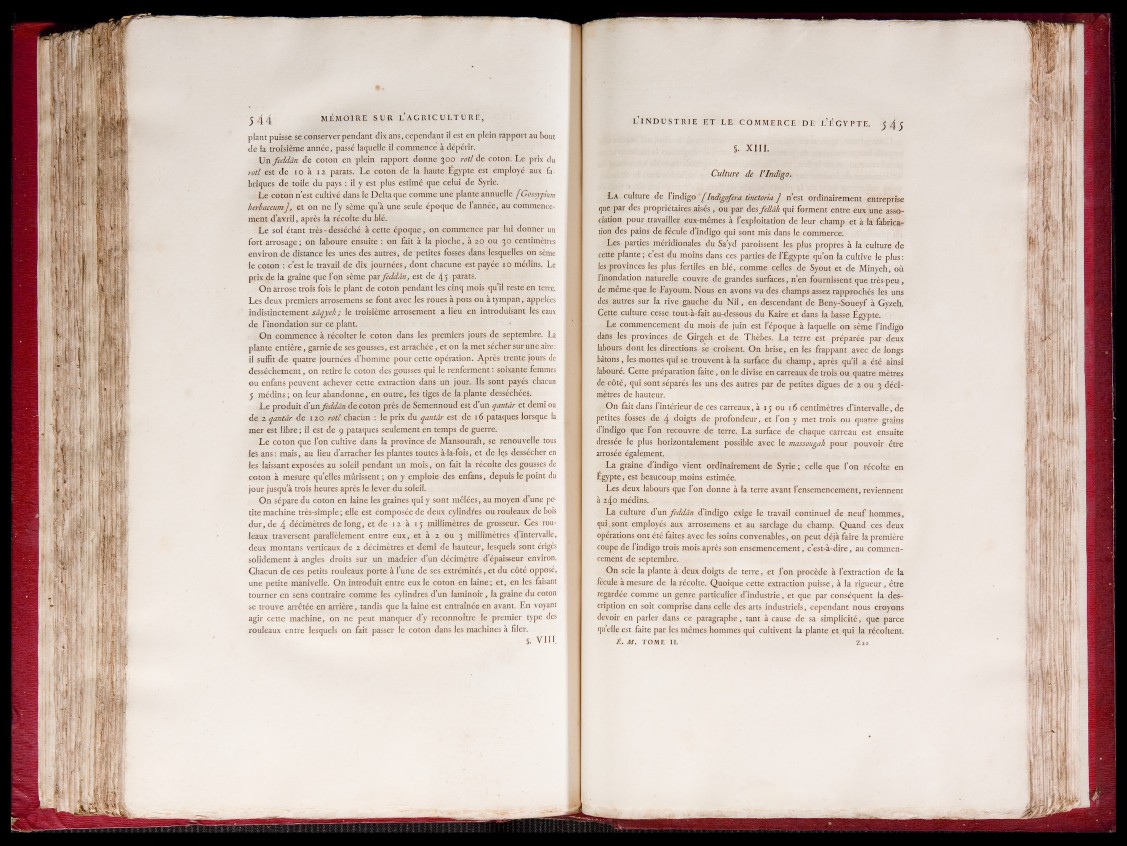
plant puisse se conserver pendant dix ans, cependant il est en plein rapport au bout
de la troisième année, passé laquelle il commence à dépérir.
Un feddân de coton en “plein rapport donne 300 rotl de coton. Le prix du
rotl est de 10 à 12 parats. Le coton de la haute. Egypte est employé aux fabriques
de toile du pays : il y est plus estimé que celui de Syrie.
Le coton n’est cultivé dans le Delta que comme une plante annuelle f Gossypium
herbaceumJ, et on ne l’y sème qu’à une seule époque de 1 année, au commencement
d’avril, après la récolte du blé.
Le sol étant très - desséché à cette époque, on commence par lui donner un
fort arrosage ; on laboure ensuite : on fait à la pioche, à 20 ou 30 centimètres
environ de distance les unes des autres, de petites fosses dans lesquelles on sème
le coton : c’est le travail de dix journées, dont chacune est payée 10 médins. Le
prix de la graine que l’on sème par feddân, est de 4 5 parats.
On arrose trois fois le plant de coton pendant les cinq mois qu’il reste en terre.
Les deux premiers arrosemens se font avec les roues à pots ou à tympan, appelées
indistinctement sâqyeh; le troisième arrosement a lieu en introduisant les eaux
de l’inondation sur ce plant.
On commence à récolter le coton dans les premiers jours de septembre. La
plante entière, garnie de ses gousses, est arrachée, et on la met sécher sur une aire:
il suffit de quatre journées d’homme pour cette opération. Après trente jours de
dessèchement, on retire le coton des gousses qui le renferment : soixante femmes
ou enfans peuvent achever cette extraction dans un jour. Ils sont payes chacun
5 médins; on leur abandonne, en outre, les tiges de la plante desséchées.
Le produit ¿ u n feddân de coton près de Semennoud est d’un qantâr et demi ou
de 2 qantâr de 120 rotl chacun ; le prix du qantâr est de 16 pataquès lorsque la
mer est libre ; il est de 9 pataquès seulement en temps de guerre.
L e coton que l’on cultive dans la province de Mansourah, se renouvelle tous
les ans: mais, au lieu d’arracher les plantes toutes à-la-fois, et de le.s dessécher en
les laissant exposées au soleil pendant un mois, on fait la récolte des gousses de
coton à mesure qu’elles mûrissent ; on y emploie des enfans, depuis le point du
jour jusqu’à trois heures après le lever du soleil.
On sépare du coton en laine les graines qui y sont mêlées, au moyen d’une peL
tite machine très-simple ; elle est composée de deux cylindres ou rouleaux de bois
dur, de 4 décimètres de long, et de 12 à 15 millimètres de grosseur. Ces rouleaux
traversent parallèlement entre eux, et à 2 ou 3 millimètres d’intervalle,
deux montans verticaux de 2 décimètres et demi de hauteur, lesquels sont érigés
solidement à angles droits sur un madrier d’un décimètre d’épaisseur environ.
Chacun de ces petits rouleaux porte à l’une de ses extrémités, et du côté opposé,
une petite manivelle. On introduit entre eux le coton en laine; et, en les faisant
tourner en sens contraire comme les cylindres d’un laminoir , la graine du coton
se trouve arrêtée en arrière, tandis que la laine est entraînée en avant. En voyant
agir cette machine, on ne peut manquer d’y reconnoître le premier type des
rouleaux entre lesquels on fait passer le coton dans les machines à filer.
S. VIII.
HHr '
§. X I I I .
Culture de l ’Indigo.
L a culture de I indigo [Indigofera tinctoria ] n’est ordinairement entreprise
que par des propriétaires aisés , ou par des fellâh qui forment entre eux une association
pour travailler eux-mêmes à l’exploitation de leur champ et à la fabrication
des pains de fécule d’indigo qui sont mis dans le commerce.
Les parties méridionales du Sa’yd paroissent les plus propres à la culture de
cette plante ; c’est du moins dans ces parties de l’Égypte qu’on la cultive le plus :
les provinces les plus fertiles en blé, comme celles de Syout et de Minyeh, où
l’inondation naturelle couvre de grandes surfaces, n’en fournissent que très-peu,
de même que le Fayoum. Nous en avons vu des champs assez rapprochés les uns
des autres sur la rive gauche du N i l, en descendant de Beny-Soueyf à Gyzeh.
Cette culture cesse tout-à-fait au-dessous du Kaire et dans la basse Égypte.
Le commencement du mois de juin est l’époque à laquelle on sème l’indigo
dans les provinces de Girgeh et de Thèbes. La terre est préparée par deux
labours dont les directions se croisent. On brise, en les frappant avec de longs
bâtons, lesmottes qui se trouvent à la surface du champ, après qu’il a été ainsi
laboure. Cette préparation faite, on le divise en carreaux de trois ou quatre mètres
de côté, qui sont séparés les uns des autres par de petites digues de 2 ou 3 décimètres
de hauteur.
On fait dans l’intérieur de ces carreaux, à 1 y ou 16 centimètres d’intervalle, de
petites fosses de 4 doigts de profondeur, et l’on y met trois ou quatre grains
d indigo que 1 on recouvre de terre. La surface de chaque carreau est ensuite
dressée le plus horizontalement possible avec le massougah pour pouvoir être
arrosée également.
La graine d’indigo vient ordinairement de Syrie ; celle que l’on récolte en
Égypte, est beaucoup,moins estimée.
Les deux labours que l’on donne à la terre avant l’ensemencement, reviennent
à z4o médins.
La culture d’un feddân d’indigo exige le travail continuel de neuf hommes,
qui,sont employés aux arrosemens et au sarclage du champ. Quand ces deux
opérations ont été faites avec les soins convenables, on peut déjà faire la première
coupe de 1 indigo trois mois après son ensemencement, c’est-à-dire, au commencement
de septembre.
On scie la plante à deux doigts de terre, et l’on procède à l’extraction de la
fécule à mesure de la récolte. Quoique cette extraction puisse, à la rigueur , être
regardée comme un genre particulier d’industrie, et que par conséquent la description
en soit comprise dans celle des arts industriels, cependant nous croyons
devoir en parler dans ce paragraphe, tant à cause de sa simplicité, que parce
qu elle est faite par les mêmes hommes qui cultivent la plante et qui la récoltent.
É . m . t o m e 11.
jjifl
H i i i l i
i l l i i
A' :
I I I
S i