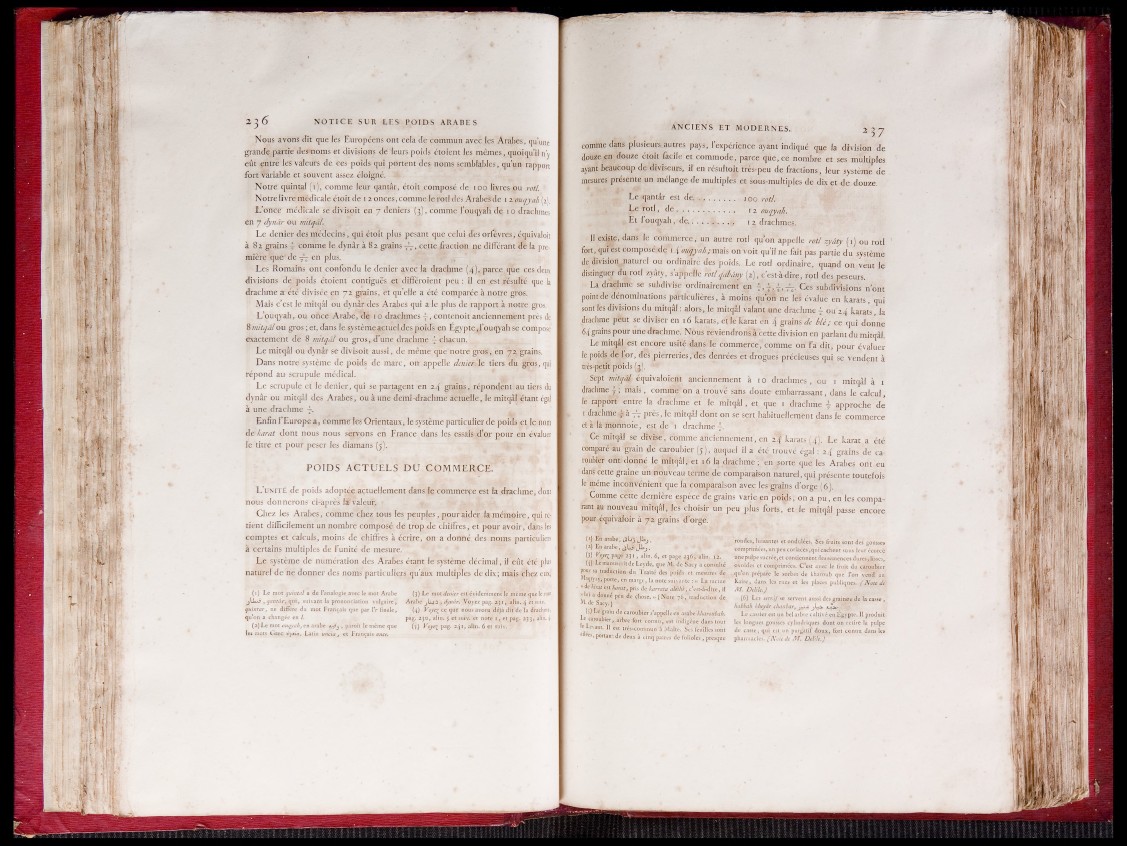
A N C I E N S E T M O D E R N E S . 2 3 7
comme dans plusieuvsLautres pays, l'expérience ayant indiqué que la division de
douze en douze etoit facile et commode, parce que, ce nombre et ses multiples
ayant beaucoup de diviseurs, il en résultoit très-peu de fractions, leur système de
mesures présente un mélange de multiples et sous-multiples de dix et de douze.
Le qantâr est de. ............. joq rotl.
Le rotl, d é .............................. i 2 ouqyah.
E t 1 ouqyah, de. ; .. . .... . jjj 1 2 drachmes.
Il e4&e, dans le commerce, un autre rotl qu’on appelle rotl zyâty (1) ou rotl
fort, qui est composé de" 14 ouqyah; mais on voit qu’il ne fait pas partie du système
de division,,naturel ou ordinaire des poids. Le rotl ordinaire, quand on veut le
distinguo- du rotl zyaty, s appelle rotlqdbâny (2) , c’est-à-dire, rotl des peseurs.
La drachme se subdivise ordinairement en f - . ÿ . - j p Ces subdivisions n’ont
point de dénominations particulières, à moins quon ne les évalue en karats, qui
sont les divisions du mitqal : alors, le mitqâl valant une drachme ~ ou 24 karats la
drachme peut se diviser en 16 karats, et le karat en .{ grains de blé/ ce qui donne
64 grains pour une drachme. Nous reviendrons à cette division en parlantdu mitqâl.
Le mitqal est encore usité dans le commerce, comme on fa dit, pour évaluer
le poids de lo r, dès pierreries, des denrées et drogues précieuses qui se vendent à
très-petit poids (g). ®
Sept mitqâl équivaloient anciennement à 1 o drachmes , ou 1 mitqâl à 1
drachme^; mais, comme on a trouvé sans doute embarrassant, dans le calcul,
le rapport èntre la drachme et le m itqâl, et que 1 drachme - approche de
t drachme ç à près, le mitqâl dont on se sert habituellement dans le commerce
et à la mônnoie, est de 1 drachme^.
Ce mitqâl se divise, comme anciennement, en 24 karats (4). Le karat a été
comparé-au grain de caroubier (y), auquel il a été trouvé égal : 24 grains de caroubier
ont donné le mitqâl, et 16 la drachme ; en .sorte que les Arabes ont eu
dans cette graine un nouveau térme de comparaison naturel, qui présente toutefois
le même inconvénient que la comparaison avec les grains d’orge (6).
Comme cette dernière espèce de grains varie en poids, on a pu, en les comparant
au nouveau mitqâl, les choisir un peu plus forts, et le mitqâl passe encore
pour équivaloir à 72 grains d’orge.
(1) En arabe, J b j J L j .
(4 En arabe, a I o J -L j .
(3) Voyez Page 231, a lin. 6, et page 236, alin. 12.
(4); Le manuscrit de Leyde, que M. de Sacy a consulté
pour sa traduction du Traité des poids et mesures de
Maqryzy, porte, en marge, la note suivante : « La racine
»de Tarât est karat, pris de karrata alei/ti, c’est-à-dire, il
»lui a donne peu de chose. » (Note 76, traduction de
M.de Sacy.) *
(î) Le grain de caroubier s’appelle en arabe kharoubah.
e caroubier, arbre fort connu, est indigène dans tout
le Levant. 11 est très-commun à Malte. Ses feuilles sont
ai ees, portan: de deux à cinq paires de folioles, presque
rondes, luisantes et ondulées. Ses fruits sont des gousses
comprimées, un peu coriaces,qui cachent sous leur écorce
une pulpe sucrée, et contiennent dessemences dures, lisses,
ovoïdes et comprimées. C ’est avec le fruit du caroubier
.qu’on prépare le sorbet de kharoub que l’on vend au
Kaire, dans les rues et les places publiques. ( Note de
M . Delile.)
(6) Les serr.if se servent aussi des graines de la casse,
habbah kheyâr chanbar, i*'.---?
Le cassier est un bel arbre cultivé en Egypte. II produit
les longues gousses cylindriques dont on retire la pulpe
de casse, qui est un purgatif doux, fort connu dans les
pharmacies. ( JVote Je M , D e ll le.)
qgHBraftsgy' - ■ —~ - ;rir!BRw- v •• ■. . - I . ¡' - ».... ■■ y^.‘»r‘ j, •^.'.■' ■ ..
2 3 6 N O T I C E S U R L E S P O I D S A R A B E S
Nous avons dit que les Européens ont cela de commun avec les Arabes, qu’une
grande partie desmoms et divisions dé leurs poids étoient les mêmes, quoiqu’il n’y
eût entre les valeurs de ces poids qui portent des noms semblables, qu’un rapport
fort "variable et souvent assez éloigné.
Notre quintal (i), comme leur qantâr, étoit composé de 100 livres ou rotl.
Notre livre médicale étoit de 12 onces, comme le rotl des Arabes de 1 2 ouqyah (2)
L ’once médicale sé divisoit en 7 deniers (3), comme l’ouqyah de 10 drachmes
en 7 dynâr ou mitqâl.
Le denier des m édecins, qui étoit plus pesant que celui des orfèvres, équivaioit
a 82 grains f comme le dynâr à 82 grains -~7, cette fraction ne différant de la première
que' de en plus.
Les Romains ont confondu le denier avec la drachme (4), parce que ces deux
divisions de poids étoient contiguës et différoient peu : il en est résulté que la
drachme a été divisée en 72 grains, et qu’elle a été comparée à notre gros.
Mais c’est le mitqâl ou dynâr des Arabes qui a le plus de rapport à notre gros.
L ’ouqyah, ou once Araire, de 10 drachmes f , contenoit anciennement près de
8 mitqâl ou gros ; et, dans le système actuel des poids en Egypte ,1’ouqyah se compose
exactement de 8 mitqâl ou gros, d ’une drachme f chacun.
Le mitqâl ou dynâr se divisoit aussi, de même que notre gros, en 72 grains.
Dans notre système de poids de marc, on appelle denier le tiers du gros, qui
répond au- scrupule médical.
Le scrupule et le denier, qui se partagent en 24 grains, répondent au tiers du
dynâr ou mitqâl des Arabes, ou à une demi-drachme actuelle, le mitqâl étant égal
à une drachme 2
Enfin l’Europe a, commerles Orientaux, le système particulier de poids et le nom
de karat dont nous nous servons en France dans les essais d’or pour en évaluer
le titre et pour peser les diamans (<).
P O ID S A C T U E L S D U C O M M E R C E .
L ’u n it é de poids ado p té e ac tu e llement dans le com me rçe est la drachme, dont
nou s d on ne rons ci-après la? valeur.
Chez les Arabes, comme chez tous les peuples, pour aider la m émoire, qui retient
difficilement un nombre composé de trop de chiffres, et pour avoir,’dans les
comptes et calculs, moins de chiffres à écrire, on a donné, des noms particuliers
à certains multiples de l’unité de mesure.
Le système de numération des Arabes étant le système décimal, il eût été plus
naturel de ne donner des noms particuliers qu’aux multiples de dix; mais chez eux,
(1) Le mot qu in tal a de l’analogie avec le mot Arabe
, qantâr, qui, suivant la prononciation vulgaire,
qu in tar , ne diffère du mot Français que par IV finale,
qu’on a changée en /.
(2) Le mot ouqyah, en arabe jusL, paroît le même que
les mots Grec vyxia, Latin u n c ia , et Français once.
(3) Le mot denier est évidemment le même que le mot
Arabe jL lO , dynâr. Voyez pag. 2 3 1, alin. 4 et suiv.
(4) Voye^ ce que nous avons déjà dit de la drachme,
pag. 230, alin. 5 et suiv. et note 1, et pag. 233, alin. 4-
(5) LVyrç pag. 241, alin. 6 et suiv.