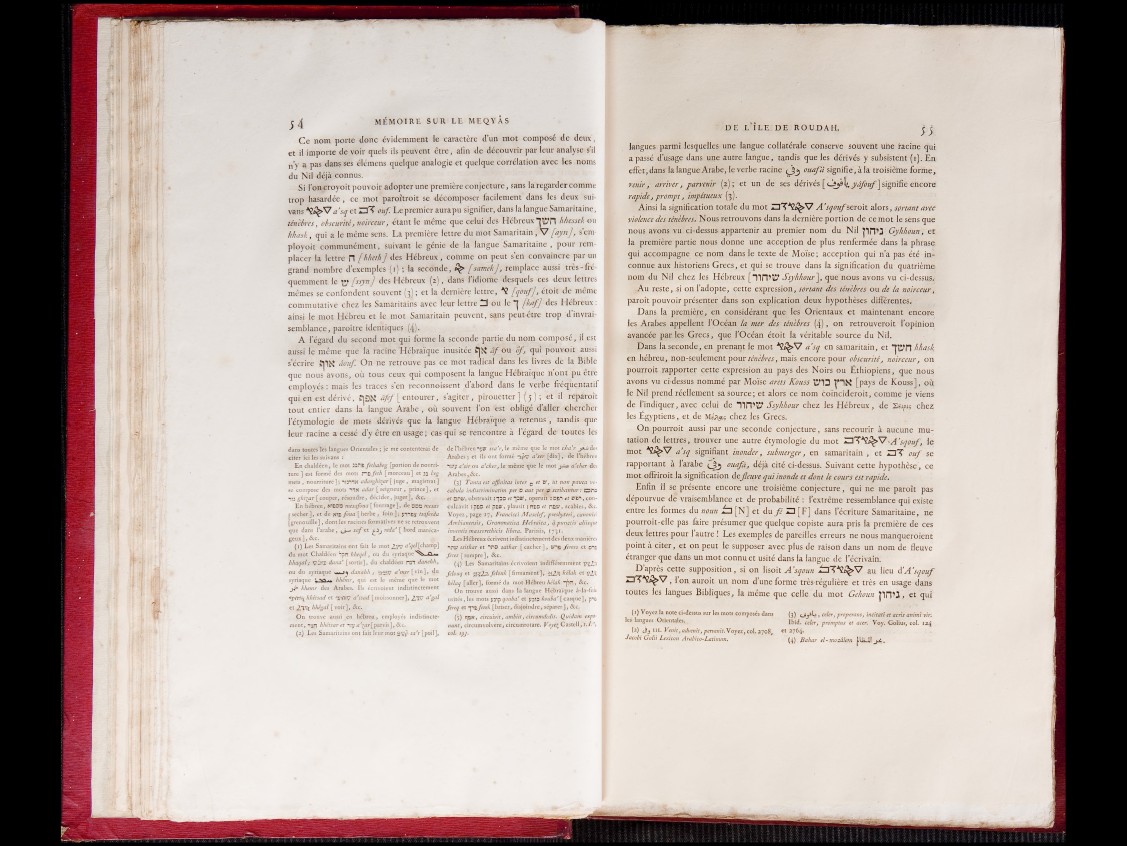
W 7 * - " ;
p | | i l
i l I
Ce nom porte donc évidemment le caractère d’un mot composé de deux,
et il importe de voir quels ils peuvent être, afin de découvrir par leur analyse s’il
n’y a pas dans ses élémens quelque analogie et quelque corrélation avec les noms
du Nil déjà connus.
Si l’on croyoit pouvoir adopter une première conjecture, sans la regarder comme
trop hasardée , ce mot paroîtroit se décomposer facilement dans les deux sui-
vans a’sq et H l? ouf. Lepremier aurapu signifier, dans la langue Samaritaine,
flii'èbrës, obscurité, noirceur, étant le même que celui des Hébreux *|ï?n bhcssck ou
hhask, qui a le même sens. La première lettre du mot Samaritain, V [a yn j, s’em-
ployoit communément, suivant le génie de la langue Samaritaine , pour remplacer
la lettre n f khtth] des Hébreux, comme on peut s’en convaincre par un
grand nombre d’exemples (i) ; la seconde, [samck], remplace aussi très-fréquemment
le \y [ssyn] des Hébreux (2), dans l’idiome desquels ces deux lettres
mêmes se confondent souvent (3) ; et la derniere lettre, *2 [*lonf ] * etoit de même
commutative chez les Samaritains avec leur lettre Î3 ou le fk a fj des Hébreux :
ainsi le mot Hébreu et le mot Samaritain peuvent, sans peut-être trop d’invraisemblance,
paroître identiques (4).
A l’égard du second mot qui forme la seconde partie du nom composé, il est
aussi le même que la racine Hébraïque inusitée ¥ â f ou ôf, qui pouvoit aussi
s’écrire SIX âouf. On ne retrouve pas ce mot radical dans les livres de la Bible
que nous avons, où tous ceux qui composent la langue Hébraïque n’ont pu être
employés : mais les traces s’en reconnoissent d’abord dans le verbe fréquentatif
qui en est dérivé, f|2N â/rf [ entourer, s’agiter, pirouetter] ( y ) ; et il reparoît
tout entier dans la langue Arabe , où souvent l’on est obligé d’aller chercher
l’étymologie de mots dérivés que la langue Hébraïque a retenus , tandis que
leur racine a cessé d’y être en usage ; cas qui se rencontre à l’égard de toutes les
dans tontes les langues Orientales ; je me contenterai de de l’hébreu ny;y ssa’ r, le même que le mot cha’ r _>*-ides
citer ici les suivans : Arabes ; et ils ont formé a’ser [dix], de l ’hébreu
En chaldéen, le mot 32HS fethabeg [portion de nourri- «ijÿy a’sir ou a*cher, le même que le mot a’ cher des
ture ] est formé des mots r® feth [morceau] et 33 beg Arabes,&c.
mets, nourriture]; ">ia*nN adarghi^ar [ juge, magistrat] (3) Tanta est affinitas inter « et Vf , ut non pauca vose
compose des mots adar [ seigneur , prince], et cabula indiscriminatim per D aut per w scribantur :
“1*3 ghrçar [couper, résoudre, décider, juger], &c. et s w , obstruxit ;*13D et“JDKf, operuit* : DB*i et , con-
En hébreu, MSDD mesafoua [fourrage], de DDD mesas culcavit :psD et pav, plausit :nSD et r.BJy, scabies, &c.
£ secher] , et de xts foua [herbe , foin ]; y-nas tsaferda Voyez, page 17, Francis'ci Masclef, presbyteri, canonici
[grenouille], dont les racines formatives ne se retrouvent Ambianensis, Gramrnatica Hebraica, à punctis aliisque
que dans l’arabe, i_j~o saf et reda* [ bord maréca- inventis massorethicis libéra, Parisiis, 1731.
geux ] , &c. Les Hébreux écrivent indistinctement des deux manières
(1) Les Samaritains ont fait le mot 2j?V [champ] ssjt/,ar et <qpD sathar [ cacher], ans feress et D*i2
du mot Chaldéen bpn hheqel, ou du s y r i a q u e f eres [rompre], &c.
hhaqal; vivîT dana’ [sortir], du chaldéen n3*T danehh, ^ Les Samaritains écrivoient indifféremment ££¿3
ou du syriaque danahh ; âüJV a’mer [v in ], du f elouq et felouh [firmament], hélak et £¿3
syriaque WiO— hhiinr, qui est le même que le mot /(„ g p y » f0Imé du mot Hébreu hêlak riSn, &c.
> khanr des Arabes- Ils ¿cri voient indistinctemeot Qn [n)uve au!si dans la langue Hébraïque à-la-fois
hhetsad et ‘ïvtîV a,tsad [moissonner], 2/ïV a gal usités, les mots yaip qouba* et yaw kouba’ [casque], pis
et 2.T^ hhêgal [ voir], &c. fereq et *pcferek [briser, disjoindre, séparer], &c.
On trouve aussi en hébreu, employés indistincte- (5) mjn, circuivit, ambiit, circumdedit. Quidam expoment,
*wa hhêtsar et nry a \ar[parvis], &c. nunt, circumvolvere, circumrotare. V<y*Z Castell, t.J.'r,
(2) Les Samaritains ont fait leur mot sa*r [poil], col. tpj.
langues parmi lesquelles une langue collatérale conserve souvent une racine qui
a passé d’usage dans une autre langue, tandis que les dérivés y subsistent (i). En
effet ,dans la langue Arabe, le verbe racine ouafa signifie,àla troisième forme,
venir, arriver, parvenir (2); et un de ses dérivés [ ô j â u yâfouf]signifie encore
rapide, prompt, impétueux (3).
Ainsi la signification totale du mot A ’sqouf seroit alors, sortant avec
violence des ténèbres. Nous retrouvons dans la dernière portion de ce mot le sens que
nous avons vu ci-dessus appartenir au premier nom du Ni 1 p ® | Gylihoun, et
la première partie nous donne une acception de plus renfermée dans la phrase
qui accompagne ce nom dans le texte de Moïse ; acception qui n’a pas été inconnue
aux historiens Grecs, et qui se trouve dans la signification du quatrième
nom du Nil chez les Hébreux Ssyhhour], que nous avons vu ci-dessus.
Au reste, si on l’adopte, cette expression, sortant des ténèbres ou de la noirceur,
paroît pouvoir présenter dans son explication deux hypothèses différentes.
Dans la première, en considérant que les Orientaux et maintenant encore
les Arabes appellent l’Océan la mer des ténèbres (4) , on retrouveroit l’opinion
avancée par les Grecs, que l’Océan étoit la véritable source du Nil.
Dans la.seconde, en prenant le mot *23gS7 a’sq en samaritain, et hhask
en hébreu, non-seulement pour ténèbres, mais encore pour obscurité, noirceur, on
pourroit rapporter cette expression au pays des Noirs ou Ethiopiens, que nous
avons vu ci-dessus nommé par Moïse arcts Kouss ^1 3 F IX [pays de Kouss], où
le Nil prend réellement sa source; et alors ce nom coïncideroit, comme je viens
de l’indiquer, avec celui de "HITEf Ssyhhour chez les Hébreux, de 2e;pis chez
les Égyptiens, et de Méte« chez les Grecs.
On pourroit aussi par une seconde conjecture, sans recourir à aucune mutation
de lettres, trouver une autre étymologie du mot 'sqouf, le
mot a’sq signifiant inonder, submerger, en samaritain , et Z 2 ? ou f se
rapportant à l’arabe ouafâ, déjà cité ci-dessus. Suivant cette hypothèse, ce
mot offriroit la signification defleuve qui inonde et dont le cours est rapide.
Enfin il se présente encore une troisième conjecture, qui ne me paroît pas
dépourvue de vraisemblance et de probabilité : l’extrême ressemblance qui existe
entre les formes du nouti ÎH [N] et du f i ZH [F] dans l’écriture Samaritaine, ne
pourroit-elie pas faire présumer que quelque copiste aura pris la première de ces
deux lettres pour 1 autre i Les exemples de pareilles erreurs ne nous manqueroient
point à citer, et on peut le supposer avec plus de raison dans un nom de fleuve
étranger que dans un mot connu et usité dans la langue de l’écrivain.
D ’après cette supposition, si on lisoit A ’sqoun au lieu S A 'sqou f
¿□7 *2«^V , 1 on auroit un nom d’une forme très-régulière et très en usage dans
toutes les langues Bibliques, la même que celle du mot Gehoun J irP jl, et qui
(1) Voyez la note ci-dessus sur les mots composes dans (3) c jjàL ;, celer, properans, incitati et acris animi vin
les' langues Orientales.. Ibid. celer, promptus et acer. Voy. Golius, col. 124
i-2) <jj n i. Venit,advenit, pervenit. Voyez, col. 2708, et 2764«
Jacobi Golii Lexicon Arabica-Lathium. (4) Bahar el-mozâlem tÜUl j 4 .