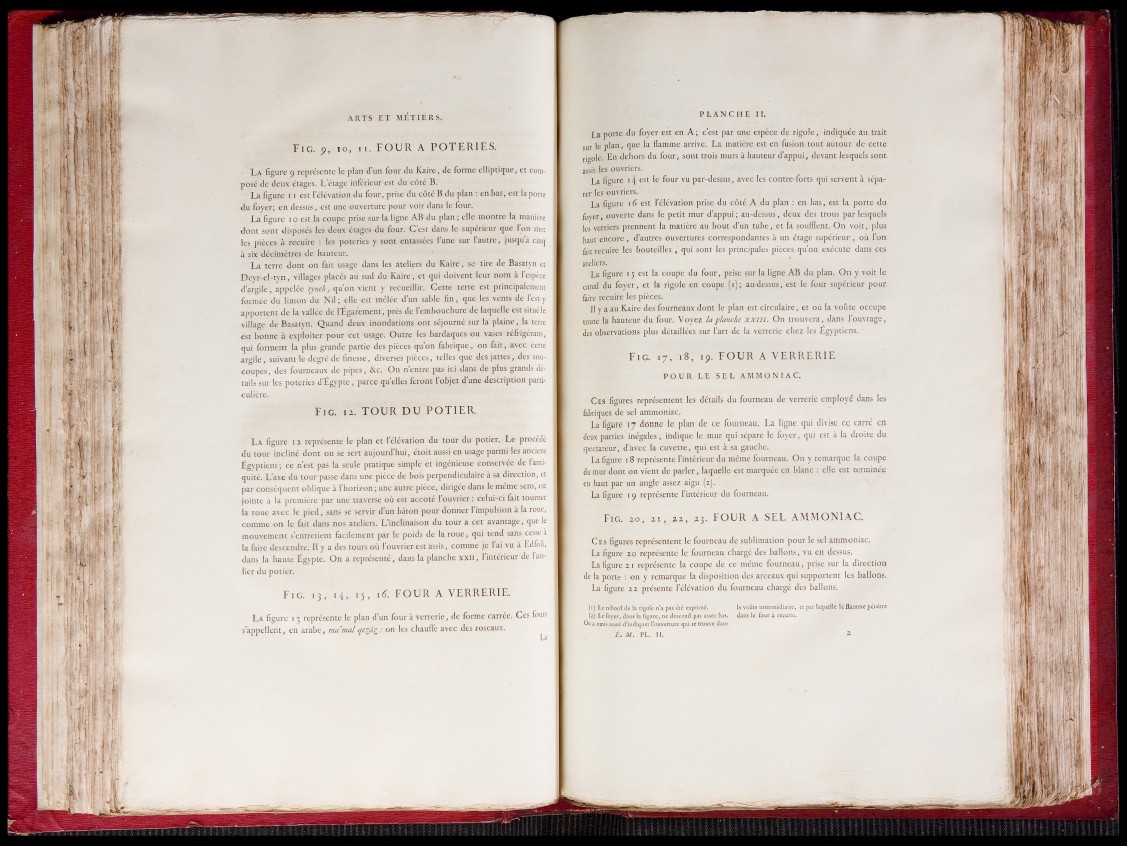
F i e . 9, i o , i i . F O U R A PO T E R IE S .
L a figure 9 représente le plan d’un four du Kairc, de forme elliptique, et composé
de deux étages. L’étage inférieur est du côté B.
La figure 11 est l’élévation du four, prise du côté B du plan : en bas, est la porte
du foyer; en dessus, est une ouverture pour voir dans le four.
La figure i o est la coupe prise sur la ligne AB du plan ; elle montre la manière
dont sont disposés les deux étages du four. G est dans le supéricux que 1 on met
les pièces à recuire : les poteries y sont entassées l’une sur l’autre, jusqu a cinq
à six décimètres de hauteur.
La terre dont on fait usage dans les ateliers du Kaire, se tire de Basatyn et
Deyr-el-tyn, villages placés au sud du Kaire, et qui doivent leur nom à l’espèce
d’argile, appelée lyneh, qu’on vient y recueillir. Cette terre est principalement
formée du limon du Nil; elle est mêlée d’un sable fin, que les vents de l’est y
apportent de la vallée de l’Égarement, près de l’embouchure de laquelle est situé le
village de Basatyn. Quand deux inondations ont séjourné sur la plaine, la terre
est bonne à exploiter pour cet usage. Outre les bardaques ou vases réfrigérans,
qui forment la plus grande partie des pièces qu’on fabrique, on fait, avec cette
argile, suivant le degré de finesse, diverses pièces, telles que des jattes, des soucoupes,
des fourneaux de pipes, &c. On n’entre pas ici dans de plus grands détails
sur les poteries d’Égypte, parce qu’elles feront l’objet d’une description particulière.
F ig . 12. TO U R D U POTIER.
L a figure i z représente le plan et l’élévation du tour du potier. Le procédé
du tour incliné dont on se sert aujourd’hui, étoit aussi en usage parmi les anciens
Égyptiens; ce n’est pas la seule pratique simple et ingénieuse conservée de 1 antiquité.
L ’axe du tour passe dans une pièce de bois perpendiculaire à sa direction, et
par conséquent oblique à l’horizon ; une autre piece, dirigée dans lememe sens, est
jointe à la première par une traverse où est accoté l’ouvrier : celui-ci fait tourner
la roue avec le pied, sans se servir d’un bâton pour donner l’impulsion à la roue,
comme on le fait dans nos ateliers. L’inclinaison du tour a cet avantage, que le
mouvement s’entretient facilement par le poids de la roue, qui tend sans cesse à
la faire descendre. Il y a des tours où l’ouvrier est assis, comme je I ai vu a Edfou, |
dans la haute Égypte. On a représenté, dans la planche x x n , 1 intérieur de 1 atelier
du potier.
Fig. 13, 14, 15, 16. FO U R A VERRERIE,
L a figure 13 représente le plan d’un four à verrerie, de forme carrée. Ces fours
s’appellent, en arabe, ma mal qezAz ■' on les chauffe avec des roseaux.
La porte du foyer est en A ; c’est par une espèce de rigole, indiquée au trait
sur le plan, que la flamme arrive. La matière est en fusion tout autour de cette
rig o le . En dehors du four, sont trois murs à hauteur d’appui, devant lesquels sont
assis les ouvriers.
La figure i 4 est le four vu par-dessus, avec les contre-forts qui servent à séparer
les ouvriers.
La figure 16 est l’élévation prise du côté A du plan : en bas, est la porte du
foyer, ouverte dans le petit mur d’appui; au-dessus, deux des trous par lesquels
les verriers prennent la matière au bout d’un tube, et la soufflent. On voit, plus
haut encore , d’autres ouvertures correspondantes à un étage supérieur, où l’on
fait recuire les bouteilles, qui sont les principales pièces qu’on exécute dans ces
ateliers.
La figure 15 est la coupe du four, prise sur la ligne AB du plan. On y voit le
canal du foyer, et la rigole en coupe (1); au-dessus, est le four supérieur pour
faire recuire les pièces.
Il y a au Kaire des fourneaux dont le plan est circulaire, et où la voûte occupe
toute la hauteur du four. Voyez la planche x x m . On trouvera, dans l’ouvrage,
des observations plus détaillées sur l’art de la verrerie chez les Égyptiens.
F i g . 17, 18, 19. FOUR A VERRERIE
POUR LE SEL AMMONIAC.
Ces figures représentent les détails du fourneau de verrerie employé dans les
fabriques de sel ammoniac.
La figure 17 donne le plan de ce fourneau. La ligne qui divise ce carré en
deux parties inégales, indique le mur qui sépare le foyer, qui est à la droite du
spectateur, d’avec la cuvette, qui est à sa gauche.
La figure 18 représente l’intérieur du même fourneau. On y remarque la coupe
du mur dont on vient de parler, laquelle est marquée en blanc : elle est terminée
en haut par un angle assez aigu (2).
La figure 19 représente l’intérieur du fourneau.
F ig . 20, 21, 22, 23. FOUR A SEL AMMONIAC.
C es figures représentent le fourneau de sublimation pour le sel ammoniac.
La figure 20 représente le fourneau chargé des ballons, vu en dessus.
La figure 21 représente la coupe de ce même fourneau, prise sur la direction
de la porte : on y remarque la disposition des arceaux qui supportent les ballons.
La figure 22 présente lelcvation du fourneau chargé des ballons.
(1) Le rebord de la rigolé n’a pas été exprimé. la voûte intermédiaire, et par laquelle la flamme pénètre
(2) Le foyer, dans la figure, ne descend pas assez bas. dans le four à recuire.
On a omis aussi d’indiquer l’ouverture qui se trouve dans