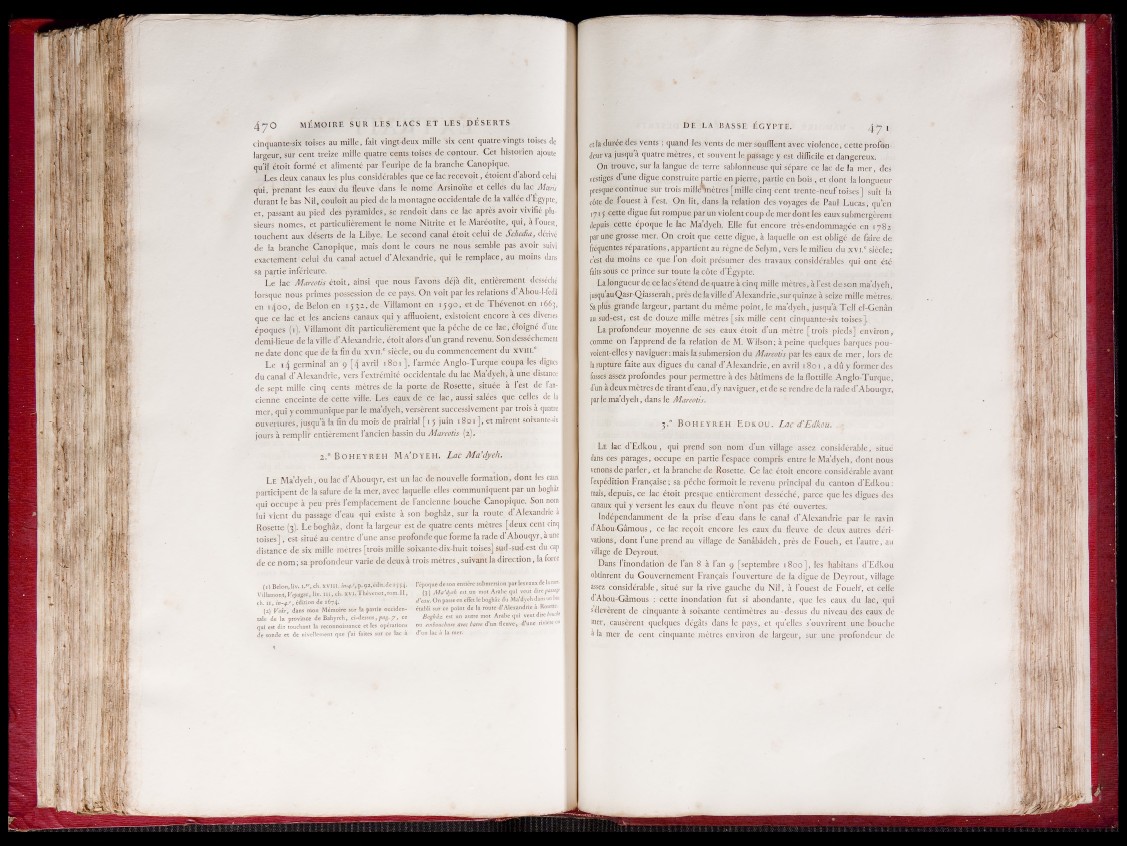
cinquante-six toises au mille, fait vingt-deux mille six cent quatre-vingts toises de
largeur, sur cent treize mille quatre cents toises de contour. Cet historien ajoute
qu’il étoit formé et alimenté par l’euripe de la branche Canopique.
Les deux canaux les plus considérables que ce lac recevait, étoient d’abord celui
qui, prenant les eaux du fleuve dans le nome Arsinoïte et celles du lac Moeris
durant le bas Nil, couloit au pied de la montagne occidentale de la vallce d’Egypte,
et, passant au pied des pyramides, se rendoit dans ce lac après avoir vivifié plusieurs
nomes, et particulièrement le nome Nitrite et le Maréotite, qui, a l ouest,
touchent aux déserts de la Libye. Le second canal étoit celui de Schedia, dérivé
de la branche Canopique, mais dont le cours ne nous semble pas avoir suivi
exactement celui du canal actuel d’Alexandrie, qui le remplace, au moins dans 1
sa partie inférieure.
Le lac Mareotis étoit, ainsi que nous l’avons déjà dit, entièrement desséché
lorsque nous prîmes possession de ce pays. On voit par les relations d’Abou-l-fedâ
en t 4oo, de Belon en 1532, de Villamont en 1590, et de Thévenot en 1663,
que ce lac et les anciens canaux qui y aifluoient, existoient encore à ces diverses
époques (1). Villamont dit particulièrement que la pêche de ce lac, éloigné d’une |
demi-lieue de la ville d’Alexandrie, étoit alors d’un grand revenu. Son dessèchement
ne date donc que de la fin du x v i i . ' siècle, ou du commencement du x vm.e
Le 4 germinal an 9 [4 avril 1801 ], l’armée Anglo-Turque coupa les digues
du canal d’Alexandrie, vers l’extrémité occidentale du lac Ma’dyeh, à une distance
de sept mille cinq cents mètres de la porte de Rosette, située à l’est de l’ancienne
enceinte de cette ville. Les eaux de ce lac, aussi salées que celles de la
mer, qui y communique par le ma’dyeh, versèrent successivement par trois à quatre
ouvertures, jusqu’à la fin du mois de prairial [ 15 juin 1801 ], et mirent soixante-six
jours à remplir entièrement l’ancien bassin du Mareotis (2).
2 . ° B o h e y r e h M a ’d y e h , Lac M a ’dyeh.
L e Ma’dyeh, ou lac d’Abouqyr, est un lac de nouvelle formation, dont les eaux
participent de la salure de la mer, avec laquelle elles communiquent par un boghâz
qui occupe à peu près l’emplacement de l’ancienne bouche Canopique. Son nom
lui vient du passage d’eau qui existe à son boghâz, sur la route d’Alexandrie a
Rosette (3). Le boghâz, dont la largeur est de quatre cents mètres [deux cent cinq |
toises], est situé au centre d’une anse profonde que forme la rade d’Abouqyr, a une
distance de six mille mètres [trois mille soixante-dix-huit toises] sud-sud-est du cap
de ce nom; sa profondeur varie de deux à trois mètres, suivant la direction, la force
( i l Belon, liv. 1." , ch. XVIII, in-4.’, p. çz.édit.de 1554.
Villamont, Voyages, liv. 111, ch. XVI.Thévenot, 10m.II,
ch. II, in-4.0, édition de 1674.
(x) Voir, dans mon Mémoire sur la partie occidentale
de la province de Bahyreh, ü - i e s s u s , pag. y , ce
qui est dit touchant la reconnoissance et les opérations
de sonde et de nivellement que j’ai faites sur ce lac a
Tépoquedeson entière submersion par les eaux de la mer.
(3 ) M a ’dyeh est un mot Arabe qui veut dire postage
d’eau. On passe en effet le boghâz du Ma’dyeh dans un bac
établi sur ce point de la route d’Alexandrie à Rosette.
Boghâz est un autre mot Arabe qui veut dire boutlie
ou eenbouchure avec barre d’un fleuve, d’une rivière ou
d’un lac à la mer.
et la durée des vents : quand les vents de mer soufflent avec violence, cette profondeur
va jusqu à quatre mètres, et souvent le passage y est difficile et dangereux,
On trouve, sur la langue de terre sablonneuse qui sépare ce lac de la mer, des
vestiges d une digue construite partie en pierre, partie en bois, et dont la longueur
presque continue sur trois mille*nètres [mille cinq cent trente-neuf toises] suit la
côte de l’ouest à l’est. On lit, dans la relation des voyages de Paul Lucas, qu’en
1715 cette digue fut rompue par un violent coup de mer dont les eaux submergèrent
depuis cette époque le lac Ma’dyeh. Elle fut encore très-endommagée en 1782
par une grosse mer. On croit que cette digue, à laquelle on est obligé de faire de
fréquentes réparations, appartient au règne de Selym, vers le milieu du x v i.c siècle;
c’est du moins ce que l’on doit présumer des travaux considérables qui ont été
faits sous ce prince sur toute la côte d’Egypte.
La longueur de ce lac s’étend de quatre à cinq mille mètres, à l’est de son ma’dyeh,
jusqu’au Qasr-Qiasserah, près de la ville d’Alexandrie, sur quinze à seize mille mètres.
Sa plüs grande largeur, partant du même point, le ma’dyeh, jusqu’à Tell el-Genân
au sud-est, est de douze mille mètres [six mille cent cinquante-six toises].
La profondeur moyenne de ses eaux étoit d’un mètre [ trois pieds] environ,
comme on l’apprend de la relation de M. Wilson; à peine quelques barques pou-
voient-ellesy naviguer: mais la submersion du Mareotis par les eaux de mer, lors de
la rupture faite aux digues du canal d’Alexandrie, en avril 1801 , a dû y former des
fosses assez profondes pour permettre à des bâtimens de la flottille Anglo-Turque,
d’un à deux mètres de tirant d’eau, d’y naviguer, et de se rendre de la rade d’Abouqyr,
par le ma’dyeh, dans le Mareotis.
3.° B o h e y r e h E d k o u . Lac d ’E d k o u . .
Le lac d’Edkou, qui prend son nom d’un village assez considérable, situé
dans ces parages, occupe en partie l’espace compris entre le Ma’dyeh, dont nous
venons de parler, et la branche de Rosette. Ce lac étoit encore considérable avant
l’expédition Française ; sa pêche formoit le revenu principal du canton d’Edkou :
mais, depuis, ce lac étoit presque entièrement desséché, parce que les digues des
canaux qui y versent les eaux du fleuve n’ont pas été ouvertes.
Indépendamment de la prise d’eau dans le canal d’Alexandrie par le ravin
d Abou-Gâmous, ce lac reçoit encore les eaux du fleuve de deux autres dérivations,
dont l’une prend au village de Sanâbâdeh, près de Foueh, et l’autre, au
village de Deyrout.
Dans l’inondation de l’an 8 à l’an 9 [septembre 1800 ], les habitans d’Edkou
obtinrent du Gouvernement Français l’ouverture de la digue de Deyrout, village
assez considérable, situé sur la rive gauche du N il, à l’ouest de Foueh’, et celle
0Abou-Gâmous ; cette inondation fut si abondante, que les eaux du lac, qui
s élevèrent de cinquante à soixante centimètres au-dessus du niveau des eaux de
mer, causèrent quelques dégâts dans le pays, et qu’elles s’ouvrirent une bouche
a la mer de cent cinquante mètres environ de largeur, sur une profondeur de