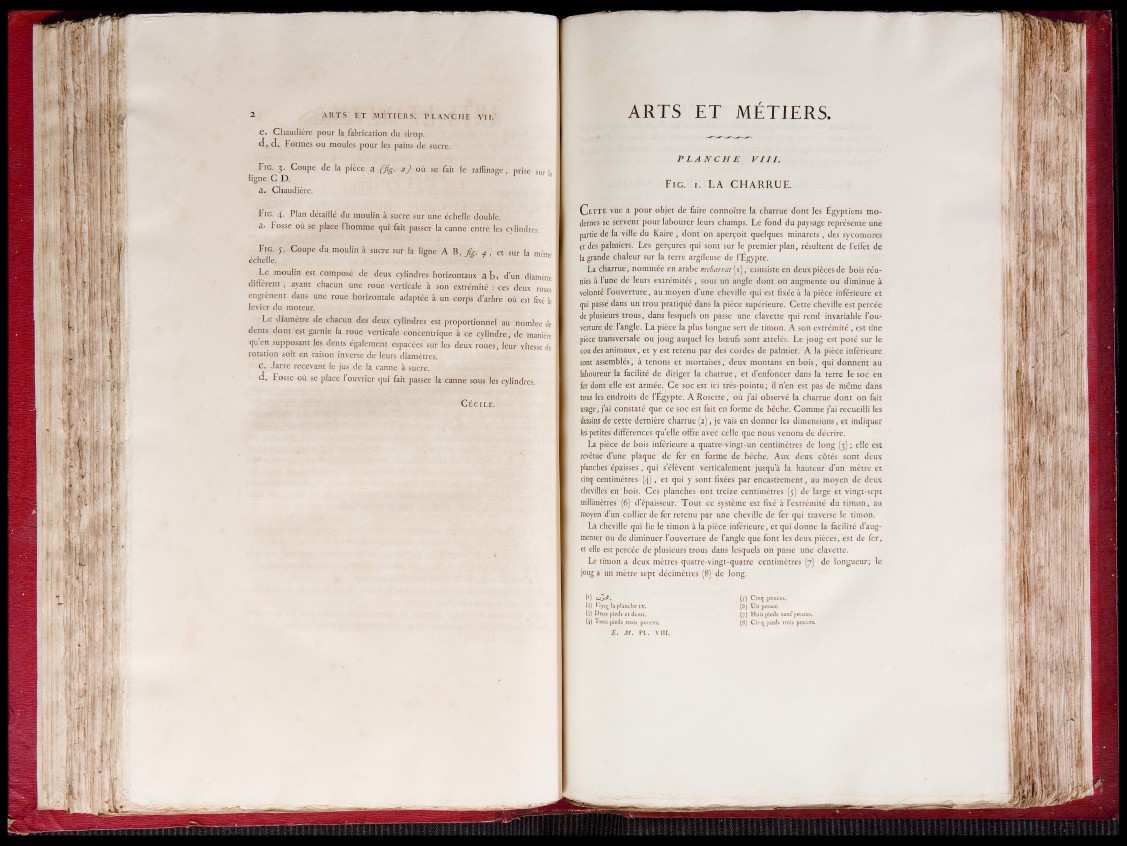
e . Chaudière pour la fabrication du sirop.
d , d . Formes ou moules pour les pains de sucre.
F ig . 3 . Coupe de la pièce a (fig. 2 ) o ù se fait le raffinage, prise sur la
ligne C D.
a. Chaudière.
F ig . 4- Plan détaillé du moulin à sucre sur une échelle double.
a- Fosse où se place 1 homme qui fait passer la canne entre les cylindres.
F ig . 5 . Coupe du moulin à sucre sur la ligne A B , fig. 4., et sur la mène
échelle.
Le moulin est composé de deux cylindres horizontaux ab> d’un diamètre
différent, ayant chacun une roue verticale à son extrémité : ces deux roues
engrènent dans une roue horizontale adaptée à un corps d’arbre où est fixé le
levier du moteur.
Le diamètre de chacun des deux cylindres est proportionnel au nombre de
dents dont est garnie la roue verticale concentrique à ce cylindre, de manière
qu’en supposant les dents également espacées sur les deux roues, leur vitesse de
rotation soit en raison inverse de leurs diamètres.
C. Jarre recevant le jus de la canne à sucre.
u . Fosse ou se place 1 ouvrier qui fait passer la canne sous les cylindres.
C é c i l e .
P L A N C H E V I I I .
F i g . k LA CHARRUE.
C e t t e vue a pour objet de faire connoître la charrue dont les Égyptiens modernes
se servent pour labourer leurs champs. Le fond du paysage représente une
partie de la ville du Kaire , dont on aperçoit quelques minarets , des sycomores
et des palmiers. Les gerçures qui sont sur le premier plan, résultent de l’eflèt de
la grande chaleur sur la terre argileuse de l’Égypte.
La charrue, nommée en arabe meharrat ( 1) / consiste en deux pièces de bois réunies
à l’une de leurs extrémités , sous un angle dont on augmente ou diminue à
volonté l’ouverture, au moyen d’une cheville qui est fixée à la pièce inférieure et
qui passe dans un trou pratiqué dans la pièce supérieure. Cette cheville est percée
de plusieurs trous, dans lesquels on passe une clavette qui rend invariable l’ouverture
de l’angle. La pièce la plus longue sert de timon. A son extrémité, est une
pièce transversale ou joug auquel les boeufs sont attelés. Le joug est posé sur le
cou des animaux, et y est retenu par des cordes de palmier. A la pièce inférieure
sont assemblés, à tenons et mortaises, deux montans en bois, qui donnent au
laboureur la facilité de diriger la charrue, et d’enfoncer dans la terre le soc en
fer dont elle est armée. C e soc est ici très-pointu ; il n’en est pas de même dans
tous les endroits de l’Égyptc. A Rosette, où j’ai observé la charrue dont on fait
usage, j’ai constaté que ce soc est lait en forme de bêche. Comme j’ai recueilli les
dessins de cette dernière charrue (2), je vais en donner les dimensions, et indiquer
les petites différences qu’elle offre avec celle que nous venons de décrire.
La pièce de bois inférieure a quatre-vingt-un centimètres de long (3) ; elle est
revêtue d’une plaque de fer en forme de bêche. Aux deux côtés sont deux
planches épaisses, qui s’élèvent verticalement jusqu’à la hauteur d’un mètre et
cinq centimètres (4), et qui y sont fixées par encastrement, au moyen de deux
chevilles en bois. Ces planches ont treize centimètres (5) de large et vingt-sept
millimètres (6) tl’épaisseur. Tout ce système est fixé à l’extrémité du timon, au
moyen d’un collier de fer retenu par une cheville de fer qui traverse le timon.
La cheville qui lie le timon à la pièce inférieure, et qui donne la facilité d’augmenter
ou de diminuer l’ouverture de l’angle que font les deux pièces, est de fer,
et elle est percée de plusieurs trous dans lesquels on passe une clavette.
Le timon a deux mètres quatre-vingt-quatre centimètres (7) de longueur; le
joug a un mètre sept décimètres (8) de long.
(0
(2) Piyvj la planche iv.
(3) Deux pieds et demi.
(4) Trois pieds trois pouces.
£ . M . PL. V III.
(5) Cinq pouces,
(6) Un pouce.
(7) Huit pieds neuf pouces.
(8) Cinq pieds trois pouces.