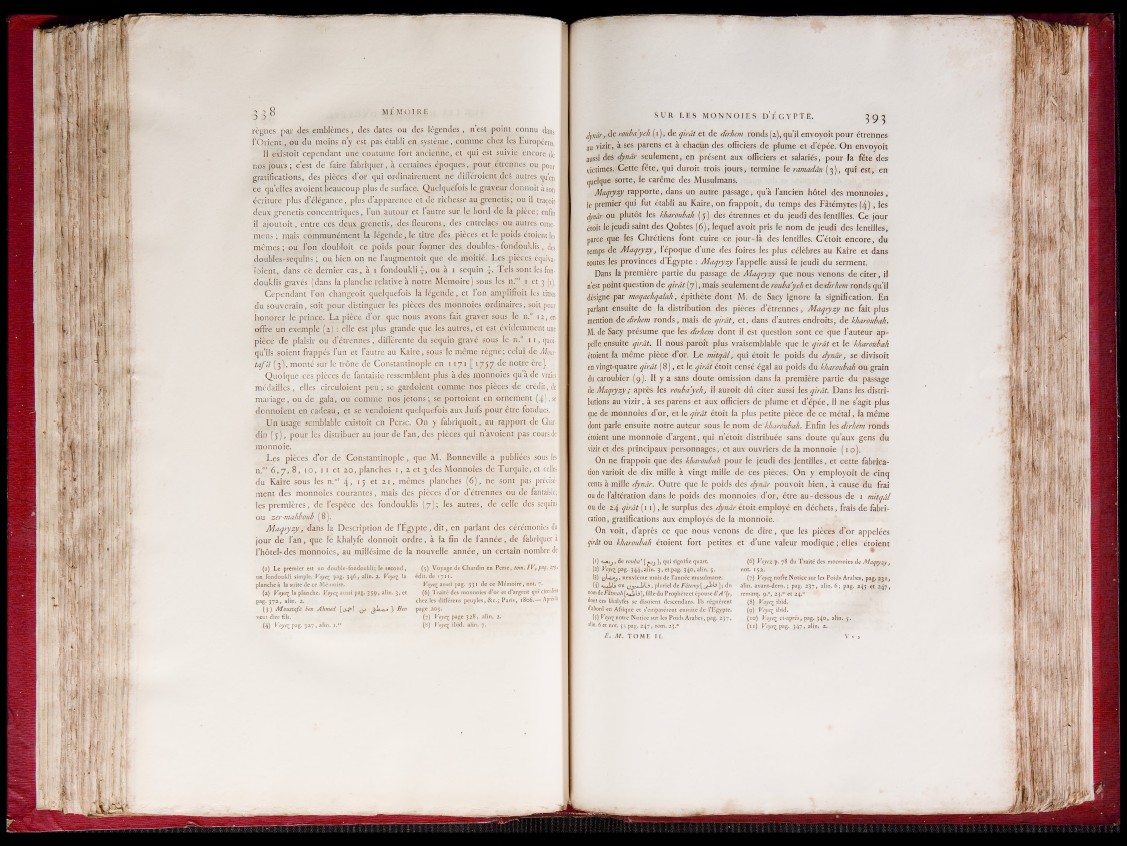
règnes par des em b lèm e s , des dates ou des lé g e n d e s , n’est p o in t connu dans
l’Orient, ou du moins n’y est pas établi en système , com m e chez les Européens.
Il existoit cependant une coutume fort ancienne, et qui est suivie encore de
nos jours; c’est de faire fabriquer, à certaines époques, pour étrennes ou pour
gratifications, des pièces d’or qui ordinairement ne diiTéroient deâ autres ([n’er.
ce qu’elles avoient beaucoup plus de surface. Quelquefois le graveur donnoit à son
écriture plus d’élégance, plus d’apparence et de richesse au grenetis; ou il traçoit
deux grenetis concentriques, l'un autour et l’autre sur le bord de la pièce; enfin j
il ajoutoit, entre ces deux grenetis, des fleurons, des entrelacs ou autres orne-
mens ; mais communément la légende, le titre d*es pièces et le poids étoient les
mêmes; ou l’on doubloit ce poids pour former des doubles-fondouklis, des
doubles-sequins ; ou bien on ne l’augmentoit que de moitié. Les pièces équiva-
ioient, dans ce dernier cas, à i fondoukli j , ou à i sequin j . Tels sont lesfon- j
douklis gravés (dans la planche relative à notre Mémoire) sous les 11."' 1 et 3 (1).
Cependant l’on changeoit quelquefois la légende, et l’on amplifioit les titres
du souverain, soit pour distinguer les pièces des monnoies ordinaires, soit pour
honorer le prince. La pièce d or que nous avons fait graver sous le n.° 12, en
offre un exemple (2) : elle est plus grande que les autres, et est évidemment une
pièce de plaisir ou d’étrennes, différente du sequin gravé sous le 11.0 1.1, quoiqu’ils
soient frappés l’un et l’autre au Kaire, sous le même régné; celui de Mous-
taf'â (3), monté sur le trône de Constantinople en 1 171 [ 1757 de notre ère].
Quoique ces pièces de fantaisie ressemblent plus à des monnoies qu’à; de vraies
médailles, elles circuloient peu; se gardoient comme nos pièces de crédit, de
mariage, ou de gala, ou comme nos jetons; se portoient en ornement (4 ) ,sé
donnoient en cadeau, et se vendoient quelquefois aux Juifs pour être fondues.
Un usage semblable existoit en Perse. On y fabriquoit, au rapport de Char-1
din ( t) , pour les distribuer au jour de l’an, des pièces qui n’avoient pas cours de
monnoie.
Les pièces d’or de Constantinople, que M. Bonneville a publiées sous les
n.“ 6 ,7 , 8, 10, 11 et 2 0 ,planches 1, 2 et 3 des Monnoies de Turquie, et celles j
du Kaire sous les n.°! 4 , >5 et 2 1 , mêmes planches (6), ne sont pas précisément
des monnoies courantes, mais des pièces d’or d’étrennes ou de fantaisie;
les premières, de l’espèce des fondouklis (.7); les autres, de celle des sequins
ou zer-mahboub ( 8 ).
Maqryzy, dans la Description de l’Égypte, dit, en parlant des cérémonies du
jour de l’an, que le khalyfe donnoit ordre, à la fin de l’année, de fabriquer a
l’hôtel-des monnoies, au millésime de la nouvelle année, un certain nombre de
(1) Le premier est un double-fondoukli; le second, (5) Voyage de Chardin en Perse, tom. IV , pag. 271)1
un fondoukli simple. Voye^ pag. 346 » alin. 2. Voye^ la édit. de 1711.
planche à la suite de ce Mémoire. Voye^ aussi pag. 331 de ce Mémoire, not. 7*
(2) Voye% la planche. Voye^ aussi pag. 359, alin. 3, et (6) Traité des monnoies d’or et d’argent qui circulent
pag. 372, alin. 2. chez les diiférens peuples, &c.; Paris, 1806. — Après la
(3 ) Moustaja ben Ahmed [o ^ l ]. Ben page 205.
veut dire fils. (7) Voyez page 328, alin. 2.
(4) Voye^ pag. 327, alin. i .er (b) Voye% ibid. alin. 7.
Jynâr, de rouba’yek (i ), de qirât et de dirhem ronds (2), qu’il envoyoit pour étrennes
au vizir, à ses parens et à chacun des officiers de plume et d’épée. On envoyoit
aussi des dynâr seulement, en présent aux officiers et salariés, pour la fête des
victimes. Cette fête, qui duroit trois jours, termine le ramadàn (3), qui est, en
q u e lq u e sorte, le carême des Musulmans.
Maqryzy rapporte, dans un autre passage, qu'à ¡’ancien hôtel des monnoies,
le premier qui fut établi au Kaire, on frappoit, du temps des Fâtémytes (4 ) , les
dynâr ou plutôt les kharoubah (5) des étrennes et du jeudi des lentilles, Ce jour
étoit le jeudi saint des Qobtes (6), lequel avoit pris le nom de jeudi des lentilles,
parce que les Chrétiens font cuire ce jour-là des lentilles, C ’étoit encore, du
temps de Maqryzy, l’époque d’une des foires les plus célèbres au Kaire et dans
toutes les provinces d’Egypte : Maqryzy l’appelle aussi le jeudi du serment.
Dans la première partie du passage de Maqryzy que nous venons de citer, il
n’est point question de qirât (7), mais seulement de rouba’yeh et dedirhem ronds qu’il
désigne par moqachqalah, épithète dont M. de Sacy ignore la signification. En
parlant ensuite de la distribution des pièces d’étrennes, Maqryzy ne fait plus
mention de dirhem ronds, mais de qirât, et, dans d’autres endroits, de kharoubah.
M. de Sacy présume que les dirhem dont il est question sont ce que l’auteur appelle
ensuite qirât. Il nous paroît plus vraisemblable que le qirât et le kharoubah
étoient la même pièce d’or. Le mitqâl, qui étoit le poids du dynâr, se divisoit
en vingt-quatre qirât (8), et le qirât étoit censé égal au poids du kharoubah ou grain
du caroubier (9), Il y a sans doute omission dans la première partie du passage
de Maqryzy ; après les rouba’yeh, il auroit dû citer aussi les qirât. Dans les distributions
au vizir, à ses parens et aux officiers de plume et d’épée, il ne s’agit plus
que de monnoies d’or, et le qirât étoit la plus petite pièce de ce métal, la même
dont parle ensuite notre auteur sous le nom de kharoubah. Enfin les dirhem ronds
croient une monnoie d’argent, qui n’étoit distribuée sans doute qu’aux gens du
vizir et des principaux personnages, et aux ouvriers de la monnoie (10).
On ne frappoit que des kharoubah pour le jeudi des jentiiles, et cette fabrication
varioit de dix mille à vingt mille de ces pièces. On y employoit de cinq
cents à mille dynâr. Outre que le poids des dynâr pouvoit bien, à cause du frai
ou de l’altération dans le poids des monnoies d’or, être au-dessous de 1 mitqâl
ou de 24 qirât ( 11 ) , le surplus des dynâr étoit employé en déchets, frais de fabrication,
gratifications aux employés de la monnoie.
On voit, d’après ce que nous venons de dire, que les pièces d’or appelées
frât ou kharoubah étoient fort petites et d’une valeur modique ; elles étoient
%
(1) <uajj j de rouba1 [ ], qui signifie quart. (6) Voyez p. 78 du Traité des monnoies de Maqryzy ,
(2) Koyrç pag. 344>alin. 3, et pag. 340, alin. not. 152.
(3) , neuvième mois de l’année musulmane. (7) Voye£ notre Notice sur les Poids Arabes, pag. 231,
(4) ou , pluriel de Fâtemy [ ] ; du alin. avant-dern. ; pag. 237, alin. 6; pag. 245 et 24.7,
nom de Fâtmah fille du Prophète et épouse d'A ’ly, remarq. 9.0, 23..0 et 24.0
dont ces khalyfes se disoient descendans. Ils régnèrent (8) Voyeç ibid.
dabord en Afrique et s'emparèrent ensuite de l’Egypte. (9) Voye? ibid.
(?) notre Notice sur les Poids Arabes, pag. 237, (10) Voyeç ci-après, pag. 340, alin. 5.
alin. 6 et not. 5 ; pag. 247, rem. 23.® (11) Voyeç pag. 347, alin. 2.
É, M. T O M E l i . V v a