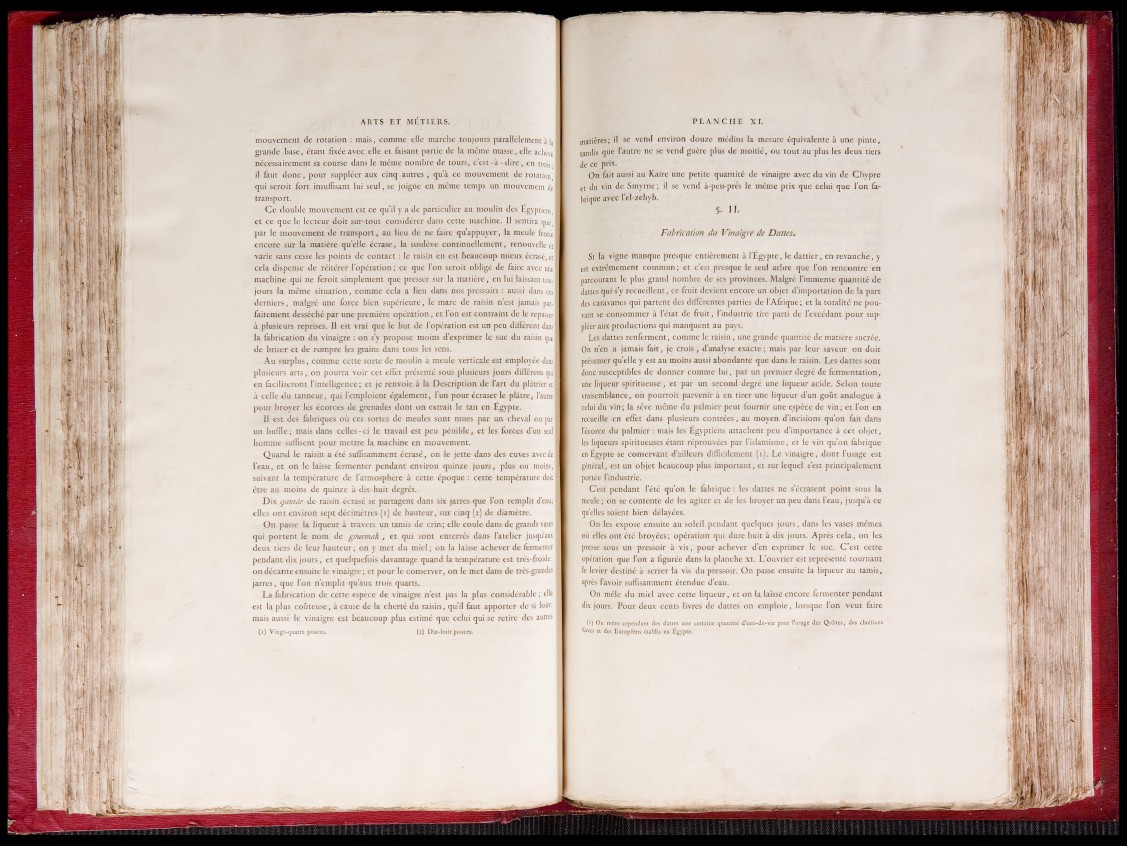
mouvement de rotation : mais, comme elle marche toujours parallèlement à la
grande base, étant fixée avec elle et Élisant partie de la même masse, elle achève
nécessairement sa course dans le même nombre de tours, c’e st-à-dire , en trois'
il faut donc, pour suppléer aux cinq autres , qu’à ce mouvement de rotation, j
qui seroit fort insuffisant lui seul, se joigne en même temps un mouvement dcl
transport.
C e double mouvement est ce qu’il y a de particulier au moulin des Egyptiens
et ce que le lecteur doit sur-tout considérer dans cette machine. Il sentira que,
par le mouvement de transport, au lieu de ne faire qu’appuyer, la meule flotte
encore sur la matière qu’elle écrase, la soulève continuellement, renouvelle et
varie sans cesse les points de contact : le raisin en est beaucoup mieux écrasé, et
cela dispense de réitérer l’opération ; ce que l’on seroit obligé de faire avec une
machine qui ne feroit simplement que presser sur la matière, en lui laissant toujours
la même situation, comme cela a lieu dans nos pressoirs : aussi dans ces
derniers, malgré une force bien supérieure, le marc de raisin n’est jamais parfaitement
desséché par une première opération, et l’on est contraint de le repasser
à plusieurs reprises. Il est vrai que le but de l’opération est un peu différent dans
la fabrication du vinaigre : on s’y propose moins d’exprimer le suc du raisin quel
de briser et de rompre les grains dans tous les sens.
Au surplus, comme cette sorte de moulin à meule verticale est employée dansI
plusieurs arts, on pourra voir cet effet présenté sous plusieurs jours différens quiI
en faciliteront l’intelligence ; et je renvoie à la Description de l’art du plâtrier et I
à celle du tanneur, qui l’emploient également, l’un pour écraser le plâtre, l’autreI
pour broyer les écorces de grenades dont om extrait le tan en Egypte.
11 est des fabriques où ces sortes de meules sont mues par un cheval ou par I
un buffle ; mais dans celles - ci le travail est peu pénible, et les forces d’un seul I
homme suffisent pour mettre la machine en mouvement.
Quand le raisin a été suffisamment écrasé, on le jette dans des cuves avec de I
l’eau, et on le laisse fermenter pendant environ quinze jours, plus ou moins,!
suivant la température de l’atmosphère à cette époque : cette température doit!
être au moins de quinze à dix-huit degrés.
Dix qantâr de raisin écrasé se partagent dans six jarres que l’on remplit d’eau;!
elles ont environ sept décimètres (i) de hauteur, sur cinq (z) de diamètre.
On passe la liqueur à travers un tamis de crin; elle coule-dans de grands vases I
qui portent le nom de gowtmah , et qui sont enterrés dans l’atelier jusqu’aux I
deux tiers de leur hauteur ; on y met du miel ; on la laisse achever de fermenter I
pendant dix jours, et quelquefois davantage quand la température est très-froide: I
on décante ensuite le vinaigre ; et pour le conserver, on le met dans de très-grandes I
jarres, que l’on n’emplit qu’aux trois quarts.
La fabrication de cette espèce de vinaigre n’est pas la plus considérable ; elle I
est la plus coûteuse, à cause de la cherté du raisin, qu’il faut apporter de si loin: I
mais aussi le vinaigre est beaucoup plus estimé que celui qui se retire des autres I
( i) Vingt-quatre pouces. ^ (2) Dix-huit pouces.
matières; il se vend environ douze roédins la mesure équivalente à une pinte,
tandis que l’autre ne se vend guère plus de moitié, ou tout au plus les deux tiers
de ce prix.
On fuit aussi au Kaire une petite quantité de vinaigre avec du vin de Chypre
et du vin de Smyrne; il se vend à-pett-près le même prix que celui' que l’on fabrique
avec l’el-zebyb.
§. II.
Fabrication du Vinaigre de Dattes,
Si la vigne manque presque entièrement à l’Egypte, le dattier, en revanche, y
est extrêmement commun ; et c’est presque le seul arbre que l’on rencontre en
parcourant le plus grand nombre de ses provinces. Malgré l'immense quantité de
dattes qui s’y recueillent, ce fruit devient encore un objet d’importation de la part
des caravanes qui partent des différentes parties de l’Afrique ; et la totalité ne pouvant
se consommer à l’état de fruit, l’industrie tire parti de l’excédant pour suppléer
aux productions qui manquent au pays.
Les dattes renferment, comme le raisin, une grande quantité de matière sucrée.
On n’en a jamais fait, je crois, d’analyse exacte ; mais par leur saveur on doit
présumer qu’elle y est au moins aussi abondante que dans le raisin. Les dattes sont
donc susceptibles de donner comme lui, par un premier degré de fermentation,
une liqueur spiritueuse, et par un second degré une liqueur acide. Selon toute
vraisemblance, oh pourroit parvenir à en tirer une liqueur d’un goût analogue à
celui du vin; la séve même du palmier peut fournir une espèce de vin; et l’on en
recueille en effet dans plusieurs contrées, au moyen d’incisions qu’on fait dans
l’écorce du palmier : mais les Egyptiens attachent peu d’importance à cet objet,
les liqueurs spiritueuses étant réprouvées par l’islamisme, et le vin qu’on fabrique
en Egypte se conservant d’ailleurs difficilement (1). Le vinaigre, dont l’usage est
général, est un objet beaucoup plus important, et sur lequel s’est principalement
portée l’industrie.
C’est pendant l’été qu’on le fabrique : les dattes ne s’écrasent point sous la
meule ; on se contente de les agiter et de les broyer un peu dans l’eau, jusqu’à ce
quelles soient bien délayées.
On les expose ensuite au soleil pendant quelques jours, dans les vases mêmes
où elles ont été broyées; opération qui dure huit à dix jours. Après cela, on les
presse.sous un pressoir à vis, pour achever d’en exprimer le suc. C ’est cette
opération que l’on a figurée dans la planche xi. L’ouvrier est représenté tournant
le levier destiné à serrer ia vis du pressoir. On passe ensuite la liqueur au tamis,
après l’avoir suffisamment étendue d’eau.
On mêle du miel avec cette liqueur, et on la laisse encore fermenter pendant
dix jours. Pour deux cents livres de dattes on emploie, lorsque l’on veut faire
(*) On retire cependant des dattes une certaine quantité d’eau-de-vie pour l’usage des Qobtes, des chrétiens
Grecs et des Européens établis en Egypte.