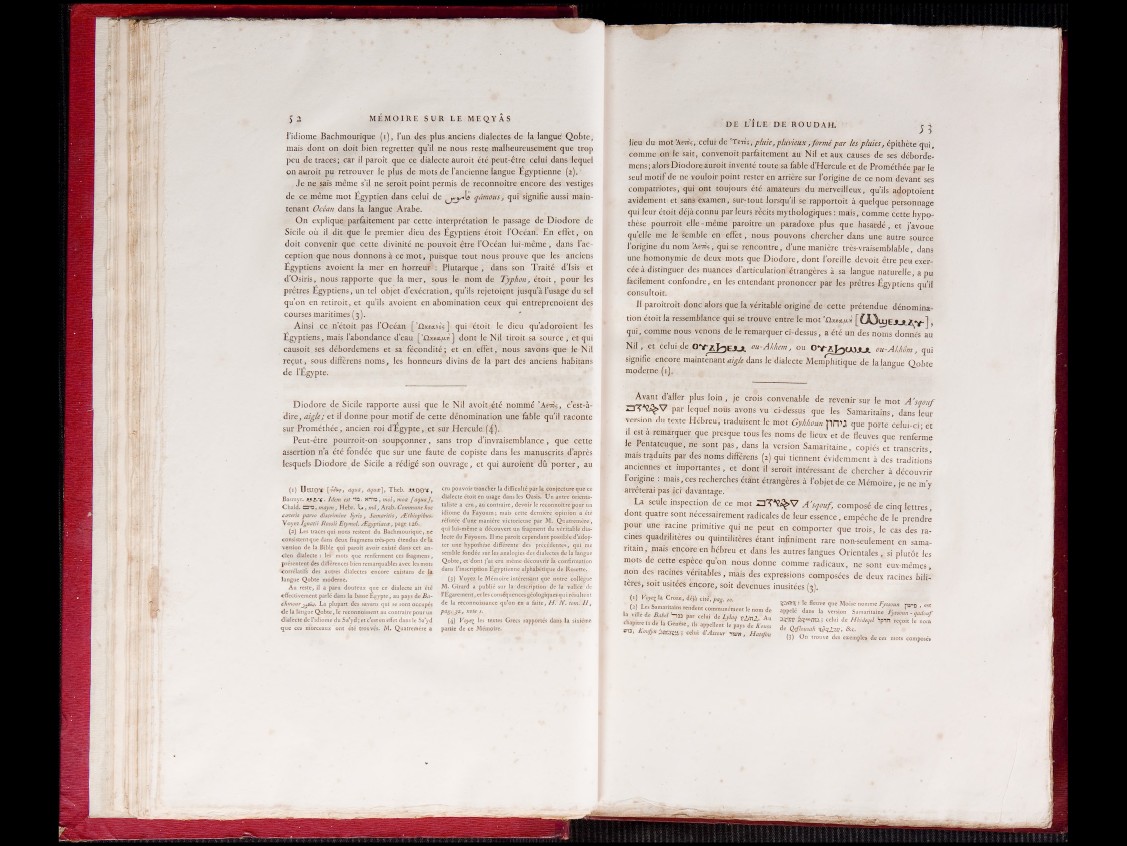
l ’idiome Bachmourique (i), l’un des plus anciens dialectes de la langue'Qobte,
mais dont on doit bien regretter qu’il ne nous reste malheureusement que trop
peu de traces; car il paroît que ce dialecte auroit été peut-être celui dans lequel
on auroit pu retrouver le plus de mots de l’ancienne langue Egyptienne (2). *
. Je ne sais même s’il ne seroit point permis de reconnoître encore des vestiges
de ce même mot Égyptien dans celui de ¡ j y v qâmous, qui signifie aussi maintenant
Océan dans la langue Arabe.
On explique parfaitement par cette interprétation le passage de Diodore de
Sicile où il dit que le premier dieu des Égyptiens étoit l’Océan. En effet, on
doit convenir que cette divinité ne pouvoit être l’Océan lui-même, dans l’acception
que nous donnons à ce mot, puisque tout nous prouve que les anciens
Égyptiens avoient la mer en horreur : Plutarque , dans son Traité d’Isis et
d’Osiris, nous rapporte que la mer, sous le nom de Typhon, étoit, pour les
prêtres Égyptiens, un tel objet d’exécration, qu’ils rejetoiçnt jusqu’à l’usage du sel
qu’on en retirait, et qu’ils avoient en abomination ceux qui entreprenoient des
courses maritimes (3).
Ainsi ce n’étoit pas l’Océan [ ’iixictvos ] qui étoit le dieu qu’adqroient les
Égyptiens, mais l’abondance d’eau [’ûxctyui] dont le Nil tirait sa source, et qui
causoit ses débordemens et sa fécondité; et en effet, nous savons que le Nil
reçut, sous differens noms, les honneurs divins de la part des anciens habitans
de l’Égypte.
Diodore de Sicile rapporte aussi que le Nil avoit été nommé ’Ae-res, c’est-à-
dire, aigle; et il donne pour motif de cette dénomination une fable qu’il raconte
sur Prométhée, ancien roi d’Égypte, et sur Hercule (4 ).
Peut-être pourroit-on soupçonner, sans trop d’invraisemblance, que cette
assertion n’a été fondée que sur une faute de copiste dans les manuscrits d’après
lesquels Diodore de Sicile a rédigé son ouvrage, et qui auroient dû porter, au
(1) U l ï ïO Ï [v<Aip, aqua, aquæ], Theb. .0 0 Ü T ,
Basmyr. JtflBrs. Idem est *10. NHin, moi, moa [ aqua] ,
Chald. 0 *0 , maym, Hebr. L*, mâ, Arab. Commune hoc
coeteris parvo discrimine Syris , Samaritis, Æthiopibus.
Voyez Ignatii Rossii Etymol. Ægyptiacoe, page 126.
(2) Les traces qui nous restent du Bachmourique, ne
consistent que dans deux fragmens très-peu étendus de la
version de la Bible qui paroît avoir existé dans cet ancien
dialecte : les mots que renferment ces fragmens,
présentent des différences bien remarquables avec les mots
corrélatifs des autres dialectes encore existans de la
langue Qobte moderne.
Au reste, il a paru douteux que ce dialecte ait été
effectivement parlé dans la basse Egypte, au pays de Ba-
chmour jjdís. La plupart des savans qui se sont occupés
de la langue Qobte, le reconnoissent au contraire pour un
dialecte de l’idiome du Sa’yd ; et c’est en effet dans le Sa’yd
que ces morceaux ont été trouvés. M. Quatremère a
cru pouvoir trancher la difficulté par la conjecture que ce
dialecte étoit en usage dans les Oasis. Un autre orienta-
taliste a cru, au contraire, devoir le reconnoître pour un
idiome du Fayoum; mais cette dernière opinion a été
réfutée d’un,e manière victorieuse par M. Quatremère,
qui lui-même a découvert un fragment du véritable dialecte
du Fayoum. i l me paroit cependant possible d’adopter
une hypothèse différente des précédentes, qui me
semble fondée sur les analogies des dialectes de la langue
Qobte, et dont j’ai cru même découvrir la confirmation
dans l’inscription Egyptienne alphabétique de Rosette.
(3) Voyez le Mémoire intéressant que notre collègue
M. Girard a publié sur la descHption de la vallée de
l’Egarement, et les conséquences géologiques qui résultent
de la reconnoissance qu’on en a faite, H . IV. tom. I I ,
pag. 32., note 1.
(4) Voye^ les textes Grecs rapportés dans la sixième
partie de ce Mémoire.
lieu du mot 'Aeni, celui de 'Terni, pluie, pluvieux, formé par les pluies, épithète qui,
comme on le sait, convenoit parfaitement au Nil et aux causes de ses débordemens;
alors Diodore aurait inventé toute sa fable d’Hcrcule et de Prométhée par le
seul motif de ne vouloir point rester en arrière sur l’origine de ce nom devant ses
compatriotes, qui ont toujours été amateurs du merveilleux, qu’ils adoptoient
avidement et sans examen, surtout lorsqu’il se rapportoit à quelque personnage
qui leur étoit déjà connu par leurs récits mythologiques : mais, comme cette hypothèse
pourrait elle-même paraître un paradoxe plus que hasardé, et j’avoue
qu’elle me le semble en effet, nous pouvons chercher dans une autre source
l ’origine du nom ’A sth , qui se rencontre, d’une manière très-vraisemblable, dans
une homonymie de deux mots que Diodore, dont l’oreille devoit être peu exercée
à disttaguér des nuances d’articulation étrangères à sa langue naturelle, a pu
facilement confondre, en les entendant prononcer par les prêtres Égyptiens qu’il
consultoit.
Il paraîtrait donc alors que la véritable origine de cette prétendue dénomination
étoit la ressemblance qui se trouve entre le mot [C JO u jE JU l^ Y -] »
qui, comme nous venons de le remarquer ci-dessus, a été un des noms donnés au
N i l ,' et celui de O Y a H l j u l «u-Akhem, ou O Y A P y ju ju t . ou-Alhom, qui
signifie encore maintenant aigle dans le dialecte Memphitique de la langue Qobte
moderne (i).
Avant d’aller plus lo in , je crois convenable de revenir sur le mot A ’sqouf
par lequel nous avons vu ci-dessus que les Samaritains, dans leur
version du texte Hébreu, traduisent le mot Gyhloun p r p j que porte celui-ci; et
il est à remarquer que presque tous les noms de lieux et de fleuves que renferme
le Pentateuque, ne sont pas, dans la version Samaritaine, copiés et transcrits,
mais traduits par des noms différens (2) qui tiennent évidemment à des traditions
anciennes et importantes, et dont il seroit intéressant de chercher à découvrir
l’origine : mais, ces recherches étant étrangères à l’objet de ce Mémoire, je ne m’y
arrêterai pas jc i davantage.
La seule inspection de ce mot ZûT"Ç^>V A ’sqouf, composé de cinq lettres,
dont quatre sont nécessairement radicales de leur essence, empêche de le prendre
pour une racine primitive qui ne peut en comporter que trois, le cas des racines
quadrihteres ou quintilitères étant infiniment rare non-seulement en samaritain
, mais encore en hébreu et dans les autres langues Orientales , si plutôt les
mots de cette espèce qu’on nous donne comme radicaux, ne sont eux-mémes,
non des racines véritables, mais des expressions composées de deux racines bili-
teres, soit usitées encore, soit devenues inusitées (3).
( 0 Voyez la Croze, déjà cité, pag. 10. „
la vlude“ sT /p f'"\C° 7 ¿ T '" 'IC "0m dC «NÊ,
Koujyn ix r o ïü ; celui d’Assour Haufou 13 ^ 7 ” T 4 ) Un trouve des exemples deces mots composés