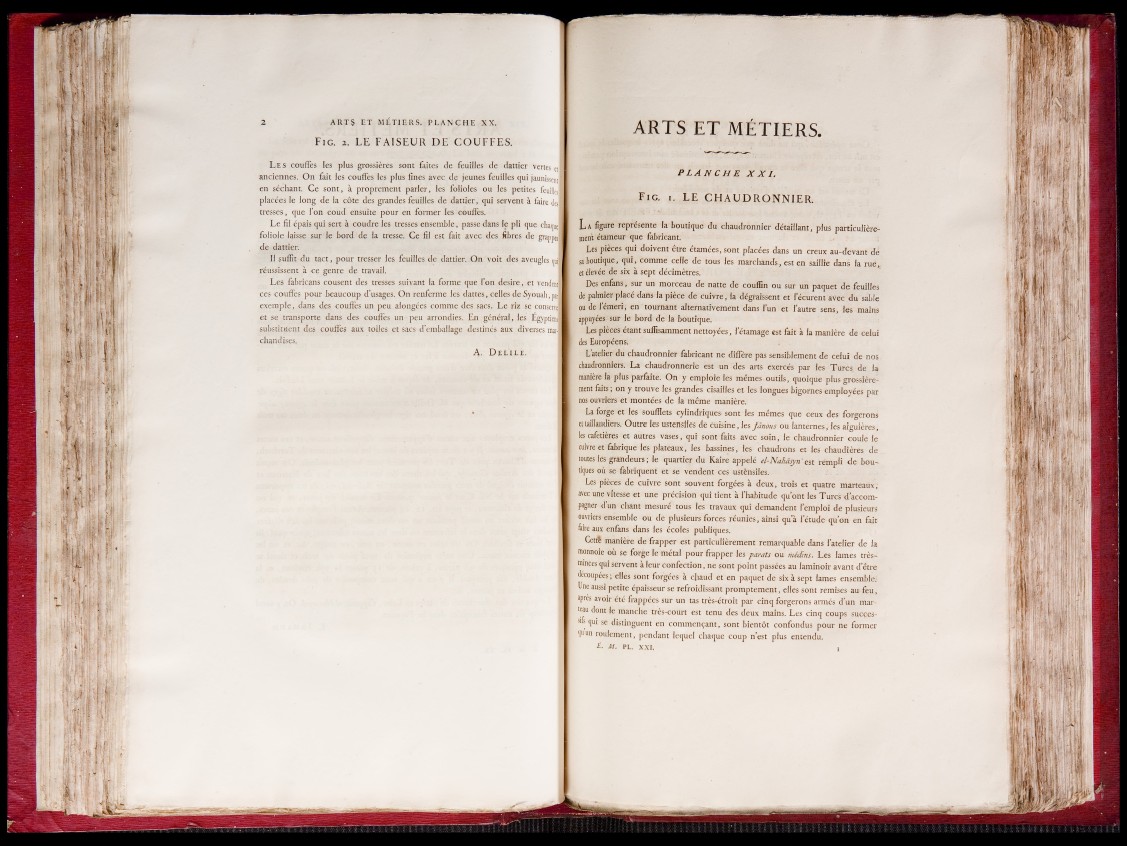
Fie. 2. LE FAISEUR DE COUFFES.
L e s couffes les plus grossières sont faites de feuilles de dattier vertes «
anciennes. On fait les couffes les plus fines avec de jeunes feuilles qui jaunissent
en séchant. Ce sont, à proprement parler, les folioles ou les petites feuilU
placées le long de la côte des grandes feuilles de dattier, qui servent à faire des!
tresses, que l’on coud ensuite pour en former les couffes.
Le fil épais qui sert à coudre les tresses ensemble, passe dans le pli que chaque!
foliole laisse sur le bord de la tresse. Ce fil est fait avec des fibres de grappeJ
de dattier.
Il suffit du tact, pour tresser les feuilles de dattier. On voit des aveugles nui
réussissent à ce genre de travail.
Les fabricans cousent des tresses suivant la forme que l’on desire, et venden|
ces couffes pour beaucoup d’usages. On renferme les dattes, celles de Syouah.paJ
exemple, dans des couffes un peu alongées comme des sacs. Le riz se conservJ
et se transporte dans des couffes un peu arrondies. En général, les Egyptiens|
substituent des couffes aux toiles et sacs d’emballage destinés aux diverses mari
chandises,
A- D e l î l e .
P L A N C H E X X I .
F ig. i . LE CH A U D R O N N I E R .
L a figure représente la boutique du chaudronnier détaillant, plus particulièrement
étameur que fabricant.
Les pièces qui doivent etre étamees, sont placées dans un creux au-devant dé
s a boutique, qui, comme celle de tous les marchands, est en saillie dans Ja rue,,
et élevée de six à sept décimètres.
Des enfans, sur un morceau de natte de couffin ou sur un paquet de feuilles
de palmier placé dans la pièce de cuivre, la dégraissent et l’écurent avec du sable
ou de l’émeri, en tournant alternativement dans l’un et l’autre sens, les mains
appuyées sur le bord de la boutique.
Les pièces étant suffisamment nettoyées, l’étamage est fait à la manière de celui
des Européens.
L’atelier du chaudronnier fabricant ne diffère pas sensiblement de celui de nos
‘ chaudronniers. La chaudronnerie est un des arts exercés par les Turcs de la
manière la plus parfaite. On y emploie les mêmes outils, quoique plus grossière-
; ment faits ; on y trouve les grandes cisailles et les longues bigornes employées par
j nos ouvriers et montées de la même manière.
La forge et les soufflets cylindriques- sont les mêmes que ceux des forgerons
et taillandiers. Outre les ustensiles de cuisine, les fânous ou lanternes,- les aiguières,
| les cafetieres et autres vases, qui sont faits avec soin, le chaudronnier coule le
| cuivre et fabrique les plateaux, les bassines, les chaudrons et les chaudières de
i toutes les grandeurs; le quartier du Kaire appelé el-Nahâsyn' est rempli de boui
tiques où se fabriquent et se vendent ces ustênsiles.
Les pièces de cuivre sont souvent forgées à deux, trois et quatre marteaux,
avec une vitesse et une précision qui tient à l'habitude qu’ont les Turcs d’accom-
: pagner d’un chant mesuré tous les travaux qui demandent l’emploi de plusieurs
ouvriers ensemble ou de plusieurs forces réunies, ainsi quà l’étude qu’on en fait
faire aux enfans dans les écoles publiques.
Cetê manière de frapper est particulièrement remarquable dans l’atelier de la
i monnoie où se forge le métal pour frapper les parats ou médins. Les lames trèsminces
qui servent à leur confection, ne sont point passées au laminoir avant d’être
découpées ; elles sont forgées à chaud et en paquet de six à sept lames ensemble;
j Une aussi petite épaisseur se refroidissant promptement, elles sont remises au feu,
après avoir été frappées sur un tas très-étroit par cinq forgerons armés d’un marteau
dont le manche très-court est tenu des deux mains. Les cinq coups sucçes-
s<s qui se distinguent en commençant, sont bientôt confondus pour ne former
<|uun roulement, pendant lequel chaque coup n’est plus entendu.
É- M. P L . X X I , t