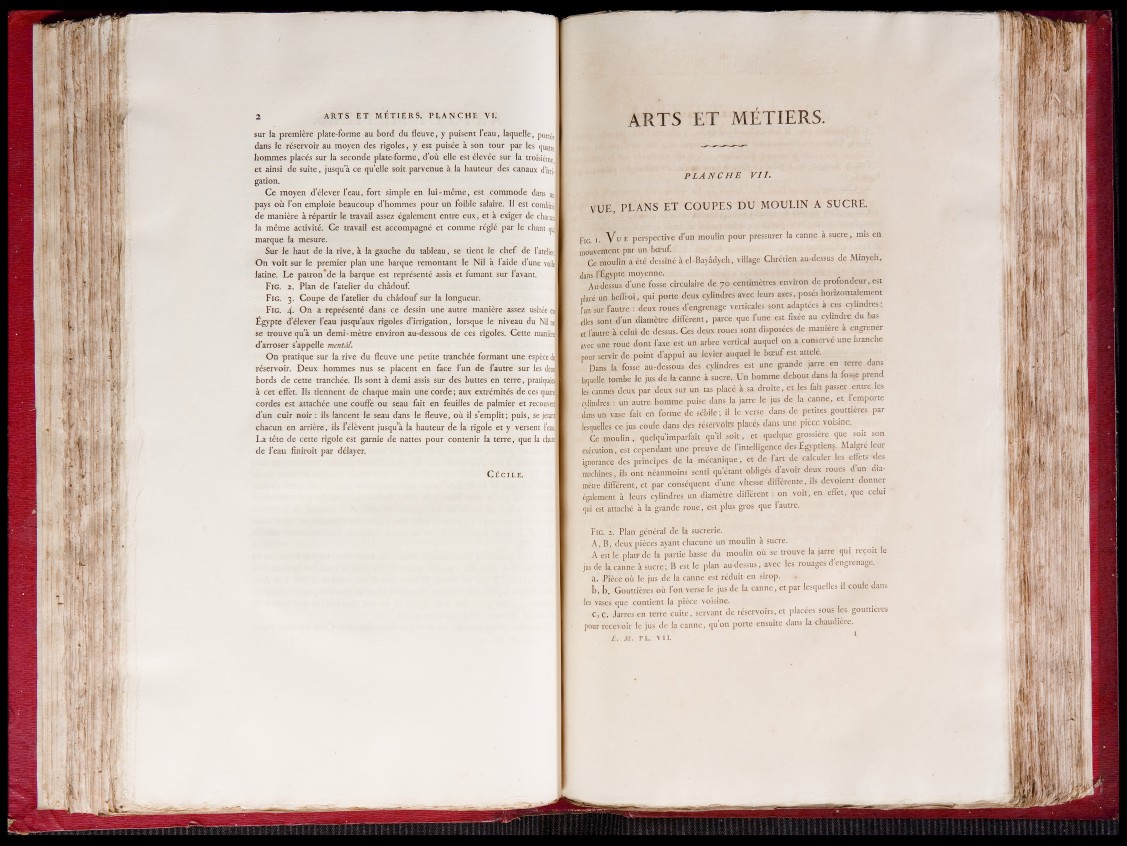
sur la première plate-forme au bord du fleuve, y puisent l’eau, laquelle, portée
dans le réservoir au moyen des rigoles, y est puisée à son tour par les quatre
hommes placés sur la seconde plate-forme, d’où elle est élevée sur la troisième
et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’elle soit parvenue à la hauteur des canaux d’irrigation.
Ce moyen d’élever l’eau, fort simple en lui-même, est commode dans J
pays où l’on emploie beaucoup d’hommes pour un foible salaire. Il est combiné
de manière à répartir le travail assez également entre eux, et à exiger de chacW
la même activité. Ce travail est accompagné et comme réglé par le chant qj
marque la mesure.
Sur le haut de la rive, à la gauche du tableau, se tient le chef de l’atelier.
On voit sur le premier plan une barque remontant le Nil à l’aide d’une voila
latine. Le patron*de la barque est représenté assis et fumant sur l’avant.
Fig. 2. Plan de l’atelier du châdoùf.
Fig. 3. Coupe de l’atelier du châdouf sur la longueur.
F ig . 4- On a représenté dans ce dessin une autre manière assez usitée en
Egypte d’élever l’eau jusqu’aux rigoles d’irrigation, lorsque le niveau du Nilnq
se trouve qu’à un demi-mètre environ au-dessous de ces rigoles. Cette manière
d’arroser s’appelle mental.
On pratique sur la rive du fleuve une petite tranchée formant une espèce del
réservoir. Deux hommes nus se placent en face l’un de l’autre sur les deuil
bords de cette tranchée. Ils sont à demi assis sur des buttes en terre, pratiquées!
à cet effet. Us tiennent de chaque main une corde ; aux extrémités de ces quatre!
cordes est attachée une couffe ou seau fait en feuilles de palmier et recouvert*
d’un cuir noir : ils lancent le seau dans le fleuve, où il s’emplit; puis, se jetanl
chacun en arrière, ils l’élèvent jusqu’à la hauteur de la rigole et y versent l’eau*
La tête de cette rigole est garnie de nattes pour contenir la terre, que la chuta
de l’eau finiroit par délayer.
C é c i l e .
P L A N C H E V U ■
VUE, PLANS ET COUPES DU MOULIN A SUCRE.
Fig i "Vu E perspective d’un moulin pour pressurer la canne à sucre, mis en
mouvement par un boeuf. T _
Ce moulin a été dessiné à el-Bayâdyeh, village Chrétien au-dessus de Minyeh,
dans i’Égypte moyenne. . - - " _ - ' .
Au-dessus d’une fosse circulaire de 70 centimètres environ de profondeur, est
placé un beffroi, qui porte deux cylindres avec leurs axes, posés horizontalement
l’un sur l’autre : deux roues d’engrenage verticales sont adaptées a ces cylindres ;
elles Sont d’un diamètre différent, parce que l’une est fixée au cylindre du bas
et l’autre à celui de dessus. Ces deux roues sont disposées de manière à engrener
avec une roue dont l’axe est un arbre vertical auquel on a conservé une branche
pour servir de point d’appui au levier auquel le boeuf est attelé.
Dans la fosse au-dessous des cylindres est une grande jarre en terre dans
laquelle tombe le jus de la canne à sucre. Un homme debout dans la fosse prend
les cannes deux par deux sur un tas placé à sa droite, et les fait passer entre les
cylindres : un autre homme puise dans la jarre le jus de la canne, et 1 emporte
dans un vase fait en forme de sébile ; il le verse dans de petites gouttières par
lesquelles ce jus coule dans des réservoirs placés dans une pièce voisine.
Ce moulin, quel qu’imparfait qu’il soit, et quelque grossière que soit son
exécution, est cependant une preuve de l’intelligence des Égyptiens. Malgré leur
ignorance des principes de la mécanique, et de l’art de calculer les effets des
machines, ils ont néanmoins senti quêtant obligés d’avoir deux roues d un diamètre
différent, et par conséquent d’une vitesse différente, ils devoient donner
également à leurs cylindres un diamètre différent : on voit, en effet, que celui
qui est attaché à la grande roue, est plus gros que 1 autre.
Fig. 2. Plan général de la sucrerie.
A , B, deux pièces ayant chacune un moulin à sucre.
A est le plan» de la partie basse du moulin où se trouve la jarre qui reçoit le
jus de la canne à sucre; B est le plan au-dessus, avec les rouages d engrenage.
a. Pièce où le jus de la canne est réduit en sirop.
b, b. Gouttières où l’on verse le jus de la canne, et par lesquelles il coule dans
les vases que contient la pièce voisine.
C, c. Jarres en terre cuite, servant de réservoirs, et placées sous les gouttières
pour recevoir le jus de la canne, qu’on porte ensuite dans la chaudière.