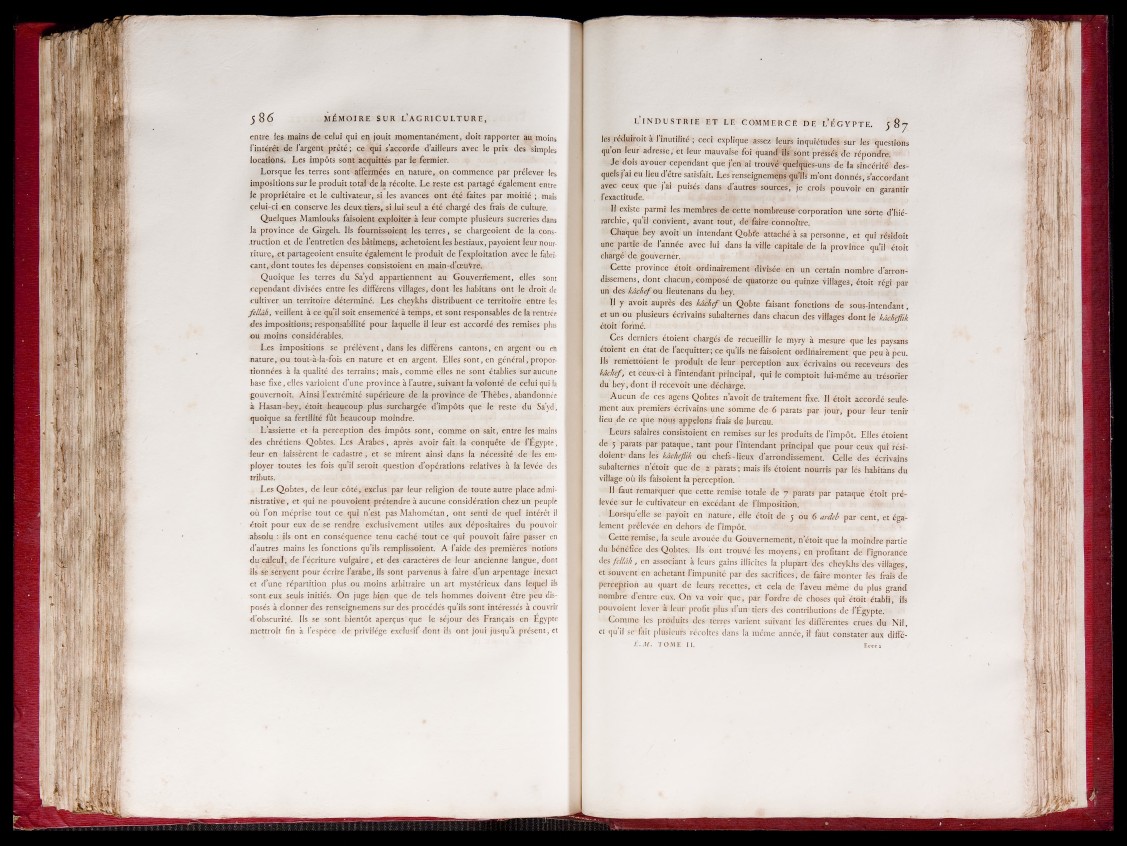
6 MÉMOIRE SUR L’AGRI CULTURE,
entre les mains de celui qui en jouit momentanément, doit rapporter au moins
l’intérêt de l’argent prêté; ce qui s’accorde d’ailleurs avec le prix des simples
locations. Les impôts sont acquittés par le fermier.
Lorsque les terres sont affermées en nature, on commence par prélever les
impositions sur le produit total delà récolte. Le reste est partagé également entre
le propriétaire et le cultivateur, si les avances ont été faites par moitié ; mais
çelui-ci en conserve les deux tiers, si lui seul a été chargé des frais de culture.
Quelques Mamlouks faisoient exploiter à leur compte plusieurs sucreries dans
la province de Girgeh. Ils fournissoient les terres, se chargeoient de la construction
et de l’entretien des bâtimens, achetoient les bestiaux, payoient leur nourriture,
et partageoient ensuite également le produit de l’exploitation avec le fabricant,
dont toutes les dépenses consistoient en main-d’oeuVre.
Quoique les terres du Sa’yd appartiennent au Gouvernement, elles sont
.cependant divisées entre les différens villages, dont les habitans ont le droit de
cultiver un territoire déterminé. Les cheykhs distribuent ce territoire entre les
fellâh, veillent à ce qu’il soit ensemencé à temps, et sont responsables de la rentrée
des impositions; responsabilité pour laquelle il leur est accordé des remises plus
ou moins considérables.
Les impositions se prélèvent, dans les différens cantons, en argent ou eh
nature, ou tout-à-la-fois en nature et en argent. Elles sont, en général, proportionnées
à la qualité des terrains; mais, comme elles ne sont établies sur aucune
base fixe, elles varioient d’une province à l’autre, suivant la volonté de celui qui la
gouvernoit. Ainsi l’extrémité supérieure de la province de Thèbes, abandonnée
à Hasan-bey, étoit beaucoup plus surchargée d’impôts que le reste du Sa’yd,
quoique sa fertilité fût beaucoup moindre.
L ’assiette et la perception des impôts sont, comme on sait, entre les mains
des chrétiens Qobtes. Les Arabes, après avoir fait, la conquête de l’Egypte,
leur en laissèrent le cadastre , et se mirent ainsi dans la nécessité de les employer
toutes les fois qu’il seroit question d’opérations relatives à la levée des
tributs.
Les Qobtes, de leur côté, exclus par leur religion de toute autre place administrative
, et qui ne pouvoient prétendre à aucune considération chez un peuple
où l’on méprise tout ce qui n’est pas Mahométan, ont senti de quel intérêt il
étoit pour eux de se rendre exclusivement utiles aux dépositaires du pouvoir
absolu : ils ont en conséquence tenu caché tout ce qui pouvoit faire passer en
d’autres mains les fonctions qu’ils remplissoient. A l’aide des premières notions
du calcul, de l’écriture vulgaire, et des caractères de leur ancienne langue, dont
ils se servent pour écrire l’arabe, ils sont parvenus à faire d’un arpentage inexact
et d’une répartition plus ou moins arbitraire un art mystérieux dans lequel ils
sont eux seuls initiés. On juge bien que de tels hommes doivent être peu disposés
à donner des renseignemens sur des procédés qu’ils sont intéressés à couvrir
d’obscurité. Ils se sont bientôt aperçus que le séjour des Français en Egypte
mettroit fin k l’espère de privilège exclusif dont ils ont joui jusqu’à présent, et
l’i n d u s t r i e e t l e c o m m e r c é d e l’é g y p t e . 5 8 7
les îéduiroit a I inutilité ; ceci explique assez leurs inquiétudes sur les questions
qu’on leur adresse; et leur mauvaise foi quand ils sont pressés de répondre.
Je dois avouer cependant que j’en ai trouvé quelques-uns de la sincérité desquels
j ai eu lieu d’être satisfait. Les renseignemens qu’ils m’ont donnés, s’accordant
avec ceux que jai puisés dans d’autres sources/ je crois pouvoir en garantir
l’exactitude.
Il existe parmi les membres de cette nombreuse corporation une sorte d’hié-
rarchie, qu’il convient, avant tout, de faire connoitre.
Chaque bey avoit un intendant Qobfe attaché à sa personne, et qui résidoit
une partie de I année avec lui dans la ville capitale de la province qu’il étoit
chargé de gouverner.
Cette province étoit ordinairement divisée en un certain nombre d’arron-
dissemens, dont chacun, composé de quatorze ou quinze villages, étoit régi par
un des kâchef ou lieutenans du bey.
Il y avoit auprès des kâchef un Qobte faisant fonctions de sous-intendant ;
et un ou plusieurs écrivains subalternes dans chacun des villages dont le kâcheflïk
étoit formé.
Ces derniers étoient chargés de recueillir le myry à mesure que les paysans
ctoient en état de 1 acquitter; ce quils ne faisoient ordinairement que peu à peu.
Ils remettoient le produit de leur perception aux écrivains ou receveurs des
kachef , et ceux-ci a I intendant principal, qui le comptoit lui-même au trésorier
du bey, dont il recevoit une décharge.
Aucun de ces agens Qobtes n avoit de traitement fixe. Il étoit accordé seulement
aux premiers écrivains une somme de 6 parats par jour, pour leur tenir
lieu de ce que nous appelons frais de bureau.
Leurs salaires consistoient en remises sur les produits de l’impôt. Elles étoient
de y parats par pataque, tant pour l’intendant principal que pour ceux qui rési-
doienf dans les kâcheflïk ou chefs-lieux d’arrondissement. Celle des écrivains
subalternes n’étoit que de 2 parats; mais ils étoient nourris par lés habitans du
village où ils faisoient la perception.
Il faut remarquer que cette remise totale de 7 parats par pataque étoit prélevée
sur le cultivateur en excédant de l’imposition.
Lorsqu elle se paÿoit en nature, ëlle etoit de y ou 6 ardeb par cent, et également
prélevée en dehors de l’impôt.
Cette îemise, la seule avouee du Gouvernement, n’étoit que la moindre partie
du bénéfice des Qobtes. Us ont trouvé les moyens, en profitant de l’ignorance
des fellah, en associant a leurs gains illicites la plupart des cheykhs des villages,
et souvent en achetant 1 impunité par des sacrifices, de faire monter les frais de
peiceptioir au quart de leurs recettes, et cela de l’aveu même du plus grand
nombie dentre eux. On va voir que, par 1 ordre dè choses qui étoit établi, ils
pouvoient lever a leur profit plus d’un tiers des contributions de l’Égypte.
Comme les produits des terres varient suivant les différentes crues du Nil,
et qu il se fait plusieurs récoltés dans la même année, il faut constater aux diffeÊ
. M . T O M E I I . E c e e ,