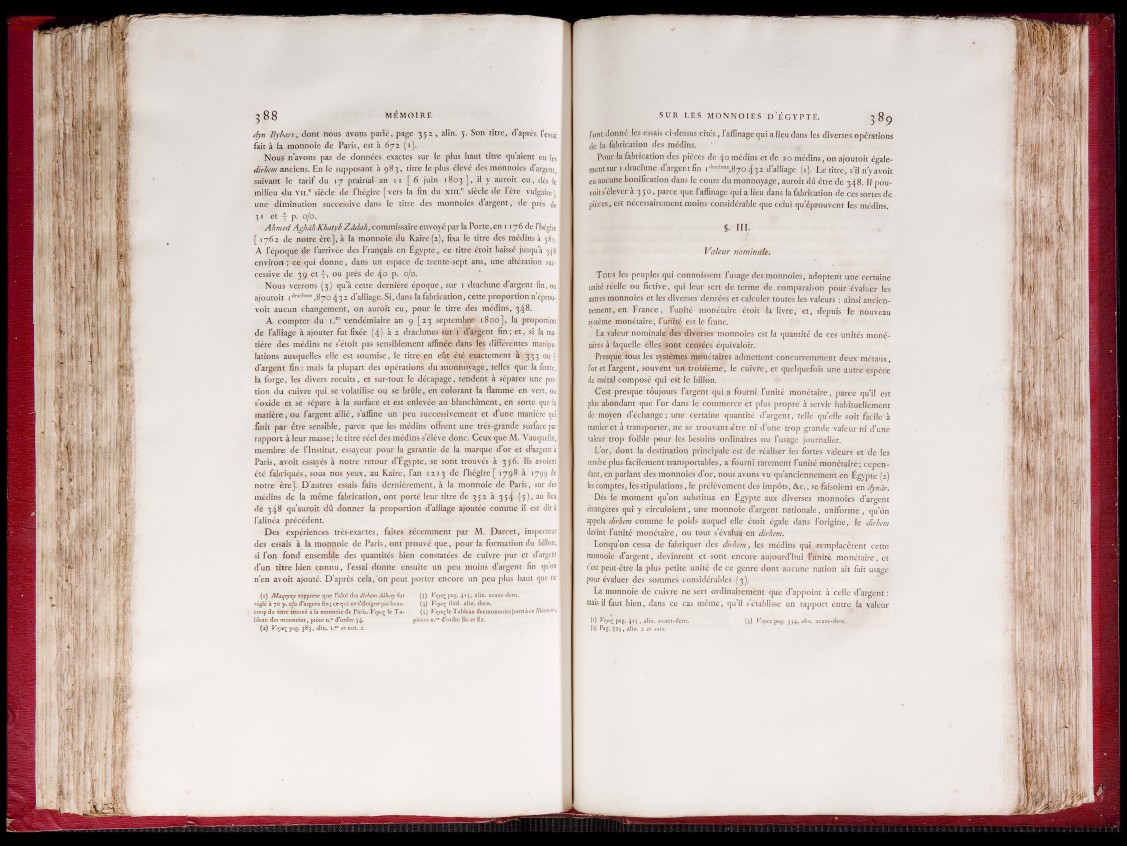
3 8 8 MÉMOIRE
efyn Bybars, dont nous avons parlé, page 3 5 2 , alin. 5. Son titre, d’après l’essai
fait à la monnoie de Paris, est à 672 (j).
Nous n’avons pas de données exactes sur le plus haut titre qu’aient eu les
dirhem anciens. En le supposant à 983, titre le plus élevé des monnoies d’argent,
suivant le tarif du 17 prairial an 11 [ 6 juin 1803 ] , il y auroit eu, dès le j
milieu du v u .' siècle de l’hégire [vers la fin du XIII.' siècle de 1ère vulgaire],
une diminution successive dans le titre des monnoies d’argent, de près de
31 et ~ p. ofo.
Ahmed Aghâh Khatyb Zâdah, commissaire envoyé par la Porte, en 1176 de l’hégire
[ 1762 de notre ère], à la monnoie du Kaire (2), fixa le titre des médins à 580.1
A l’époque de l’arrivée des Français en Egypte, ce titre étoit baissé jusqu’à 3]8
environ ; ce qui donne, dans un espace de trente-sept ans, une altération suc-j
cessive de 39 et j , ou près de 4° P- 0/0.
Nous verrons (3) qu’à cette dernière époque, sur 1 drachme d’argent fin, on j
ajoutoit iJrschra' ,870 432 d’alliage. Si, dans la fabrication, cette proportion 11’éprou-1
voit aucun changement, on auroit eu, pour le titre des médins, 348.
A compter du 1." vendémiaire an 9 [23 septembre 1800], la proportion]
de l’alliage à ajouter fut fixée (4) à 2 drachmes sur 1 d’argent fin ; et, si la ma-1
tière des médins ne s’étoit pas sensiblement affinée dans les différentes manipu-1
lations auxquelles elle est soumise, le titre en eût été exactement à 333 ou]I
d’argent fin : mais la plupart des opérations du monnoyage, telles que la fonte, I
la forge, les divers recuits, et sur-tout le décapage, tendent à séparer une por-1
tion du cuivre qui se volatilise ou se brûle, en colorant la flamme en vert, oui
s’oxide et se sépare à la surface et est enlevée au blanchiment, en sorte que la]
matière, ou l’argent allié, s’affine un peu successivement et d’une manière qui |
finit par être sensible, parce que les médins offrent une très-grande surface par]
rapport à leur masse ; le titre réel des médins s’élève donc. Ceux que M. Vauquelin, |
membre de l’Institut, essayeur pour la garantie de la marque d’or et d*argein à |
Paris, avoit essayés à notre retour d’Egypte, se sont trouvés à 356. Ils avoient]
été fabriqués, sous nos yeux, au Kaire, l’an 1213 de l’hégire [ 1798 à 1799 de]
notre ère]. D ’autres essais faits dernièrement, à la monnoie de Paris, sur des]
médins de la même fabrication, ont porté leur titre de 352 à 3 j4 (j)> au ^eu|
de 348 qu’auroit dû donner la proportion d’alliage ajoutée comme il est dit à |
l’alinéa précédent.
Des expériences très-exactes, faites récemment par M. Darcet, inspecteur]
des essais à la monnoie de Paris, ont prouvé que, pour la formation du billon, ]
si l’on fond ensemble des quantités bien constatées de cuivre pur et d argent
d’un titre bien connu, l’essai donne ensuite un peu moins d’argent fin quon]
n’en avoit ajouté. D ’après cela/on peut porter encore un peu plus haut que ne j
(1) Maqiyzy rapporte que Faloi des dirhem dâhery fut
réglé à 70 p. 0J0 d’argent fin ; ce qui ne s’éloigne pas beaucoup
du titre trouvé à la monnoie de Paris. Voye^ le Ta-
bleau des monnoies, pièce n.° d’ordre 54*
(2) Voye^ pag. 383, alin. i.er et not. 2.
(3) Voye^ pag. 4 > 5 > alin. avant-dërn.
(4) Voyeç ibid. alin. dem.
(5) le Tableau des monnoies joint à ce Mémoire,
pièces n.°* d’ordre 80 et 82.
SUR L ES M O N N O I E S d ’É G Y P T Ë . 3 ^ 9
font donné les essais ci-dessus cités, 1 affinage qui a lieu dans les diverses opérations
de la fabrication des médins.
Pour la fabrication des pièces de 4o médins et de 20 médins, on ajoutoit.égale-
mentsuri drachme d’argentfin 1 dracl,mc,870 432 d’alliage (1). Le titre, s’il n’y avoit
eu aucune bonification dans le cours du monnoyage, auroit dû être de 348. Il pou-
voit s’élever 8350, parce que l’affinage qui a lieu dans la fabrication de ces sortes de
pièces, est nécessairement moins considérable que celui qu’éprouvent les médins.
§. III.
Valeur nominale.
Tous les peuples qui connoissent l’usage des monnoies, adoptent une certaine
unité réelle ou fictive, qui leur sert de terme de comparaison pour évaluer les
autres monnoies et les diverses denrées et calculer toutes les valeurs : ainsi anciennement,
en France, l’upité monétaire étoit la livre, et, depuis le nouveau
système monétaire, l’unité est le franc.
La valeur nominale des diverses monnoies est la quantité de ces unités monétaires
à laquelle elles] sont censées équivaloir.
Presque tous les systèmes monétaires admettent concurremment deux métaux
l’or et l’argent, souvent un troisième, le cuivre, et quelquefois une autre espèce
de métal composé qui est le billon.
Cest presque toujours l’argent qui a fourni l’unité monétaire, parce qu’il est
plus abondant que l’or dans le commerce et plus propre à servir habituellement
de moyen d’échange ; une certaine quantité d’argent, telle qu’elle soit facile à
manier et à transporter, ne se trouvant .être ni d’une trop grande valeur ni d’une
valeur trop foible pour les besoins ordinaires ou l’usage journalier.
L’or, dont la destination principale est de réaliser les fortes valeurs et de les
rendre plus facilement transportables, a fourni rarement l’unité monétaire; cependant,
en parlant des monnoies d’or, nous avons vu qu’anciennement en Égy'pte (2)
les comptes, les stipulations, le prélèvement des impôts, &c., se fàisoient en dynâr.
Dès le moment qu’on substitua en Egypte aux diverses monnoies d’argent
étrangères qui y circuloient, une monnoie d’argent nationale, uniforme, qu’on
appela dirhem comme le poids auquel elle étoit égale dans l’origine, le dirhem
devint l’unité monétaire, ou tout s’évalua en dirhem.
Lorsqu’on cessa de fabriquer des dirhem, les médins qui remplacèrent cette
monnoie d’argent, devinrent et sont encore aujourd’hui l’unité monétaire, et
cest peut-être la plus petite unité de ce genre dont aucune nation ait fait usage
pour évaluer des sommes considérables ( 3 ).
La monnoie de cuivre ne sert ordinairement que d’appoint à celle d’argent ;
mais il faut bien, dans ce cas même, qu’il s’établisse un rapport entre la valeur
{') Voye^ pag. 4*5» alin. avant-dern.
(2) Pag. 325, alin. 2 et suiv.
(3) Voyez pag. 334, alin. avant-dern.
• a à ¿ -v- .í y -ÍlT7? J& T i