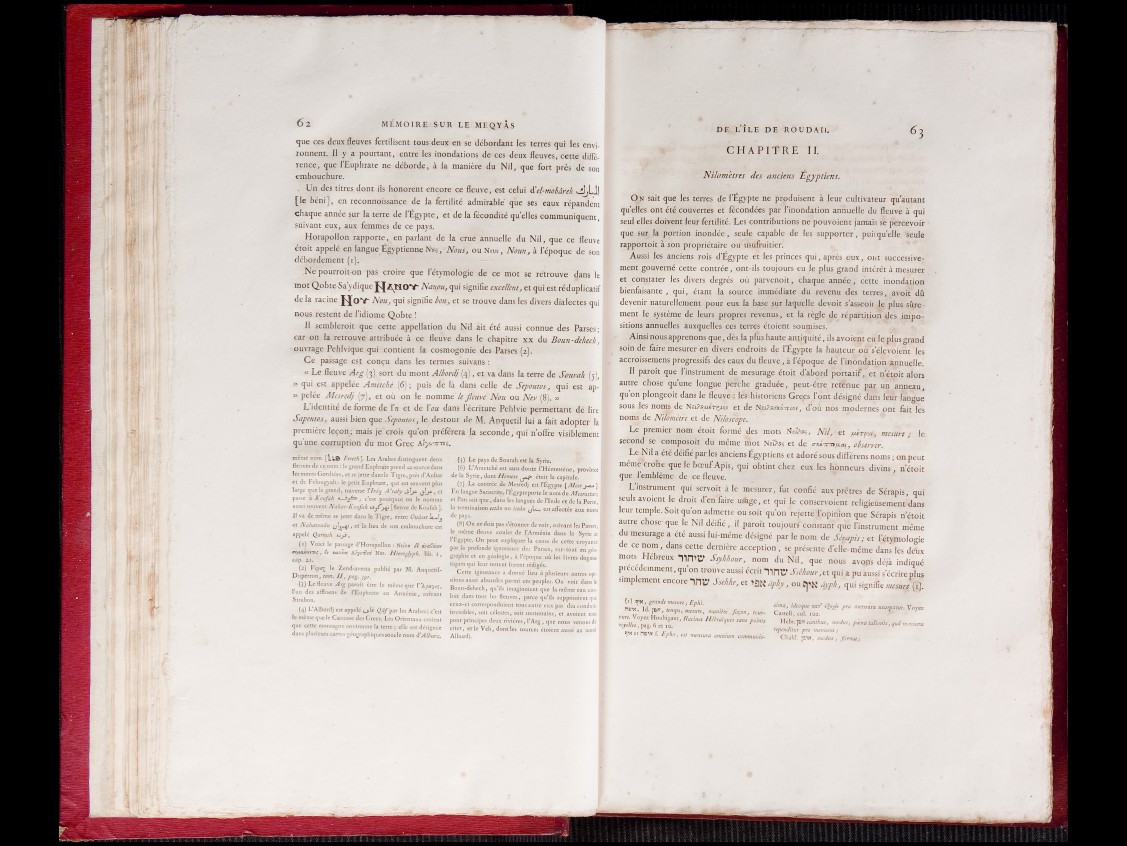
que ces deux fleuves fertilisent tous deux en se débordant les terres qui les environnent.
Il y a pourtant, entre les inondations de ces deux fleuves, cette différence,
que l’Euphrate ne déborde, à la manière du Nil, que fort près de son !
embouchure.
. Un des titres dont ils honorent encore ce fleuve, est celui d’el-mobârcl ciKUl ■
[le béni], en reconnoissance de la fertilité admirable' que ses eaux répandent
chaque année sur la terre de l’Égypte, et de la fécondité quelles communiquent,
suivant eux, aux femmes de ce pays.
Horapolion rapporte, en parlant de la crue annuelle du Nil, que ce fleuve
étoit appelé en langue Égyptienne N k 5 , Nous, ouNouv, Noun, à l'époque de son
débordement (i).
Ne pourroit-on pas croire que letymologie de ce mot se retrouve dans le
mot Qobte-Sa’ydique Nanou, qui signifie excellent, et qui est réduplicatif ’
de la racine [ J o Y Non, qui signifie bon, et se trouve dans les divers dialectes qui
nous restent de l’idiome Qobte !
Il sembleroit que cette appellation du Nil ait été aussi connue des Parses;
car on la retrouve attribuée à ce fleuve dans le chapitre x x du Boun-dchech, 1
-ouvrage Pehlvique qui contient la cosmogonie des Parses (2).
C e passage est conçu dans les termes suivans :
« Le fleuve Arg (3) sort du mont Albordj (4), et va dans la terre de Soarah (<), 1
L» qui est appelée Amctché (6) ; puis de là dans celle de Sepoutos, qui est ap-1
» pelée Mesredj (7), et où on le nomme le fleuve Nou ou Nev (8). »
L identité de forme de l’a et de \'ou dans l’écriture Pehlvie permettant de lire I
Sapentos, aussi bien que Sepoutos, le destour de M. Anquetil lui a fait adopter la .
première leçon ; mais je crois qu’on préférera la seconde, qui n’offre visiblement I
qu’une corruption du mot Grec Aîyi/7rraç.
meme nom [ l . i S Ffrtt/i]. Les Arabes distinguent deux
fleuves de ce nom : le grand Euphrate prend sa source dans
les monts Gordiées, et se jette dans le Tigre, près d’Anbar
et de Felougyah: le petit Euphrate, qui est souvent plus
large que le grand, traverse Y Iraq A'raby , et
passe à Kouf ah *■— ; c’est pourquoi on le nomme
aussi souvent Nahar-Koufali ù j f y ÿ [fleuve de Koufah].
11 va de même se jeter dans le Tigre, entre Ouaset k
et Naharouan » c* 1£ lieu de son embouchure est
appelé Qarnah j 3 .
(1) Voici le passage d’HorapolIon : Nî/àk Si àmÇdmi
n/Munrnç, Si xaMa KlyjJhd Nw. Hieroglyph. lib. I ,
cap. 21.
(2) Voyez le Zend-avesta publié par M. Anquetil-
Duperron, tom. I I , pag.jp/.
(3) Le fleuve Arg paraît être le même que Y'Afetyoi,
l’un des affluens âe l’Euphrate en Arménie, suivant
Strabon.
(4) L’AIbordj est appelé <_>ü QAf par les Arabes; c’est
le même que le Caucase des Grecs. Les Orientaux croient
que cette montagne environne la terre ; elle est désignée
dans plusieurs cartes géographiques sous le nom d'Alburz.
(5) Le pays de Sourah est la Syrie.
(6) L’Ametché est sans doute l’Hémessène, province (
de la Syrie, dont Hemess y*#- étoit la capitale.
(7) La contrée de Mesredj est l’Égypte [M e s r j^ ]. î
En langue Sanscrite, I’Egypteporte le nom de Mesrastan; E
et l’on sait que, dans les langues de l’Inde et de la Perse, f
la terminaison estân ou istân (jU» est affectée aux noms I
de pays.
(8) On ne doit pas s’étonner de voir, suivant les Parses, i
le même fleuve couler de l’Arménie dans la Syrie et I
l’Egypte. On peut expliquer la cause de cette croyance I
parla profonde ignorance des Parses, sur-tout eh géo-1
graphie et en géologie, à l’epoque où les livres dogma- I
tiques qui leur restent furent rédigés.
Cette ignorance a donne lieu à plusieurs autres opi- I
nions aussi absurdes parmi ces peuples. On’ voit dans le I
Boun-dehech, qu’ils imaginoient que la même eau cou- I
loit dans tous les fleuves, parce qu’ils supposoient que I
ceux-ci correspondoient tous entre eux par des conduits I
invisibles, soit célestes, soit souterrains, et avoient tous I
pour principes deux rivières, I’A rg , que nous venons de I
citer, et le Veh, dont les sources étoient aussi au mont I
Albordj.
C H A P I T R E II.
kilomètres des anciens Égyptiens.
O n sait que les terres de l’Êgypte ne produisent à leur cultivateur qu’autant
qu’elles ont été couvertes et fécondées par l’inondation annuelle du fleuve à qui
seul elles doivent leur fertilité. Les contributions ne pouvôient jamais se percevoir
que sur la portion inondée, seule capable de les supporter, puisqu'elle seule
rapportoit à son propriétaire ou usufruitier.
Aussi les anciens rois d’Égypte et les princes qui, après eux, ont successivement
gouverné cette contrée, ont-ils toujours eu le plus grand intérêt à mesurer
et constater les divers degrés où parvenoit, chaque année, cette inondation
bienfaisante, qui, étant la source immédiate du revenu des terres, avoit dû
devenir naturellement pour eux la base sur laquelle devoit s’asseoii le plus sûrement
le système de leurs propres revenus, et la règle de répartition des impositions
annuelles àuxquelles ces terrés étoient soumises.
Ainsi nous apprenons que, dès la plus haute antiquité, ils avoient eu le plus grand
soin de faire mesurer en divers endroits de l’Égypte la hauteur où s’élevoient les
accroissemens progressifs des eaux du fleuve, à l’époque de l’inondation annuelle.
Il paroît que l’instrument de mesurage étoit d’abord portatif ,’ et n’étoit alors
autre chose qu’une longue perche graduée, peut-être reténue par un anneau,
qu on plongeoit dans le fleuve : les historiens Grecs l’ont désigné dans leur langue
sous les noms de NeiAs^eT^tov et de Nëî/.9oxcvtiov , d’où nos modernes ont fait lés
noms de Nilomètre et de Niloscope.
Le premier nom étoit formé des mots NréAsi, N il, et /Arpot, mesure ; le
second se composoit du même mot NefAs? et de observer.
Le Nil a été déifié par les anciens Égyptiens et adoré sous différens noms ; on peut
meme crone que le boeuf Apis, qui obtint chez eux les honneurs divins , ff’étoit
que l’emblème de ce fleuve.
L’instrument qui servoit à le mesurer, fut confié aux prêtres de Sérapis, qui
seuls avoient le droit d’en faire usége, et qui le co n sen ten t religieüsement’dans
leur temple. Soit qu’on admette ou soit qu’on rejette l’opinion que Sérapis n’étoit
autre chose-que le Nil déifié, il paroît toujours constant que l’instrument même
du mesurage a été aussi lui-même désigné par le nom de Sér.apis; et letymologie
de ce nom, dans cette dernière acception, se présente d’elle-même dans les deùx
mots Hebreux TUTÏÏf Ssylhour, nom du Nil, que nous avons déjà indiqué
précédemment, qu’on trouve aussi écrit n m p Ssêbour,t t qui a pu aussi s’écrire plus
simp ement encore iniC? Ssehhr, et îtJM àply, ou âyph, qui signifie mesure ( t).
(0 , grande mesure: Ephi. •. , ,y ,
* ■ «■ P " > f Ë § { J L , tnauiiro. fa ç o n , t o u , c 2 û I T Z M M P *
R aCm a H ê i 'ra' qUCS ^ P ° in,S Hebr’ p * « * » . — ta lio n i,, quâ inensuru
^ J? c p , rependitur pro mensura ;
1 est mensura omnium commuais- ChalcI. jew, modus, formai