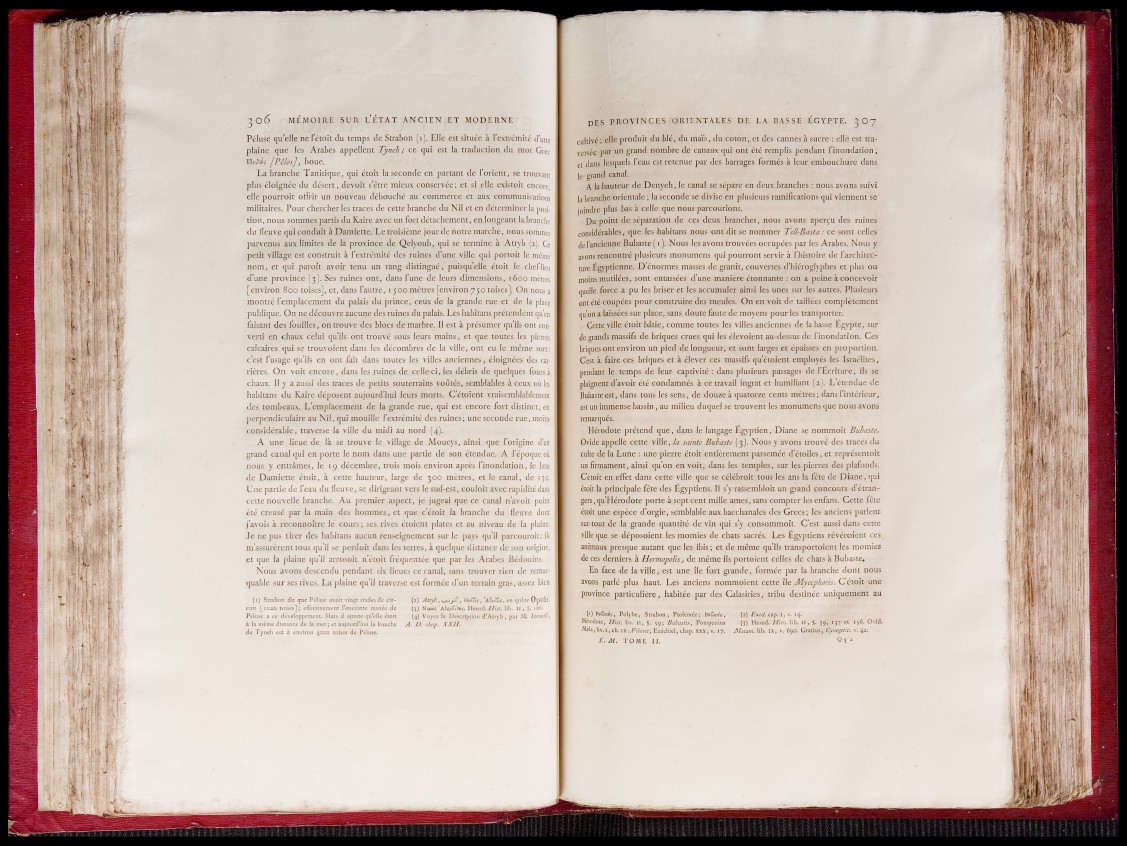
3 0 6 MÉMOIRE SUR l ’ÉTAT ANCIEN ET MODERNE
Péluse qu’elle ne l’étoit du temps de Strabon (t). Elle est située à l’extrémité d’une
plaine que les Arabes appellent Tyneli ; ce qui est la traduction du mot Grec
XIiiAss fP êlos], boue.
La branche Tanitique, qui étoit la seconde en partant de l’orient, se trouvant
plus éloignée du désert, devoit s’être mieux conservée; et si elle existoit encore
elle pourroit offrir un nouveau débouché au commerce et aux communications
militaires. Pour chercher les traces de cette branche du Nil et en déterminer la position,
nous sommes partis du Kaire avec un fort détachement, en longeant la branche
du fleuve qui conduit à Damiette. Le troisième jour de notre marche, nous sommes
parvenus aux limites de la province de Qelyoub, qui se termine à Atryb (2). Ce
petit village est construit à l’extrémité des ruines d’une ville qui portoit le mente
nom, et qui paroît avoir tenu un rang distingué, puisqu’elle étoit le chef-lieu
d’une province (3). Ses ruines ont, dans l’une de leurs dimensions, 1600 mètres
[environ 800 toises], et, dans l’autre, 1 y00 mètres [environ 750 toises]. On nous a
montré l’emplacement du palais du prince, ceux de la grande rue et de la place
publique. On ne découvre aucune des ruines du palais. Les habitans prétendent qu’en
faisant des fouilles, on trouve des blocs de marbre. Il est à présumer qu’ils ont converti
en chaux celui qu’ils ont trouvé sous leurs mains, et que toutes les pierres
calcaires qui se trouvoient dans les décombres de la ville, ont eu le même sort:
c’est l’usage qu’ils en ont fait dans toutes les villes anciennes, éloignées des carrières.
On voit encore, dans les ruines de celle-ci, les débris de quelques fours à
chaux. Il y a aussi des traces de petits souterrains voûtés, semblables à ceux où les
habitans du Kaire déposent aujourd’hui leurs morts. C’étoient vraisemblablement
des tombeaux. L ’emplacement de la grande rue, qui est encore fort distinct, est
perpendiculaire au Nil, qui mouille l’extrémité des ruines; une seconde rue, moins
considérable, traverse la ville du midi au nord (4).
A une lieue de là se trouve le village de Moueys, ainsi que l’origine d’un
grand canal qui en porte le nom dans une partie de son étendue. A l’époque où
nous y entrâmes, le 19 décembre, trois mois environ après l’inondation, le bras
de Damiette étoit, à cette hauteur, large de 300 mètres, et le canal, de 150.
Une partie de l’eau du fleuve, se dirigeant vers le sud-est, couloit avec rapidité dans
cette nouvelle branche. A u premier aspect, je jugeai que ce canal n’avoit point
été creusé par la main des hommes, et que c’étoit la branche du fleuve dont
j’avois à reconnoître lé cours ; ses rives étoient plates et au niveau de la plaine.
Je ne pus tirer des habitans aucun renseignement sur le pays qu’il parcouroit; ils
m’assurèrent tous qu’il se perdoit dans les terres, à quelque distance de son origine,
et que la plaine qu’il arrosoit n’étoit fréquentée que par les Arabes Bédouins.
Nous avons descendu pendant six lieues ce canal, sans trouver rien de remarquable
sur ses rives. La plaine qu’il traverse est formée d’un terrain gras, assez bien
(1) Strabon dit que Péluse avoit vingt stades de cir- (2) Atryb, , QptCiç, *AfipiCiçf en qo bte 0 pE&!<
cuit [1020 toises]; effectivement l’enceinte murée de (3) NquoV ’A06t<fmr. Herod. H ¡st. Iib. I l , §. 166.
Péluse a ce développement. Mais il ajoute qu’elle étoit (4) Voyez la Description d’Atryb, par M. Jomard,
à la même distance de la mer; et aujourd'hui la bouche A . D, chap. XXII.
de Tyneh est à environ 4000 toises dé Péluse.
DES PROVINCES ORIENTALES DE LA BASSE EGYPTE. 3 O 7
cultivé ; elle produit du blé, du maïs, du coton, et des cannés à sucre : elle est traversée
par un grand nombre de canaux qui ont été remplis pendant l’inondation,
et dans lesquels l’eau est retenue par des barrages formés à leur embouchure dans,
le grand canal.
A la hauteur de Denyeh, le canal se sépare en deux branches : nous avons suivi
la branche orientale ; la seconde se divise en plusieurs ramifications qui viennent se
joindre plus bas à celle que nous parcourions.
Du point de séparation de ces deux branches, nous avons aperçu des ruines
con s id é ra b le s , que les habitans nous ont dit se nommer Tell-Basta : ce sont celles
de l’ancienne Bubaste ( i ). Nous les avons trouvées occupées par les Arabes. Nous y
avons rencontré plusieurs monumens qui pourront servir à l’histoire de l’architecture
Égyptienne. D ’énormes masses de granit, couvertes d’hiéroglyphes et plus ou
moins mutilées, sont entassées d’une manière étonnante : on a peine à concevoir
quelle force a pu les briser et les accumuler ainsi les unes sur les autres. Plusieurs
ont été coupées pour construire des meules. On en voit de taillées complètement
qu’on a laissées sur place, sans doute faute de moyens pour les transporter.
Cette ville étoit bâtie, comme toutes les villes anciennes de la basse Egypte, sur
de grands massifs de briques crues qui les élevoient au-dessus de l’inondation. Ces
briques ont environ un pied de longueur, et sont larges et épaisses en proportion.
C’est à faire ces briques et à élever ces massifs qu’étoient employés les Israélites,
pendant le temps de leur captivité ; dans plusieurs passages de l’Ecriture, ils se
plaignent d’avoir été condamnés à ce travail ingrat et humiliant (2). L ’étendue de
Bubaste est, dans tous les sens, de douze à quatorze cents mètres ; dans l’intérieur,
est un immense bassin, au milieu duquel se trouvent les monumens que nous avons
remarqués.
Hérodote prétend que, dans le langage Égyptien, Diane se nommoit Bubaste.
Ovide appelle cette ville, la sainte Bubaste (3). Nous y avons trouvé des traces du
culte de la Lune ; une pierre étoit entièrement parsemée d’étoiles, et représentoit
un firmament, ainsi qu’on en voit, dans les temples, sur les pierres des plafonds.
Cétoit en effet dans cette ville que se célébroit tous les ans la fête de Diane, qui
étoit la principale fête des Égyptiens. Il s’y rassembloit un grand concours d’étrangers,
qu’Hérodote porte à sept cent mille ames, sans compter les enfans. Cette fête
étoit une espèce d’orgie, semblable aux bacchanales des Grecs; les anciens parlent
sur-tout de la grande quantité de vin qui s’y consommoit. C’est aussi dans cette
ville que se déposoient les momies de chats sacrés. Les Égyptiens révéroient ces
animaux presque autant que les ibis ; et de même qu’ils transportoient les momies
de ces derniers à Hermopolis, de même ils portoient celles de chats à Bubaste.
En face de la ville, est une île fort grande, formée par la branche dont nous
avons parlé plus haut. Les anciens nommoient cette île Myccphoris. Cétoit une
province particulière, habitée par des Calasiries, tribu destinée uniquement au
(1) Bviatiçy Polybe, Strabon, Ptolémée ; BvCaçi'ç, (2) Exod. cap. I , v. 14-
Hérodote, Hist. lïv. 11, §. 59; Bubastis, Pomponius (3) Herod. Hist. Iib. I I , S- 59» 137 et 15^* Ovid.
Mêla, liv. 1, ch. ix ; Pibeset, Ezéchiel, chap. XXX, v. 17. Metam. Iib. IX , v. 690. Gratius, Cynegetic. v. 4*•
Ê . M . T O M E I I . \ R i I