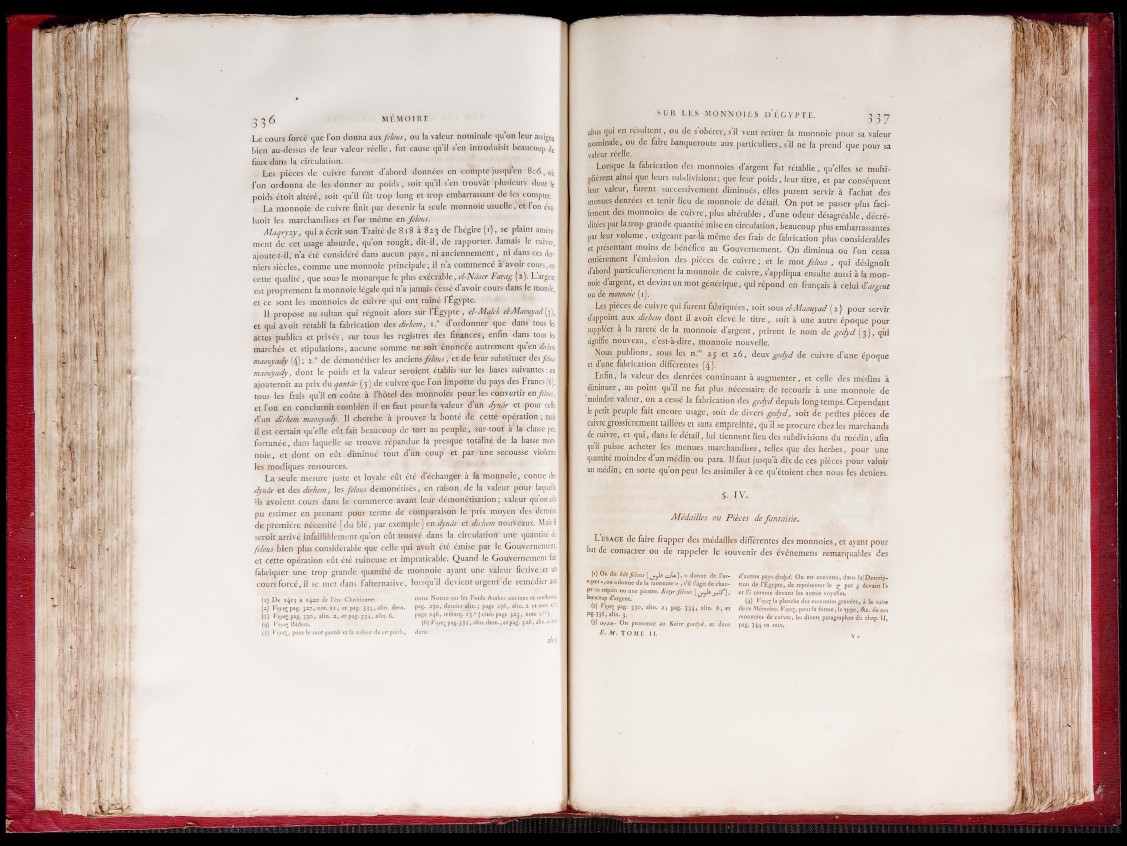
-> ■> 6 M É M O I R E
3 3 Le cours forcé que l’on donna aux felous, ou la valeur nominale qu’on leur assigna I
bien au-dessus de leur valeur réelle, fut cause qu’il s’en introduisit beaucoup ¿e I
faux dans la circulation.
Les pièces de cuivre furent d’abord données en compte jusqu en 806, où I
l’on ordonna de fes donner au poids , soit qu’il s’en trouvât plusieurs dont le I
poids étoit altéré , soit qu’il fût trop long et trop embarrassant de les compter. I
La monnoie de cuivre finit par devenir la seule monnoie usuelle, et I on eva- I
luoit les marchandises et l’or même en filous.
Mnqryzy, qui a écrit son Traité de 818 à 823 de 1 hégire (i!) , se plaint amère-1
ment de cet usage absurde, qu’on rougit, dit-il, de rapporter. Jamais le cuivre, I
ajoute-t-il, n’a été considéré dans aucun pays, ni anciennement, ni dans ces der- I
niers siècles, comme une monnoie principale; il n’a commencé à'avoir cours,en I
cette qualité, que sous le monarque le plus exécrable, el-Nâser Farag (2). L’argent I
est proprement la monnoie légale qui n’a jamais cessé d’avoir cours dans le monde, I
et ce sont les monnoies de cuivre qui ont ruiné 1 Égypte.
Il propose au sultan qui régnoit alors sur l’Égypte , el-Mqlek el-Maouyad (3) , I
et qui avoit rétabli la fabrication des dirhem, i.° d’ordonner que dans tous les I
actes publics et privés, sur tous les registres des finances, enfin dans tous les I
marchés et stipulations, aucune somme ne soit enoncce autrement quen dirlitm I
maouyady (4); 2.0 de démonétiser les anciens felous, et de leur substituer des films I
Viaouyady, dont le poids et la valeur seroient établis1 sur les bases suivantes : on I
ajouteroit au prix du qantâr ( y) de cuivre que I on importe du pays des Francs(6), I
tous les frais qu’il en coûte à l’hôtel des monnoies pour les convertir en filous, I
et l’on en concluroit combien il en faut pour la valeur d’un dynâr et pour celle I
d’un dirhem muoiyndy. Il cherche a prouver la bonté de cette opération , mais I
il est certain qu elle eût fait beaucoup de tort au peuple, sur-tout a la classe peu I
fortunée, dans laquelle se trouve répandue la presque totalité de la basse mon-1
noie, et dont on eût diminué tout dun coup et par une secousse violenteI
les modiques ressources.
La seule mesure juste et loyale eût été déchanger à la monnoie, contre des!
dynâr et des dirhem, les felous démonétisés, en raison de la valeur pour laquelle!
ils avoient cours dans le commerce avant leur démonétisation ; valeur qu’on eût I
pu estimer en prenant pour terme de comparaison le prix moyen des denrees I
de première nécessité [du blé, par exemple] en dynâr et dirhem nouveaux. Mais il I
seroit arrivé infailliblement qu’on eût trouve dans la circulation une quantité de I
filous bien plus considérable que celle qui avoit été émise par le Gouvernement, I
et cette opération eût été ruineuse et impraticable. Quand le Gouvernement fait I
fabriquer une trop grande quantité de monnoie ayant une valeur fictive et un I
cours forcé, il se met dans l’alternative, lorsqu’il devient urgent de remédier aux I
(1) De 1415 à 1420 de l’ère Chrétienne. notre Notice sur les Poids Arabes anciens et moderne, I
(2) Voye^ pag. 327, not. 1 1 , et pag. 335 , alin. dern. pag- 23°. dernier afin.; page 236, alin. 2 et note l.” i I
(3) Voyei pag. 330, alin. 2 , et pag. 334, alin. 6. page 246, remarq. 13.” (cirée page 323 , note 1.").
(4) Koyej ibidem. (6) Koréj pag. 335, alin. dern., et pag' 326, alin.avanl- I
(5) V o y e pour le mot qantâr et la valeur de ce poids, dern.
abus I
abus qui en îésultent, ou de s obérer, sil veut retirer la monnoie pour sa valeur
nominale, ou de faire banqueroute aux particuliers, sil ne la prend que pour sa
valeur réelle.
Lorsque la fabrication des monnoies d’argent fut rétablie , qu’elles se multiplièrent
ainsi que leurs subdivisions; que leur poids, leur titre, et par conséquent
leur valeur, furent successivement diminués, elles purent servir à l’achat des
menues denrées et tenir lieu de monnoie de détail. On put se passer plus facilement
des monnoies de cuivre, pius altérables, d’une odeur désagréable, décré-
ditées par la trop grande quantité mise en circulation, beaucoup plus embarrassantes
par leur volume, exigeant par-là même des frais de fabrication plus considérables
et présentant moins de bénéfice au Gouvernement. On diminua ou l’on cessa
entièrement l’émission des pièces de cuivre ; et le mot filous , qui désignoit
dabord particulièrement la monnoie de cuivre, s’appliqua ensuite aussi à la monnoie
d argent, et devint un mot générique, qui répond en français à celui d'argent
ou de monnoie (i ).
Les pieces de cuivre qui furent fabriquées, soit sous el-Maouyad [ 2 ] pour servir
d’appoint aux dirhem dont il avoit élevé, le titre , soit à une autre époque pour
suppléer à la rareté de la monnoie d’argent, prirent le nom de gedyd (3 ) , qui
signifie nouveau, c’est-à-dire, monnoie nouvelle.
Nous publions, sous les n.“ 25 et 26, deux gedyd de cuivre d’une époque
et d’une fabrication différentes (4).
Enfin, la valeur des denrées continuant à augmenter, et celle des médins à
diminuer, au point qu il ne fut plus nécessaire de recourir à une monnoie de
moindre valeur, on a cessé la fabrication des gedyd depuis long-temps. Cependant
le petit peuple fait encore usage, soit de divers gedyd, soit de petites pièces de
cuivre grossièrement taillées et sans empreinte, qu’il se procure chez les marchands
de cuivre, et qui, dans le detail, lui tiennent lieu des subdivisions du médin, afin
qu il puisse acheter les menues marchandises, telles que des herbes, pour une
quantité moindre d un medin ou para. Il faut jusqu à dix de ces pièces pour valoir
un medin; en sorte qu on peut les asshniler à ce qu’étoient chez nous les deniers.
§. IV .
Médailles ou Pièces de fantaisie.
L usage de faire frapper des médailles différentes des m on n o ie s , et ayant p ou r
but de consacrer ou d e rappeler le sou v en ir des événemens remarquables des
(1) On dit hât felous [^^Lè « donne de Par*-
» gent », ou «donne de la monnoie >>, s’il s’agit de changer
un sequin ou une piastre. Ketyr felous «SHÎ,
beaucoup d’argent.
(2) Voyei pag. 330, alin. 2 ; pag. 334, alin. 6 , et
W 336, alin. 3.
(3) cUtNs.. On prononce au Kaire guedyd, et dans
Ê. M. TOME II.
d’autres paysdjedyd. On est convenu, dans la]Description
de l’Egypte, de représenter le jr par g devant le
et Pi comme devant les autres voyelles.
(4) ^ la planche des monnoies gravées, à la suite
de ce Mémoire. Voye^, pour la forme, le type, &c. de ces
monnoies de cuivre, les divers paragraphes du chap. II,
pag. 344 et suiv.