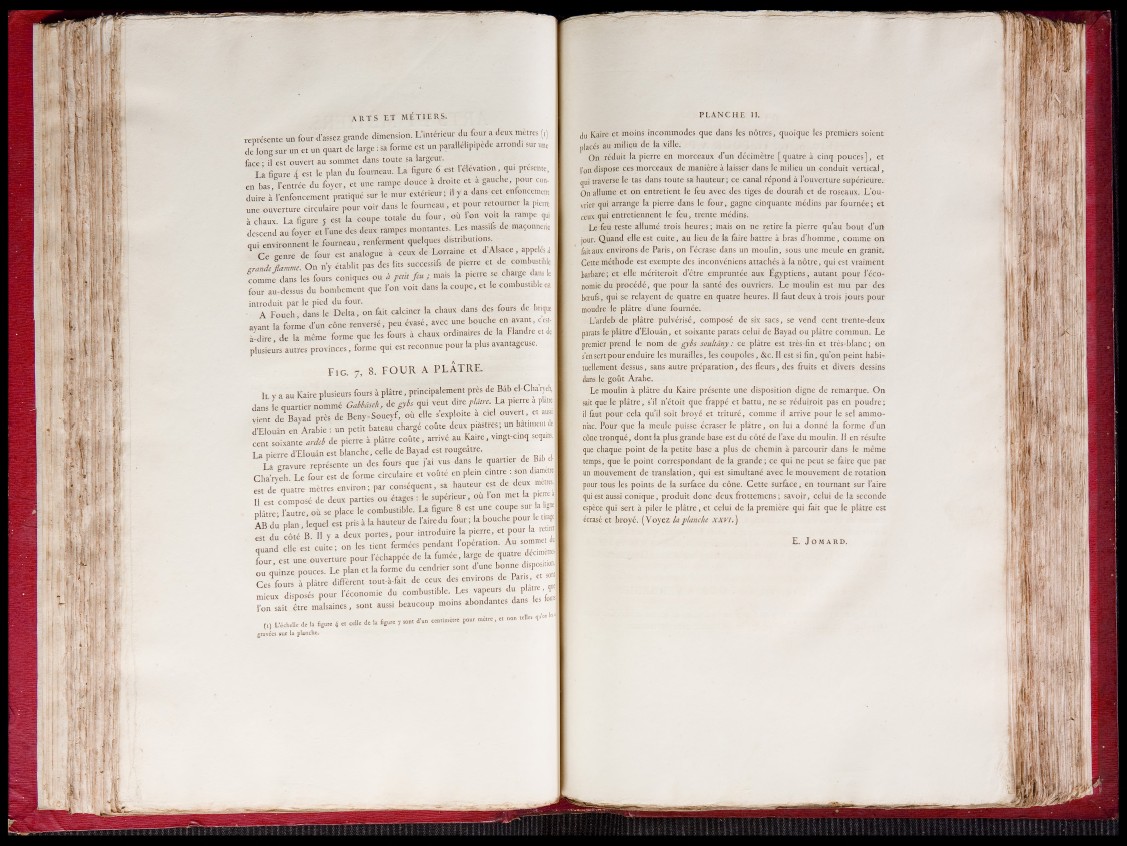
représente un four Passez grande dimension. L’intérieur du four a deux mètres (,)
de long sur un et un quart de large : sa forme est un paralléhp.pede arrondi sur u„e
lace ■ il est ouvert au sommet dans toute sa largeur. ,
S figure 4 est le plan du fourneau. La figure 6 est 1 élévat.on qu, présente,
en bas, 1’entréè du foyer, et une rampe douce à droite et a gauche, pour con-
duire à l’enfoncement pratiqué sur le mur extérieur; il y a dans cet enfoncement
une ouverture circulaire pour voir dans le fourneau, et pour retourner la pierrt
à chaux. La figure J est la coupe totale du four, ou Ion voit a rampe qU,
descend au foyer et l’une des deux rampes montantes. Les massifi de maçonnerie
qui environnent le fourneau, renferment quelques distributions^
C e genre de four est analogue à ceux de Lorraine et d Alsace, appelés h
grande flamme. On n’y établit pas des lits successifs de pierre et de combust.be
comme dans les fours coniques ou h petit feu ; mais la pierre se chaige dans le
four au-dessus du bombement que l’on voit dans la coupe, et le combustible est
introduit par le pied du four. , , . I
A Foueh, dans le Delta, on fait calciner la chaux dans des fours de brique
ayant la forme d’un cône renversé, peu évasé, avec une b o u c h e en avant, cestà
dire, de la même forme que les fours à chaux ordinaires de la Flandre et île
plusieurs autres provinces, forme qui est reconnue pour la plus avantageuse.
F ig. 7, 8. FOUR A PLÂTRE.
I l y a au Kaire plusieurs fours à plâtre, principalement près de Bâb el-Cha’iyeh,
dans le quartier nommé Gabbâseh, de gybs qui veut dire plâtre. La pierre a plâtre
vient de Bayad près de Beny-Soueyf, où elle s’exploite a ciel ouvert, et aussi!
d’Elouân en Arabie : un petit bateau chargé coûte deux piastres; un bâtim ent de!
cent soixante ardeb de pierre à plâtre coûte, arrivé au Kaire, vingt-cinq sequinsl
La pierre d’Elouân est blanche, celle de Bayad est rougeâtre. I
La gravure représente un des fours que j’ai vus dans le quartier de Bab el-l
Cha’ryeh Le four est de forme circulaire et voûté en plein entre : son d.ametitl
est de quatre mètres environ; par conséquent, sa hauteur est de deux mette J
H est composé de deux parties ou étages : le supérieur, où l’on met la p.err
nlâtre- l’autre où se place le combustible. La figure 8 est une coupe sur la .g
AB dû plan, lequel est pris à la hauteur de l’aire du four ; la bouche pour-le gj
est du côté B II y a deux portes, pour introduire la pierre, et pour la retire
z z sr» j l ■. » >**»< “ '• m t j four est une ouverture pour l’échappée de la fumée, large de quatre décime«
l u Le p in et la f o , „ . du e n d , le , jjg i
Ces fours à plâtre diffèrent tout-à-fait de ceux des environs de Pans,
mieux disposés pour l’économie du combustible. Les vapeurs du # » .■
l’on sait être malsaines, sont aussi beaucoup moins abondantes da
(I) L’échelle de la figure 4 et celle de la figure 7 « n t d’un centimètre pour mètre, et non telle* 1»’» H
gravées sur la planche.
du Kaire et moins incommodes que dans les nôtres, quoique les premiers soient
placés au milieu de la ville.
On réduit la pierre en morceaux d’un décimètre [quatre à cinq pouces], et
l’on dispose ces morceaux de manière à laisser dans le milieu un conduit vertical,
qui traverse le tas dans toute sa hauteur ; ce canal répond à l’ouverture supérieure.
On allume et on entretient le feu avec des tiges de dourah et de roseaux. L ’ouvrier
qui arrange la pierre dans le four, gagne cinquante médins par fournée; et
ceux qui entretiennent le feu, trente médins.
Le feu reste allumé trois heures; mais on ne retire la pierre qu’au bout d’un
jour. Quand elle est cuite, au lieu de la faire battre à bras d’homme, comme on
fait aux environs de Paris, on l’écrase dans un moulin, sous une meule en granit.
Cette méthode est exempte des inconvéniens attachés à la nôtre, qui est vraiment
barbare; et elle mériteroit detre empruntée aux Égyptiens, autant pour l’économie
du procédé, que pour la santé des ouvriers. Le moulin est mu par des
boeufs, qui se relayent de quatre en quatre heures. 11 faut deux à trois jours pour
moudre le plâtre d’une fournée.
L’ardeb de plâtre pulvérisé, composé de six sacs, se vend cent trente-deux
parats le plâtre d’Elouân, et soixante parats celui de Bayad ou plâtre commun. Le
premier prend le nom de gybs soultâny : ce plâtre est très-fin et très-blanc ; on
s’en sert pour enduire les murailles, les coupoles, &c. Il est si fin, qu’on peint habituellement
dessus, sans autre préparation, des fleurs, des fruits et divers dessins
dans le goût Arabe.
Le moulin à plâtre du Kaire présente une disposition digne de remarque. On
sait que le plâtre, s’il n’étoit que frappé et battu, ne se réduiroit pas en poudre;
il faut pour cela qu’il soit broyé et trituré, comme il arrive pour le sel ammoniac.
Pour que la meule puisse écraser le plâtre, on lui a donné la forme d’un
cône tronqué, dont la plus grande base est du côté de l’axe du moulin. Il en résulte
que chaque point de la petite base a plus de chemin à parcourir dans le même
temps, que le point correspondant de la grande ; ce qui ne peut se faire que par
un mouvement de translation, qui est simultané avec le mouvement de rotation
pour tous les points de la surface du cône. Cette surface, en tournant sur l’aire
qui est aussi conique, produit donc deux frottemens ; savoir, celui de la seconde
espèce qui sert à piler le plâtre, et celui de la première qui fait que le plâtre est
écrasé et broyé. (Voyez la planche x x v i.)
E. J o m a r d .