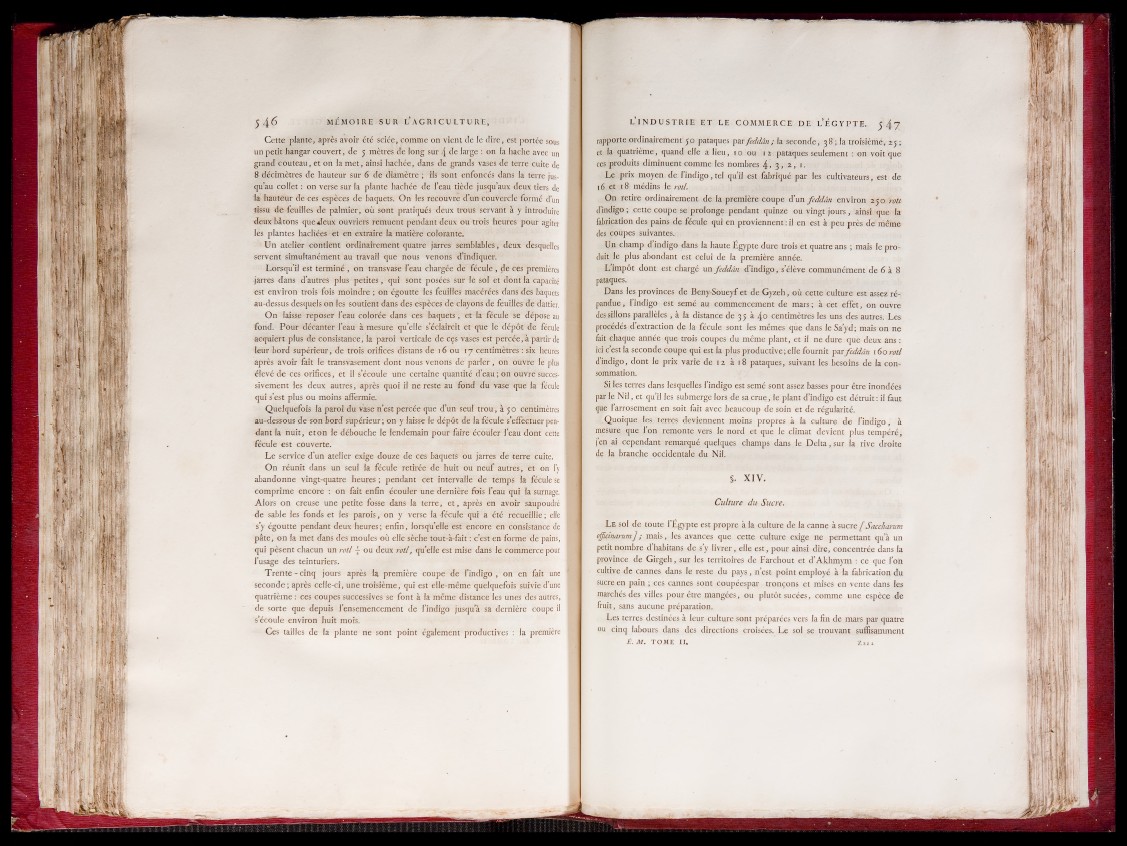
Cette plante, après avoir été sciée, comme on vient cle le dire , est portée sous
un petit hangar couvert, de y mètres de long sur 4 de large : on la hache avec un
grand couteau, et on la met, ainsi hachée, dans de grands vases de terre cuite de
8 décimètres de hauteur sur 6 de diamètre ; ris sont enfoncés dans la terre ju s qu’au
collet : on verse sur la plante hachée de l’eau tiède jusqu’aux deux tiers de
la hauteur de ces espèces de baquets. On les recouvre d’un couvercle formé d’un
tissu de feuilles de palmier, où sont pratiqués deux trous servant à y introduire
deux bâtons que Jeux ouvriers remuent pendant deux ou trois heures pour agiter
les plantes hachées et en extraire la matière colorante.
Un atelier contient ordinairement quatre jarres semblables, deux desquelles
servent simultanément au travail que nous venons d’indiquer.
Lorsqu’il est terminé , on transvase l’eau chargée de fécule , de ces premières
■jarres dans d’autres plus petites, qui sont posées sur le sol et dont la capacité
est environ trois fois moindre ; on égoutte les feuilles macérées dans des baquets
au-dessus desquels on les soutient dans des espèces de clayons de feuilles de dattier.
On laisse reposer l’eau colorée dans ces baquets, et la fécule se dépose au
fond. Pour décanter l’eau à mesure qu’elle s’éclaircit et que le dépôt de fécule
acquiert plus de consistance, la paroi verticale de ces vases est percée, à partir de
leur bord supérieur, de trois orifices distans de 16 ou 17 centimètres : six heures
après avoir fait le transvasement dont nous venons de parler, on ouvre le plus
élevé de ces orifices, et il s’écoule une certaine quantité d’eau; on ouvré successivement
les deux autres, après quoi il ne reste au fond du vase que la fécule
qui s’est plus ou moins affermie.
Quelquefois la paroi du vase n’est percée que d’un seul trou, à 50 centimètres
au-dessous de son bord supérieur ; on y laisse le dépôt de la fécule s’effectuer pendant
la nuit, et on le débouche le lendemain pour faire écouler l’eau dont cette
fécule est couverte.
L e service d’un atelier exige douze de ces baquets ou jarres de terre cuite.
On réunit dans un seul la fécule retirée de huit ou neuf autres, et on l’y
abandonne vingt-quatre heures ; pendant cet intervalle de temps la fécule se
comprime encore : on fait enfin écouler une dernière fois l’eau qui la surnage.
Alors on creuse une petite fosse dans la terre, e t, après en avoir saupoudré
de sable les fonds et les parois, on y verse la -fécule qui a été recueillie ; elle
s’y égoutte pendant deux heures; enfin, lorsqu’elle est encore en consistance de
pâte, on la met dans des moules où elle sèche tout-à-fait : c’est en forme de pains,
qui pèsent chacun un rotl •§• ou deux rotl, qu’elle est mise dans le commerce pour
l’usage des teinturiers.
Tren te -cin q jours après la première coupe de l’indigo, on en fait une
seconde; après celle-ci, une troisième, qui est elle-même quelquefois suivie d’une
quatrième : ces coupes successives se font à la mcme distance les unes des autres,
de sorte que depuis l’ensemencement de l’indigo jusqu’à sa dernière coupe il
s’écoule environ huit mois.
Ces tailles de la plante ne sont point également productives : la première
rapporte ordinairement' yo pataquès parfeddân; la seconde, 38 ; la troisième, 25 ;
et la quatrième, quand elle a lieu, 10 ou 12 pataquès seulement ; on voit que
ces produits diminuent comme les nombres 4 , 3, 2 , 1 .
Le prix moyen de l’indigo,tel qu’il est fabriqué par les cultivateurs, est de
16 et 18 médins le rotl.
On retire ordinairement de la première coupe d’un feddân environ 250 rotl
d’indigo; cette coupe se prolonge pendant quinze ou vingt jours, ainsi que la
fabrication des pains de fécule qui en proviennent : il en est à peu près de même
des coupes suivantes.
Un champ d indigo dans la haute Égypte dure trois et quatre ans ; mais le produit
le plus abondant est celui de la première année.
L’impôt dont est chargé un feddân d’indigo, s’élève communément de 6 à 8
pataquès.
Dans les provinces de Beny-Soueyf et de Gyzeh, où cette culture est assez répandue,
1 indigo est semé au commencement de mars; à cet effet, on ouvre
dessillons parallèles , à la distance de 35 à 4o centimètres les uns des autres. Les
procédés d extraction de la fécule sont les mêmes que dans le Sa’yd; mais on ne
fait chaque année que trois coupes du même plant, et il ne dure que deux ans :
ici c’est la seconde coupe qui est la plus productive; elle fournit parfeddân 160 rotl
d’mdigo, dont le prix varie de 12 à 18 pataquès, suivant les besoins de la consommation.
Si les terres dans lesquelles l’indigo est semé sont assez basses pour être inondées
par le N il, et qu’il les submerge lors de sa crue, le plant d’indigo est détruit : il faut
que 1 arrosement en soit fait avec beaucoup de soin et de régularité.
Quoique les terres deviennent moins propres à la culture de l’indigo, à
mesure que l’on remonte vers le nord et que le climat devient plus tempéré,
j’en ai cependant remarqué quelques champs dans le De lta, sur la rive droite
de la branche occidentale du Nil.
§. X IV .
Culture du Sucre.
L e sol de toute l’Egypte est propre à la culture de la canne à sucre [ Sacchamm
officinarum] ; mais, les avances que cette culture exige ne permettant qu’à un
petit nombre d habitans de s’y livrer, elle est, pour ainsi dire, concentrée dans la
province de Girgeh, sur les territoires de Farchout et d’Akhmym : ce que l’on
cultive de cannes dans le reste du pays, n’est point employé à la fabrication du
sucre en pain ; ces cannes sont coupéespar tronçons et mises en vente dans les
marchés des villes pour être mangées, ou plutôt sucées, comme une espèce de
fruit, sans aucune préparation.
Les terres destinées à leur culture sont préparées vers la fin de mars par quatre
ou cinq labours dans des directions croisées. Le sol se trouvant suffisamment