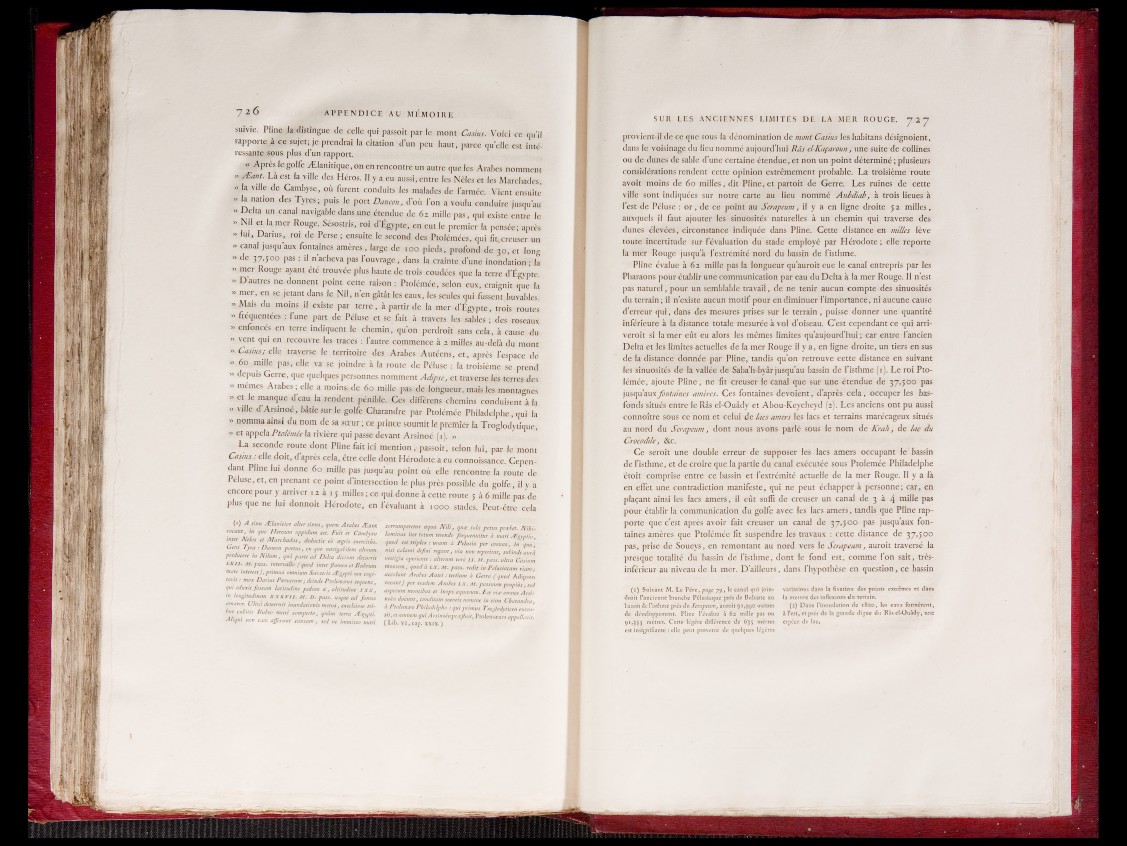
sume. Pline la distingue de celle qui passoit par le mont Casius. Voici ce qu’il
rapporte à ce sujet; je prendrai la citation d'un peu haut, parce quelle est interessante
sous plus d’un rapport.
« Après le golfe Ælanitique, on en rencontre un autre que les Arabes nomment
» Æant. Là est la ville des Héros. Il y a eu aussi, entre les Nèles et les Marchades
» la ville de Cambyse, où furent conduits les malades de l'armée. Vient ensuite
» la nation des Tyres; puis le port Dancon, d’où l’on a voulu conduire jusqu’au
» Delta un canal navigable dans une étendue de 62 mille pas, qui existe entre le
» Nil et la mer Rouge. Sésostris, roi d’Égypte, en eut le premier la pensée; après
» lui, Darius, roi de Perse ; ensuite le second des Ptoiémées, qui fit.creuser un
» canal jusqu’aux fontaines amères , large de 100 pieds, profond de 30, et long
» de 37,500 pas : il n’acheva pas l’ouvrage, dans la crainte d'une inondation ; la
Saj mer Rouge ayant été trouvée plus haute de trois coudées que la terre d’Égypte.
» D ’autres redonnent point cette raison : Ptolémée, selon eux, craignit que la
» mer, en se jetant dans le Nil, n’en gâtât les eaux, les seules qui fussent buvables.
» Mais du moins il existe par terre, à partir de la mer d’Égypte, trois routes
» fréquentées : l’une part de Péluse et se fait à travers les sables ; des roseaux
» enfonces en terre indiquent le chemin, qu’on perdroit sans cela, à cause du
» vent qui en recouvre les traces : l’autre commence à 2 milles au-delà du mont
y>. Casius ; eïïe traverse le territoire des Arabes Autéens, et, après l’espace de
» 60 mille pas, elle va se joindre à la route de Péluse : la troisième se prend
» depuis Gerre, que quelques personnes nomment Adipse, et traverse les terres des
» mêmes Arabes ; elle a moins, de 60 mille pas de longueur, mais les montagnes
» et le manque deau la rendent pénible. Ces différens chemins conduisent à la
» ville d’Arsinoé, bâtie sur le golfe Charandre par Ptolémée Philadelphe, qui la
» nomma ainsi du nom de sa soeur ; ce prince soumit le premier la Troglodytique,
» et appela Ptolémée la rivière qui passe devant Arsinoé (1). »
La seconde route dont Pline fait ici mention, passoit, selon lui, par le mont
Casius.: elle doit, d après cela, être celle dont Hérodote a eu connoissance. Cependant
Pline lui donne 60 mille pas jusqu’au point où elle rencontre la route de
Peluse, et, en prenant ce point d’intersection le plus près possible du golfe, il y a
encore pour y arriver 1 2 à 1 5 milles ; ce qui donne à cette route 5 à 6 mille pas de
plus que ne lui donnoit Hérodote, en l’évaluant à 1000 stades. Peut-être cela
( 1 ) A s m a Æ la n ilic o aller s in u s , quem Arabe s Æ a n t corrompere,ur aqua N i l i , qua: soia palus prerbet. N ib i-
vo cant, m que Heroum oppidum es,. F u i, « Camhysu laminus i,er ,o ,u ,n teun do frequenta,ur h mari Ægymio
m r N t lo s e t M a r ch a d a s , deducUs en oegns exercilûs. quod est tr ip le x : unum à P e lu s io p er a rm a s , in q u o ’
l y m r ° n u s ' f 1 “ ° " “ '’ •S^Hem alveum n is i calami defixi regan,, r ia non reperi,ur, subindea u r ’i
perducere m N d u m , qua parte a d D e lta dieuun decurri, r ,sligia operiente : alterum veri I I . m . pass. ultra Casium
M - p a “ - ( 1u ° d i n t e r flumen e, Rubrum mon,cm, quod a L X . M . pass, redi, in Pelusiacam via,,, ■
mare mures,), prunus ommum Sesostris Ægypti rex cogi- accolun, Arabes Autei : urtium à Gerro (quod Adi|»on
,a r„ : max Dar,us P,ersnrum ; deinde Pule,meus sequens, encan,) per eosdem Arabes LX. M. passuum propiùs.sed
qu.cdux,, fossa,n latuudme pedmn c, altitudine XXX, asperum mon,¡bu, e, inops aquarum. Eu ri,r L u e s Ârsi-
•n langmimem x x x v n . M . D . pass, usque ad fon,es noên duc,,,,,, condita,n sorons nomine in sinu Cbarandrn
a,un,os. Ultra deterrà,, manda,ion,s meus, excelsiore ,ri- à P ,ole,nom Pbiladelpbo : qui primas Tro-iedniccn excus’-
Z C r om a r , co,aperto, qubm terra Ægypù. s i,,,; „ „m e , qui Arsinoënprujlui,, Ptolemæum appellavi,,
eiuqu, non c.,m afferunt caasam, sed ne immisso mari ( Lib. VI,cap. XXIX.)
provient-il de ce que sous la dénomination de mont Casius les habitans désignoient,
dans le voisinage du lieu nommé aujourd’hui lias el-Kaçaroun, une suite de collines
ou de dunes de sable d’une certaine étendue, et non un point déterminé ; plusieurs
considérations rendent cette opinion extrêmement probable. La troisième route
avoit moins de 60 milles, dit Pline, et partoit de Gerre. Les ruines de cette
ville sont indiquées sur notre carte au lieu nommé Anbdiab, à trois lieues à
l’est de Péluse : o r , de ce point au Serapeum, il y a en ligne droite 52 milles,
auxquels il faut ajouter les sinuosités naturelles à un chemin qui traverse des
dunes élevées, circonstance indiquée dans Pline. Cette distance en milles lève
toute incertitude sur l’évaluation du stade employé par Hérodote ; elle reporte
la mer Rouge jusqu’à l’extrémité nord du bassin de l’isthme.
Pline évalue à 62 mille pas la longueur qu’auroit eue le canal entrepris par les
Pharaons pour établir une communication par eau du Delta à la mer Rouge. Il n’est
pas naturel, pour un semblable travail, de ne tenir aucun compte des sinuosités
du terrain ; il n’existe aucun motif pour en diminuer l’importance, ni aucune cause
d’erreur qui, dans des mesures prises sur le terrain , puisse donner une quantité
inférieure à la distance totale mesurée à vol d’oiseau. C ’est cependant ce qui arri-
veroit si la mer eût eu alors les mêmes limites qu’aujourd’hui ; car entre l’ancien
Delta et les limites actuelles de la mer Rouge il y a, en ligne droite, un tiers en sus
de la distance donnée par Pline, tandis qu’on retrouve cette distance en suivant
les sinuosités de la vallée de Saba’h-byâr jusqu’au bassin de l’isthme (1). Le roi Ptolémée,
ajoute Pline, ne fit creuser le canal que sur une étendue de 37,500 pas
jusqu’aux fontaines amères. Ces fontaines devoient, d’après cela, occuper les bas-
fonds situés entre le Râs el-Ouâdy et Abou-Keycheyd (2). Les anciens ont pu aussi
connoître sous ce nom et celui de lacs amers les lacs et terrains marécageux situés
au nord du Serapeum, dont nous avons parlé sous le nom de Krah, de lac du
Crocodile, & C .
Ce seroit une double erreur de supposer les lacs amers occupant le bassin
de l’isthme, et de croire que la partie du canal exécutée sous Ptolemée Philadelphe
étoit comprise entre ce bassin et l’extrémité actuelle de la mer Rouge, Il y a là
en effet une contradiction manifeste, qui ne peut échapper à personne; car, en
plaçant ainsi les lacs amers, il eût suffi de creuser un canal de 3 à 4 mille pas
pour établir la communication du golfe avec les lacs amers, tandis que Pline rapporte
que c’est après avoir fait creuser un canal de 37,500 pas jusqu’aux fontaines
amères que Ptolémée fit suspendre les travaux ; cette distance de 37,500
pas, prise de Soueys, en remontant au nord vers le Serapeum, auroit traversé la
presque totalité du bassin de l’isthme, dont le fond est, comme l’on sait, très-
inférieur au niveau de la mer. D ’ailleurs, dans l’hypothèse en question, ce bassin
( i ) S u iv a n t M . L e P è r e , page 7 9 , le c an a l q u i jo in - v a r ia tio n s dans la fix a tion d es p o in t s extrêmes e t dans
d ro it l’an cien n e branche P élu s ia qu e près d e Bubaste au la mesure des in flex ion s du terrain,
bassin de l’ isthme près du Serapeum, au ro it 9 1 ,9 9 0 mètres (2) D a n s l’ in on d a tion d e 18 0 0 , les e au x fo rm è r en t,
d e dév eloppement. P lin e l’ é va lu e à 6 2 m ille pas ou à l’e s t , et près d e la gran d e d ig u e du Râ s e l-O u â d y , un e
9 1 ,3 5 5 mètres. C e t t e lég è re différen ce d e 635 mètres espèce d e la c .
est insignifiante : e lle peut pro venir d e quelques légères