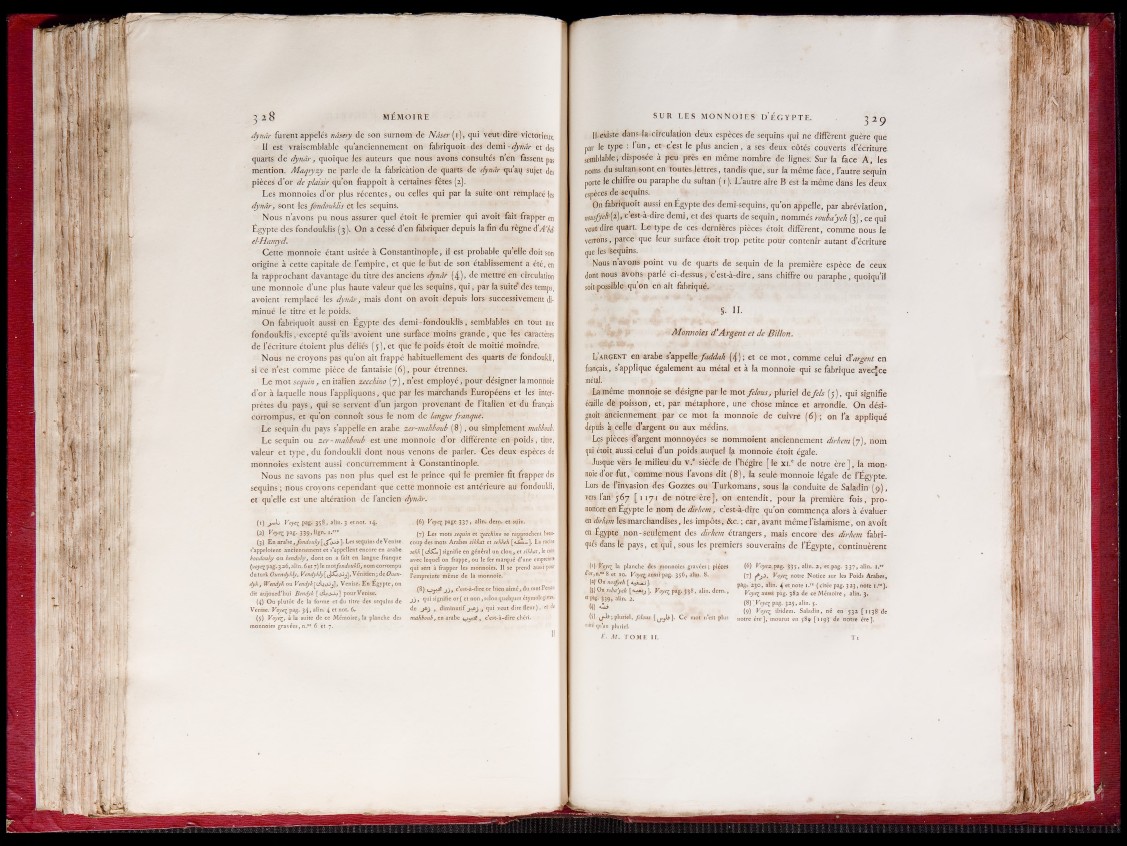
dynâr furent appelés nâsery de son surnom de Nâser ( i ), qui veut dire victorieux,
Il est vraisemblable qu’anciennement on fàbriquoit des demi -dynâr et des
quarts de dynâr, quoique les auteurs que nous avons consultés n’en fassent pas
mention. Maqryzy ne parle de la fabrication de quarts de dynâr qu’au sujet des
pièces d’or de plaisir qu’on ffappoit à certaines fêtes (2).
Les monnoies d’or plus récentes, ou celles qui par la suite ont remplacé les
dynâr, sont les fondotiklis et les sequins.
Nous n’avons pu nous assurer quel étoit le premier qui avoit fait frapper en
Égypte des fondouklis (3),. On a Cessé d’en fabriquer depuis la fin du règne SA i l
el-Hamyd.
Cette monnoie étant usitée à Constantinople, il est probable qu’elle doit son
origine à cette capitale de l’empire, et que le but de son établissement a été, en
la rapprochant davantage du titre des anciens dynâr (4), de mettre en circulation
une monnoie d’une plus haute valeur que les sequins, qui, par la suite* des temps,
avoient remplacé les dynâr, mais dont on avoit depuis lors successivement diminué
le titre et le poids.
On fàbriquoit aussi en Égypte des demi-fondouklis, semblables en tout aux
fondouklis, excepté qu’ils avoient une surface moins grande, que les caractères
de l’écriture étoient plus déliés (5), et que le poids étoit de moitié moindre.
Nous ne croyons pas qu’on ait frappé habituellement des quarts de fondoukli,
si ce n’est comme pièce de fantaisie (6), pour étrennes.
Le mot sequin, en italien zecchino (y), n’est employé, pour désigner la monnoie
d’or à laquelle nous l’appliquons, que par les marchands Européens et les interprètes
du pays, qui se servent d’un jargon provenant de l’italien et du français
corrompus, et qu’on connoît sous le nom de langue franque.
Le sequin du pays s’appelle en arabe zer-mahboub (8), ou simplement mahloul.
Le sequin ou zer-mahboub est une monnoie d’or différente en poids, titre,
valeur et type, du fondoukli dont nous venons de parler. Ces deux espèces de
monnoies existent aussi concurremment à Constantinople.
Nous ne savons pas non plus quel est le prince qui le premier fit frapper des
sequins ; nous croyons cependant que cette monnoie est antérieure au fondoukli,
et qu’elle est une altération de l’ancien dynâr.
(1) j j l s Voyei pag. 358, alin. 3 Mnot. 14. (6) Voy^l page 337, alin. dern. et stiiv.
(2) Voye^ pag. 339,lign. i .MC ' (7) Les mots sequin et qecchino se rapprochent béas-
(3) En arabe, Jondouky[l£l>Xi\ Les sequins deVenise coup des mots Arabes sikkat et sehkeh [<l£=L*,]. La racine i
s’appeloient anciennement et s’appellent encore en arabe „44 [ n iC ] signifie en général un clou, et siM«, Iecoin
bondouky ou bendoky, dont on a fait en langue franque avec lequel on frappe, ou le fer marqué d’une empreinte
(vqye^pag. 326, alin. 6 et 7) le mol fondoukli, nom corrompu qi;j sert 4 frapper les monnoies. 11 se prend aussi posr
du tu rk Ouendyldy, Vendyhly [ ¡Jéo ojjJ, Ver. i tien ; de Ou en- l’empreinte même de la monnoie.’
dyk, Wendyb ou VendybriÀsojâ, Venise. En Égypte, on 1 . ' „
, „ , , , ü , . ■ (8) U a i , j , c’est-à-dire or bien.aimé, du mot Persan
dit aujourdnui Bendyk [l£uoJu] pour Venise. •
(4) Ou plutôt de la forme et du titre des sequins de J j > <Iui !iSnifie or ( et ” ° n >selon <I,,el<l,lcs etymolog.stes,
Venise. Voye^ pag. 3 4 , alin. 4 et not. 6. de j» j , diminutif , qui veut dire fleur ) , « de
(5) Voye.£, à la suite de ce Mémoire, la planche des mahboub, en arabe , c’est-à-dire chéri,
monnoies gravées, n.®* 6 et 7. Il
Il existe dans-la circulation deux espèces de sequins qui ne diffèrent guère que
par le type : 1 un, et e est le plus ancien, a ses deux côtés couverts d’écriture
semblable ¡ disposée à peu près en même nombre de lignes: Sur la face A, les
noms du sultan sont en toutes lettres, tandis que, sur la même face, l’autre sequin
porte le chiffre ou paraphe du sultan ( i ). L ’autre aire B est la même dans les deux
espèces de sequins.
On fàbriquoit aussi en Égypte des demi-sequins, qu on appelle, par abréviation,
nmsfyc^[x)> cest-à-dire demi, et des quarts de sequin, nommés rouba’yeh (3), ce qui
v e u t dire quart. Le type de ces dernières pièces étoit différent, comme nous le
v e r r o n s , parce que leur surface étoit trop petite pour contenir autant d’écriture
que les Requins.
Nous n avons point vu de quarts de sequin de la première espèce de ceux
d o n t nous avons parlé ci-dessus, c’est-à-dire, sans chiffre ou paraphe, quoiqu’il
soitipossible qu’on en ait fabriqué.
§. II.
Monnoies d ’Argent et de Billon.
L’a r g e n t en arabe s’appelle faddah (4) ; e t ce m o t , com m e celui ¿’argent en
français, s’applique également au métal et à la m on n o ie qui se fabrique a v e c jc e
métal.
La même monnoie se désigne par le mot felous, pluriel de fels (5), qui signifie
écaille dé poisson, et, par métaphore, une chose mince et arrondie. On dési-
gnoit anciennement par ce mot la monnoie de cuivre (6) ; on l’a appliqué
depuis à celle d’argent ou aux médins.
Les pièces d’argent monnoyées se nommoient anciennement dirhem (y), nom
qui étoit aussi celui d’un poids auquel la monnoie étoit égale.
Jusque vers le milieu du v .e siècle de l’hégire [le x i.e de notre ère], la monnoie
d’or fut, comme nous l’avons dit (8), la seule monnoie légale de l’Égypte.
Lors de l’invasion des Gozzes ou Turkomans, sous la conduite de Saladm (9),
vers ■l’an-’ 567 [117-1 de notre ère], on entendit, pour la première fois, prononcer
en'Égypte le nom ¿e. dirhem, c’est-à-dire qu’on commença alors à évaluer
en dirliém les marchandises, les impôts, &c. ; car, avant même l’islamisme, on avoit
en Egypte non-seulement des dirhem étrangers, mais encore des dirhem fabriqués
dans le pays, et qui, sous les premiers souverains de l’Égypte, continuèrent
(1 y Vçye^ la planche des .monnoies gravées; pièces
dor, n.0! 8 et 10. Voye5 aussi pag. 356, alin. 8.
(-) Ou nosjÿeh [ «ujuJ J.
(3) Ou roba’yeh [«lajuj]. Voyez pag. 338, alin. dern.,
et Pag- 339, alin. 2.
(4) -III
(6) Voye.svpag. 335, alin. 2 , et pag. 337, alin. i .er
(7) Voyez notre Notice sur les Poids Arabes,
pag. 230, alin. 4 et note i.rc (citée pag. 323, note i.re).
Voyez aussi pag. 382 de ce Mémoire , alin. 3.
(8) * Voyez pag. 325, alin. 5.
(9) Voyez ibidem. Saladin, ne en 532 [1138 de
(5) î pluriel, felous Ce mot n est plus notre ère], mourut en 589 [ 1193 de notre ère].
usité qu’au pluriel.
¿ . M . T O M E I i. T t