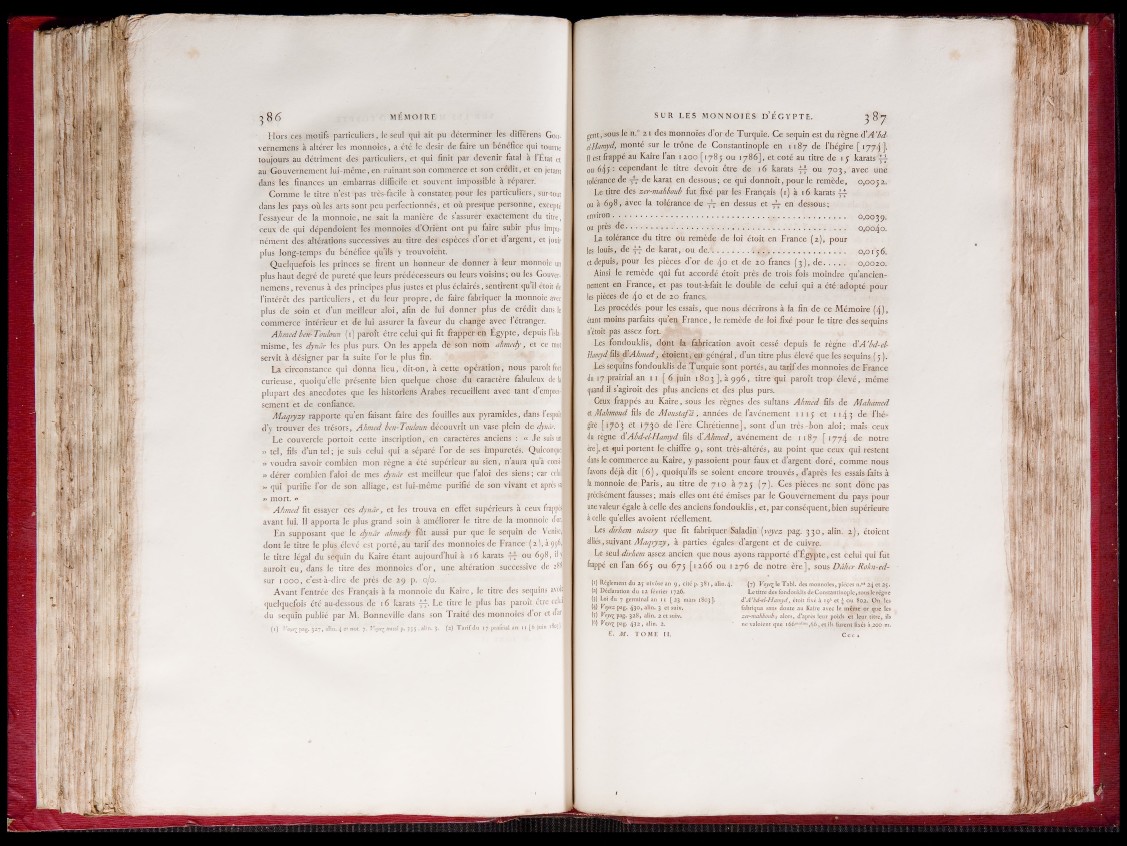
Hors ces motifs particuliers, le seul qui ait pu déterminer les différais Gou-
vernemens à altérer les monnoies, a été le désir de faire un bénéfice qui tourne
toujours au détriment des particuliers, et qui finit par devenir fatal à l’État et I
au Gouvernement lui-même, en ruinant son commerce et son crédit, et en jetant
dans les finances un embarras difficile et souvent impossible a reparer.
Comme le titre n’est pas très-facile à constater, pour les particuliers, sur-tout
dans les pays où les arts Sont peu perfectionnés, et où presque personne, excepté I
l’essayeur de la monnoie, ne sait la manière de s’assurer exactement du titre,!
ceux de qui dépendoient les monnoies d’Orient ont pu faire subir plus impu-1
nément des altérations successives au titre des espèces d’or et d argent, et jouir I
plus long-temps du bénéfice qu’ils y trouvoient.
Quelquefois les princes se firent un honneur de donner à leur monnoie uni
plus haut degré de pureté que leurs prédécesseurs ou leurs voisins; ou les Gouvcr-|
nemens, revenus à des principes plus justes et plus éclairés, sentirent qu il étoit del
l’intérêt des particuliers, et du leur propre, de faire fabriquer la monnoie avec!
plus de soin et d’un meilleur aloi, afin de lui donner plus de crédit dans Ici
commerce intérieur et de lui assurer la faveur du change avec l’étranger.
Ahmed ben-Touloun (i) paroît être celui qui fit frapper en Egypte, depuis l’isla-l
misme, les dynâr les plus purs. On les appela de son nom nhmecfy, et ce mot!
servit à désigner par la suite l’or le plus fin.
La circonstance qui donna lieu, dit-on, à cette opération, nous paroît fortl
curieuse, quoiqu’elle présente bien quelque chose du caractère fabuleux délai
plupart des anecdotes que les historiens Arabes recueillent avec tant d’empres-l
sement et de confiance.
Maqryzy rapporte qu’en faisant faire des fouilles aux pyramides, dans l’espoiil
d’y trouver des trésors, Ahmed ben-Touloun découvrit un vase plein de dynâr. I
Le couvercle portoit cette inscription, en caractères anciens : « Je suis uni
» tel, fils d’un tel; je suis celui qui a séparé l’or de ses impuretés. Quiconque,
» voudra savoir combien mon règne a été supérieur au sien, naura qu’à consi-
» dérer combien l’aloi de mes dynâr est meilleur que 1 aloi des siens ; car celui
» qui purifie l’or de son alliage, est lui-même purifié de son vivant et après sal
» mort. »
Ahmed fit essayer ces dynâr, et les trouva en effet supérieurs à ceux frappes-
avant lui. Il apporta le plus grand soin à améliorer le titre de la monnoie dorl
En supposant que le dynâr ahmedy fût aussi pur que le sequin de V e n is e !
dont le titre le plus élevé est porté, au tarif des monnoies de France ( 2 ), a 996I
le titre légal du sequin du Kaire étant aujourd’hui à 16 karats -j-f ou 698, il 1
auroit eu, dans le titre des monnoies d’o r, une altération successive de 288I
sur 1000, c’est-à-dire de près de 29 p. 0/0.
Avant l’entrée des Français à la monnoie du Kaire, le titre des sequins avoil
quelquefois été au-dessous de 16 karats j~. Le titre le plus bas paroît être celui
du sequin publié par M. Bonneville dans son Traité des monnoies dor etdarl
(1) royrçpag. 327, alin. 4 ci nol. 7. Ko)'ej aussi p. 355 , alin. 3. (2) Tarifdu 17 prairial an 11 [6 juin l8o)J|
gent, sous le n.° 21 des monnoies d’or de Turquie. Ce sequin est du règne d’A ’bd-
tl-Hamyd, monté sur le trône de Constantinople en 1 187 de l’hégire [17 74 ].
11 est frappé au Kaire l’an 1200 [1785 ou 1786], et coté au titre de 1 y karats'yï
ou é4j * cependant le titre devoit etre de 16 karats -j—- ou 703, avec une
tolérance de -jr ne karat en dessous; ce qui donnoit, pour le remède, 0,0052,
Le titre des zer-mahboub fut fixé par les Français (1) à 16 karats ~
ou à 698, avec la tolérance de yj- en dessus et ~ en dessous;
environ..........................................................................................................
0,0039.
ou près d e ........................................................................... o,oo4o.
. . .
La tolérance du titre ou remède de loi étoit en France (2), pour
les louis, de -j4 de karat, ou de.4. .............................................................
0,01 y 6.
et depuis, pour les pièces d’or de 4o et de 20 francs (3), d e ..........
0,0020.
Ainsi le remède qûi fut accordé étoit près de trois fois moindre qu’anciennement
en France, et pas tout-à-fait le double de celui qui a été adopté pour
les pièces de 4 ° et de 20 francs.
Les procédés pour les essais, que nous décrirons à la fin de ce Mémoire (4),
étant moins parfaits qu’en France, le remède de loi fixé pour le titre des sequins
n’étoit pas assez fort. M
Les fondouklis, dont la fabrication avoit cessé depuis le règne d'A ’bd-el-
Hamyd fils & Ahmed, étoient, en général, d’un titre plus élevé que les sequins ( 5 ).
Les sequins fondouklis dé Turquie sont portés, au tarif des monnoies de France
du 17 prairial an 1 1 [ 6 juin 1803 ], à 996, titre qui paroît trop élevé, même
quand il s’agiroit des plus anciens et des plus purs.
Ceux frappés au Kaire, sous les règnes des sultans Ahmed fils de Mahamcd
& Malmoud fils de Moustafâ, années de l’avénement 1 1 15 et 1143 de l’hégire
[1703 et 1730 de l’èrè Chrétienne], sont d’un très-bon aloi; mais ceux
du règne d’Abd-el-Hamyd fils d’Ahmed, avènement de 1 187 [ 1774 de notre
ère], et qui portent le chiffre 9, sont très-altérés, au point que ceux qui restent
dans le commerce au Kaire, y passoient pour faux et d’argent doré, comme nous
l’avons déjà dit (6 ) , quoiqu’ils se soient encore trouvés, d’après les essais faits à
la monnoie de Paris, au titre de 710 à 725 (7). Ces pièces ne sont donc pas
précisément fausses; mais elles ont été émises par le Gouvernement du pays pour
une valeur égale à celle des anciens fondouklis, et, par conséquent, bien supérieure
a celle qu’elles avoient réellement.
Les dirhem nâsery que fit fabriquer Saladin (voyez pag. 330, afin. 2), étoient
alliés, suivant Maqryzy, à parties égales d’argent et de cuivre.
Le seul dirhem assez ancien que nous ayons rapporté d’Égypte, est celui qui fut
frappé en l’an 665 ou 679 [1266 ou 1276 de notre ère], sous Dâher Rokn-ed-
(0 Règlement du 25 nivôse an 9, cité p. 381, alin.4.
(2) Déclaration du 12 février 1726.
(3) Loi du 7 germinal an 11 [23 mars .1803].
(4) Voyez pag. 430, alin. 3 et suiv.
(s) Pag. 3*8, alin. 2 et suiv.
1 1 Voye^ pag. 432, alin. 2.
É. M . T O M E I I .
(7) k Tabl. des monnoies, pièces n.°* 24 et 25.
Le titre des fondouklis de Constantinople, sous le règne
d'A ’bd-el-Hamyd, étoit fixé à 19k et ^ ou 802. On les
fabriqua sans doute au Kaire avec le même or que les
zer-mahboub ; alors, d’après leur poids et leur titre, ils
ne valoient que 166méïlins,66, et ils furent fixés à 200 m.