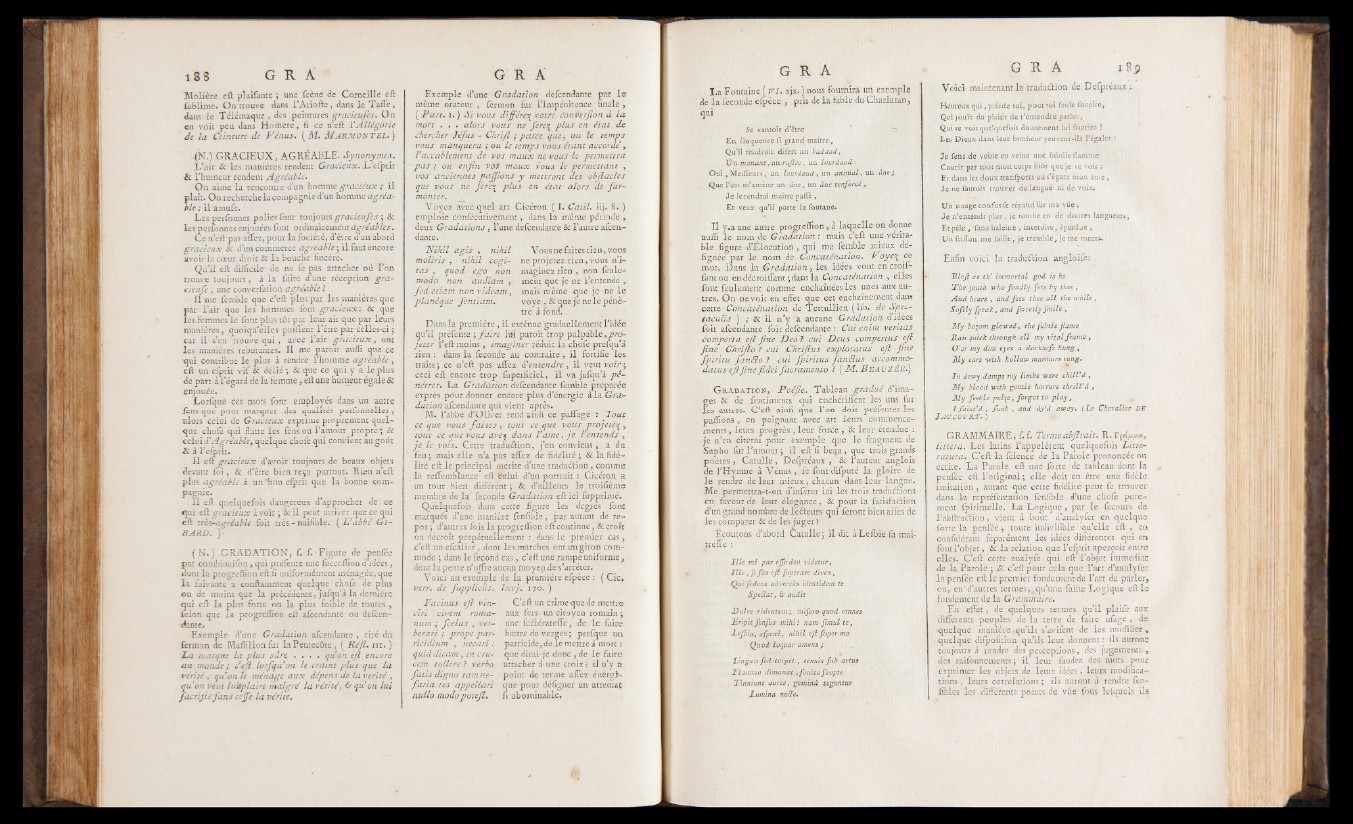
Molière eft plaifante ; une fcène de Corneille eft
fublime. O n trouve dans l ’A rio fte , dans l e T a f f e ,
dans le Télémaque , des peintures gracieufes. On
en voit peu dans Homère, fi ce n eft Y Allég orie
de la Ceinture de V én u s . (M . M ARM o u T EL.)
<N.) G R A C IE U X , A G R É A B L E . Synonymes.
L ’air & les manières rendent Gracieux. L ’efprit
& l ’humeur rendent Agréable.
O n aime la rencontre d’un homme gracieux ; i l
plaît. O n r e c h e r c h e la compagnie d’un homme agréable
; i l amufe.
Lesperfonnes polies font ' toujours gracieufes ; &
les perlonnes enjouées font ordinairement agréables.
C e tfeft pas a fiez, pour la fociété, d’être d’un abord
g ra cieux & d’un commerce agréable ; i l faut encore
avoir le coeur droit & là bouche fincère.
Qu’ i l eft difficile de ne fe pas attacher où l ’on
trouve toujours, à la fuite d une réception gra-
c ieu fe , une converfàtion agréable !
I l me femble que c’eft plus par les manières que
par l ’air que les hommes font gracieux-'. 8c que
les femmes le font plus tôt par leur air que par leurs
manières , quoiqu’elles puiffent l ’être par celles-ci ;
car i l s’en trouve q u i , avec l ’air g ra c ieu x , ont
les manières rebutantes. I l me paroîc auffi que ce
q u i contribue le plus à rendre l ’homme agréable,
eft un efprit v i f & délié ; & que ce qui y a le plus
de part à l ’égard de la femme, eft une humeur égale &
enjouée.
Lorfque ces mots font employés dans un autre
fens que pour marquer des qualités personnelles,
alors celui de Gracieux exprime proprement quelque
chofe qui flatte les fens ou l ’amour propre^ &
celui $ Agréable, quelque chofe qui convient au goût
& à l ’efprit.
I l eft gra cieux d’avoir toujours de beaux ■ objets
devant f o i , & d’être bien reçu partout. Rien n’ eft
plus agréable à u n ‘bon efprit que la bonne compagnie.
I l eft quelquefois dangereux d’approcher de ce
qui eft gra cieux à voir ; & i l peut arriver que ce qui
eft très-agréable foit très - nuifible. ( L ’ abbé G l -
RARD. )-
( N . ) G R A D A T IO N , f. f. - Figure de penfee
par combinajfon, qui préfente une fucceffion d idées,
dont la progreflîon eft fi uniformément ménagée, que
la fuivante a conftamment quelque chofe de plus
ou de moins que la précédente, jufqu’a la dernière
qui eft la plus forte ou la plus foi'ole de toutes ,
félon que la progreffion eft afcendante ou defeen-
dante.
Exemple d’une Gradation afcendante , tiré du
fermon de Maffillonfur la Pentecôte , ( R é fi. n i. )
L a marque la p lu s sure . . . . quon efi encore
au monde ; c eft lorfqu’ on le craint plu s que la
v érité, qu’ on le ménage a u x dépens de la v é r ité ,
qu’on veut luiêplaire malgré la vérité, & qu’ on lui
ja c r ijie fa n s ce fie la vérité.
Exemple d’une Gradation defeendante par l e
même orateur', fermon fur l ’Impénitence finale >
( P a r t , i . ) S i vous différe\ votre converfion à la
mort . . . alors vous ne fere\ p lu s en état de
chercher Jéfus - Chrift ,• parce que, ou le temps
vous manquera ,* ou le temps vous étant accordé ,
l ’ ac’cablement de vos maux ne vous le permettra
p a s ; ou enfin vos maux vous le permettant ,
vos anciennes pajjîon s y mettront des objlacles
que vous ne fere\ p lu s en état alors de fu r -
monter.
V o y e z avec quel art Cicéron ( I. Catil. iij. 8. }
emploie confécativement, dans, la même période ,
deux G rada tions, l ’une defeendante & l ’autre afcendante.
N ih il a g is , nihil
moliris , n ihil cogita
s , quod ego non
modo non ducliam
f e d etiarrî non videam,
' p la n é que fen tiam .
Vous ne faites rien, vous
ne projetez rien, vous n’imaginez
r ien , non feulement
que je ne l ’entende ,
mais même que je ne le
voye , & que je ne le pénètre
à fond.
Dans la première, i l exténue graduellement l ’idée
qu’i l préfente ; fa ir e lui paroît trop pa lpab le, proje
te r l ’eft moins , imaginer réduit la chofe prefqu’a
rien : dans la fécondé au contraire, i l fortifie les
traits ; ce n’eft pas affez S entendre , i l veut voir ;
ceci eft encore trop fuperficiel, i l va jufqu’à p é nétrer.
L a Gradation defeendante femble préparée
exprès pour donner, encore plus d’énergie à la Gradation
afcendante qui vient après.
JVÎ. l ’abbé d’Olivet rend ainfi ce paffage : T ou t
ce que vous f a i t e s , tout ce que vous projeté^ ,
tout ce que vous ave\ dans l ’ame, j e . Ventends ,
j e le vois. Cette traduction, j’en conviens, a du
feu ; mais elle n’a pas affez de fidélité ; & la fidélité
eft le principal mérite d’une traduction , comme
la reffemblance eft te lu i d’un portrait : Cicéron a
un tour bien différent ; & d’ailleurs le troisième
membre de la* fécondé Gradation eft ici fupprimé.
Quelquefois dans cette figure les degrés font
marqués d’une manière fenfible, par autant de repos
; d’autres fois la progreffion eft continue, & croît
ou décroît perpétuellement :. dans le prèmier cas^
c’eft un e fea lier, dont les marches ont un giron commode
; dans le fécond cas , c’eft une rampe uniforme , -
dont la pente n’offre aucun m oy en de s’arrêter.
V o ic i un exemple de la première efpèce : ( Cic.
verr. de fupplic iis.. I x v j. 170. )
Fac in u s eft vin-
ciri civem roma-
num ; f e e lu s , ver-
berari ,* prope partie
idium , necari :
quid dicam, in cru-
cern. toilere ? verbo
fa t i s digno tamne-
fa r ia res appellari
m llo modopotefi,
C ’eft un crime que de mettre
aux fers un citoyen romain ;
une fcélérateffe, de le faire
battre de verges ; prefque un
parricide, de le mettre à mort :
que dirai-je donc, de le faire
attacher à- une croix ? i l n’y a
point de terme affez énergique
pour défigner un attentat
fi abominable*
L a Fontaine ( V I . xjx. ) nous fournir» un exemple
de la fécondé efpèce , pris de la fable du Charlatan,
qui
Se vantoic d’être
En éloquence fi grand maître,
Qu’il rendroit difert un badaud,
Un manant, un rujire, un lourdaud :
Oui , Mefiieurs, un lourdaud , un animal, un âne.
Que l’on m’amène un âne, un âne renforcé à
Je le rendrai maître paffé ,
Et veux qu’ il porte la foutane.
I l y .a une autre progreffion, a laquelle on donne
auifi le nom de Gradation : mais c’ eft une véritable
figure d’Élocution , qui me femble mieux dé-
lignée par le nom de Concaténation. V oye\ ce
mot. Dans la G rada tion , les idées vont en croif-
fantou en décroiffant ; dans la Concaténation , elles
font feulement comme enchaînées les unes aux autres.
O n ne voit en effet que cet enchaînement dans
çette Concaténation de Tertullien ( lib . de Spec-
ta cu lis ) ; & i l n’y *a aucune Gradation d’idées
foit afcendante foit defeendante : C u i enim veritas
comperta eft fin e D e o ? cui D e u s compertus eft
fin e Chrifio ? cui Chriftus exploratus efi fin e
fp ir itu fa n c io ? cui fp ir itu s fa n & u s accommo-
datus e fifin e fid e i facramento 1 ( M . B e a u z é e .)
G r a d a t i o n , Poé fie . Tableau gradué d’images
& de fentiments qui enchériffent les uns fur
les autres. C ’eft ainfi que l ’on doit préfenter les
paffions , en peignant avec art leurs commencements
, leurs progrès , leur force , & leur étendue :
je n’ en citerai pour exemple que le fragment de
Sapho fur l ’amour ; i l eft lï beau, que trois grands
p o è te s , C a tu lle , Defpréaux , '& l ’auteur anglois
de l ’Hymne à Vénus , fe font difputé la gloire de
le rendre de leur mieux, chacun dans -leur langue.
Me permettra-t-on d’inférer ic i les trois traductions
en faveur de leur élégance, & pour la fatisfaction
d’un grand nombre de lecteurs qui feront bien aifes de
les comparer & de les juger ?
Écoutons d’abord Catulle ; i l dit à L efbie fà mai-
treffe :
l l l e mî par ejfe deo videtur,
I l l e , f i f as efi fuperare divos,
Qui fedens adversùs identidem te
Speclat, & audit
Dulce ridentem; mifero quod omnes
Eripit fenfus mihii nam Jimul te,
Lefbia, afpexi, nihil efi fuper me
Quod loquar amens y
JJtngua fed torpet, tennis fub artus
Flamma dimanat ,fonitu füopte
Tinniunt aures, gemihâ teguntur
Lmnina noble.
V o ic i maintenant la traduction de Defpréaux :
Heureux q u i, près de toi, pour toi feule foupire,
Qui jouît du plaifir de t’entendre parler.
Qui te voit quelquefois doucement lui fourire !
Les Dieux dans leur bonheur peuvent-ils l ’égaler ?
Je fens de veine en veine une fubtile flamme
Courir par tout mon corps fitôc que je te vois 5
Et dans les doux tranfports où s’égare mon âme,
Je ne faurois trpuver de langue ni de voix.
Un nuage confus fe répand fur ma v u e ,
Je n’ entends plus , je tombe en de douces langueurs j
Et pâle , fans haleine , interdite, éperdue ,
Un friflon. me faifit, je tremble, je me meurs.
Enfin voici la traduction angloife:
B le fi as th’ immortal god is he
T he jouth -who fondly fets by thee,
And hears , and fees thee a ll the while,
Softly fpeak, and fweetly fmile ,
M y bo\om glowed, the fubtle flame
Ran quick through a ll my vital frame ,
O ’er my dim eyes a darknjfs hung,
y ears with hollow murmurs rung.
In dewy damps my limbs were chill’d ,
M y blood with gentle horrors thrill’d ,
M y feeble pul\e, forgot to play,
1 faint’d , fu n k , and dy’d away. (Le Chevalier BE
JAVCOURT. )
G R AM M A IR E , f. f. T e rm ea b f tr a it . R.
Huera. Le s latins l ’appelèrent quelquefois L itte -
ratura. C ’eft la fcience de la Parole prononcée ou
écrite. L a Parole eft une forte de tableau dont la
penfée eft l ’original; elle doit en être une fidèle
imita tion, autant que cette fidélité peut fe trouver
dans la repréfentation fenfible d’une chofe purement
fpirituelle. L a L o g iq u e , par le fecours de
PabftraCtion, vient à bout d’analyfer en. quelque
forte la penfée -, toute indivifible qu’elle eft , en
confidérant féparément les idées différentes qui en
font l ’o b jet, & la relation que h’efprit aperçoit entre
elles. C ’eft cette aualyfe qui eft l ’objet immédiat
de la Parole : c’eft pour cela que l ’arc d’analyfer
la penfée eft le premier fondement de l’art de parler,
ou, en'd’autres termes,.qu’une faine Lo g iqu e eft le
fondement de la Grammaire.
En effe t, de quelques termes qu’ i l plaife aux
différents, peuples de l a terre de faire u fag e, de
-quelque manière „qu’ils s’avifent de les modifier,
quelque difpoficion qu’ils leur donnent : ils auront
toujours à rendre des perceptions, des jugements ,
des raifonnements ; i l leur faudra des mots : poux
exprimer le s objets de leurs idées, leurs modifications
, leurs corrélations; ils auront à rendre fen-
fibles les différents points de vue fous lesquels ils