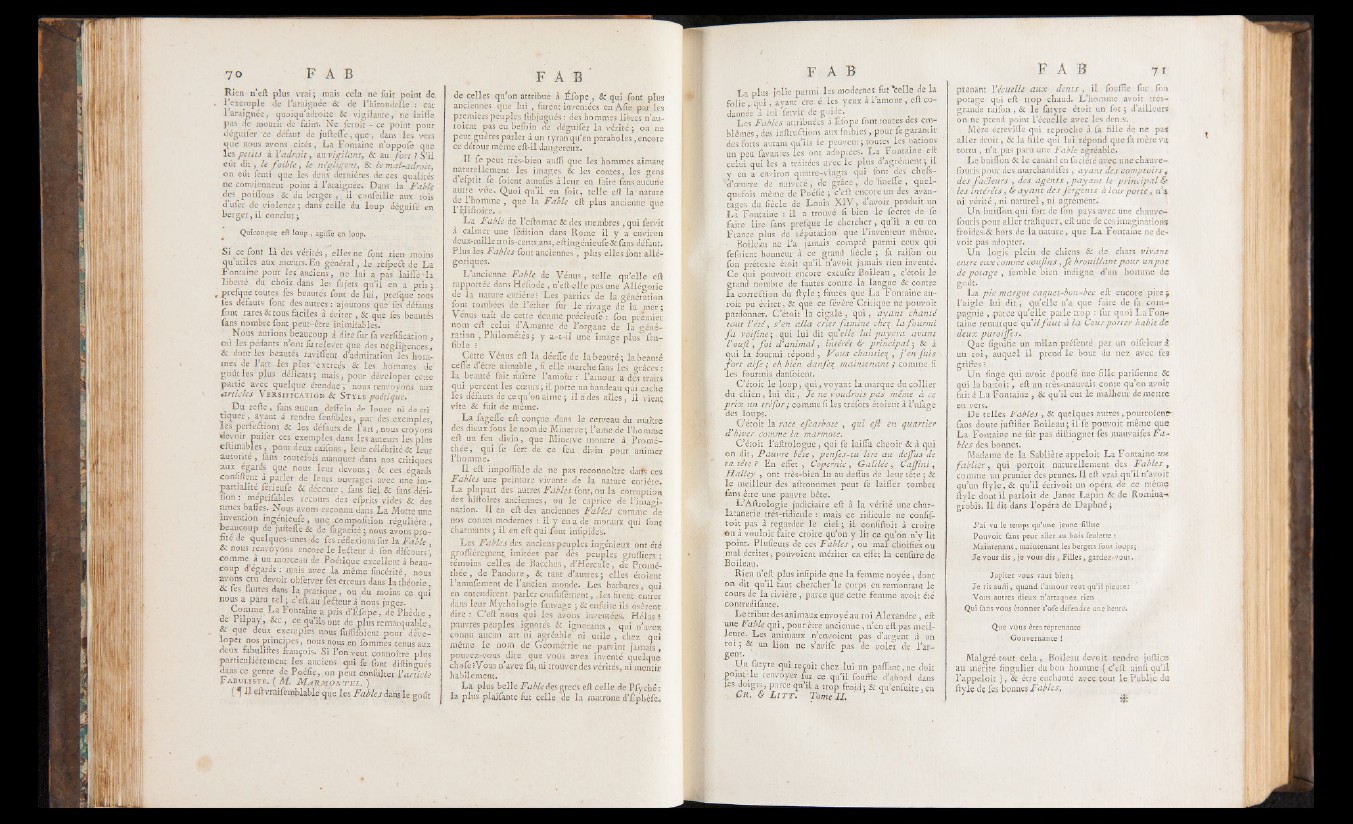
Rien n’ eft plus vrai ; mais cela ne fuit point de,
l ’exemple de l ’araignée 5c de l ’hiro ndelle : car
l ’araignée, quoiqu’adroite & vigilante, ne laiiTe
pas de mourir de faim. N e .fe ro it - ce'point- pour
déguifer 'ce défaut: de jufteffe, q jie , dans les vers
que nous avons cités , L a Fontaine n’oppofe que
les p e tits à Y a d ro it, au vigilant, 5c au f o r t .? S’i l
eût dit , le f o ib le , le négligent, Ôc le mal-adroit,
on eût lenti que les deux dernières de ces qualités
ne conviennent' point à l ’araignée. Dans la Fable
des poiffons & du berger , i l confeille aux rois
d’ufer de violence; dans ce lle du loup déguife en
b e r g e r ,il conclut;
Quiconque eft loup., agUTe en loup.
Si|ce: font la des vérités , elles ne font rien moins
qu’utiles aux moeurs. En géné ral, l e relpe<ft de L a
Fontaine pour les anciens, rie lui a pas l a i f i e j a
liberté du choix dans les fojecs qu’i l en a pris ; _
c prefque toutes les beautés font de lu i, prefque tous
lès défauts font des autres: ajoutons que feS~ défauts
font rares & tous faciles à éviter , 5c q ue fes beautés
lans nombre font peut-être inimitables.
Nous aurions beaucoup à dire fur fa verfification ,
ou les pédants n ont lu relever que des négligences ,
& dont les beautés raviffent d’admiration les hommes
de l ’art- le sp lu s -e x e r c é s 5c les hommes , de'
goût les plus délicats ; mais, pour dèveloper cette
partie avec quelque' étendue, nous renvoyons aux
articles V ersification 5c Style poétique.
D u re fie , fans aucun deffein de louer ni de critiquer
, ayant à rendre fenfîbles, par des exemples,
lé s perfections;,5c les défauts de l ’a r t , nous croyons
^ v o i r puifer ces exemples'dans les auteurs lesplus
eftimables , pour deux raifons , leur célébrité 5c leur
autorité , fans toutefois manquer dans nos critiques
aux égards que nous leur devons; 5c ces „égards
confiftent ï parler de leurs ouvrages avec une impartialité
ferieufe 5c décente, fans fiel & fans déri-
iïon : méprifables recours des efprits vides & des
âmes balles. Nous avons reconnu dans L a Motte une
invention ingénieufe, une .compofition ré gu liè re ,
beaucoup de j'ufleffe 5c de fagacité ; nous avons p ro-
iite dé quelques-unes de fes. réflexions fur la Fab le ,
& nous renvoyôns encore le leéleur i fon difcours;
comme a un morceau de Poétique, excellent à beaucoup
d égards : mais avec la même fincérité, nous
avons cru. devoir obferver fes erreurs dans la théorie,
Scies fautes dans la pratique, ou du moins ce qui
nous a paru t e l; c eft.au ie.éfceurâ'nous juger.
C o f im e L a Fontaine a pris d’É fope, de Phèdre ,
de r i lp a y , & c , ce qu’ils ont de plus remarquable,
- f S ue deux exemples; nous füffifoient pour deve-
loper nos principes, nous nous en fournies tenus aux
deux fabuliftes franeois. Si l ’on veut eonnoître plus
particulièrement les anciens qui fe font diftingués
dans ce genre de Poéfie,,on peut cpnfulter'.-l'article
F abuliste. (M . M a r r o n t e l .,)
( ^ I l eftvraifemblable que les F a b les dans le goût
de celles qu’on attribué a Éfope , & qui font plus
anciennes que lu i , furent inventées en Afie par les
premiers peuples, fubjugués : des hommes libres n’au-
roient j>as eu befoin de déguifèr la vérité ; on ne
peut gueres parler à un tyran qu’en paraboles, encore
ce détour même eft-il dangereux.
-Tl fe peut très-bien auffi que les hommes aimant
naturellement les images 5c les contes, les gens
d’efprit fe foient amufés a leur en faire fans aucune
autre vue. Quoi qu’i l en fo it, te lle eft la nature
de 1homme , que la Fable eft plus ancienne que
r^iiftoire. •
L a Fable de l ’eftomac 5c des membres , qui fervit
a calmer une fédition dans Rome i l y a environ
deux-mille trois-cencs ans, eft ingénieufe 5c fans défaut.
Plus les Fables font anciennes , plus elles font a llégoriques.
L ’ancienne Fable de V én u s , te lle q u e lle eft
rapportée dans Héfipde , n’eft-elle pas une A llé gor ie
de la nature entière? Les parties de la génération
font tombées de .l’éther fur le rivage de la mer ;
Vénus naît de cette écume précieufe : ,fon premier
nom eft celui d’Amante de l ’organe de la génération
, Philoméces ; y a- t- il une image plus fèn—
fible ?.
Cette Vénus eft la déeffe de la beauté; la beauté
ceffe d’être aimable , fi elle marche fans les grâces :
la beauté fait naître l ’amoùr : l ’amour a des traits
qui percent les coeurs ; i l porte un bandeau qui cache
les défauts de ce qu’on aime ; i l a des a ile s , i l vient;
vite 5c fuit de même.
L a fageffe eft conçue , dans le cerveau du maître
des dieux fous le nom de Minerve; 1’ame de l ’homme
eft un feu divin, que Minerve montre à Promé-
thée, qui fe fert de ce feu divin pour animer
l ’homme* . '
I l eft impoffible de ne pas reconnoître daiïs ces
Fables une peinture vivante de la nature entière.
L a plupart dès autres Fables font, ou la corruption
des hiftoires anciennes, ou le caprice de Timagi-
nation. I l en eft des anciennes Fables comme j e
nos' contes modernes : i l y en a de moraux qui font;
charmants ; i l en eft qui .font infipidés.'
Les Fables des. anciens peuples ingénieux ont été
groftièrement, imitées par des peuples groftïers ;
témoins celles de Bacchus, d’Hercu le, de Promèn
e , de Pandore, 5c tant d’autres; elles étoient
l ’amufement de l ’ancien monde. Les barbares, qui
en entendirent parler confùfément, .les firent entrer
dans leur Mythologie fauvage ; 8c enfuite ils osèrent
dire : C ’eft nous qui le s -avons' inventées. Hélas !
pauvres peuples ignorés & ignorants , qui n’avez;
connu aucun art ni agréable ni utile , chez qui
même le nom de Géométrie ne parvint jamais ,
pouvez-vous dire que vous avez inventé quelque
chofe?Vous n’avez fu, ni trouver des vérités, ni mentir
habilement.
L a plus belle Fable des grecs eft ce lle de Pfyché :
la plus plaifante fut ce lle de la matrone d’Éphèfe.
L a plus jolie parmi les modernes fut ’ce lle de la
folie ,/tjui, ayant cre é les yeux à l ’amour , eft co-
dannée à lui fervir de guide.
Les F ab les attribuées à Éfope fontroutes des emblèmes,
des inftrufiions aux foibies, pour fe garantir
des forts autant qu’ils le peuvent; toutes les nations
un peu lavantes les ont adoptées. L a ^Fontaine eft
celui qui les a traitées avec le plus d’agrément ; i l
y en a environ quatre-vingts qui font des .chefs-
M’oeuvre de naïveté , de g râ c e, de fineffe , quelquefois
même de Poéfie; c eft encore un des avantages
du fiècle de Louis X IV , d’avoir produit-un
L a Fontaine : i l a trouvé fi bien le fecret de fe
faire lire-fans prefque le chercher, qu’i l a eu en
France plus de réputation que l ’inventeur même.
Boileau ne l ’a jamais compté parmi ceux qui
fefoient honneur à ce .grand fiècle ; fa raifon ou
fon prétexte étplt qu’i l n’avoit jamais rien inventé.
C e qui pouvoit encore exeufer Boileau , c’étoic le
grand nombre de fautes contre la langue 5c contre
la correftion du ftyle ; fautes que L a Fontaine au-
roit pu éviter, 5c que ce févèré Critique ne pouvoit
pardonner,. G’étoic la cigale , q u i , ayant chanté
tout l ’é té , s ’ eh a lla crier fam in e che\ la fourmi
f a voifine ; qui lui dit qu’elle lu i payera avant
l ’ o u f l , f o i d’ a n im a l, intérêt & p r incipal ; 5c à
qui la fourmi répond , V o u s chantie\ , f en fu i s
f o r t aife ; eh bien datifez maintenant j comme fi
les fourmis danfoient.
C ’étoit le lo u p , q u i, voyant la marque du collier
du chien, lui d it , Je ne voudrais pas, même à ce
p r ix un tréfor ; comme fi les tréfors étoient à l ’ufage
des loups.’
C ’é to it la race efearbote , q u i e jl en quartier
d ’hiver comme la^ marmote-,
C ’étoit l ’aftrologue, qui fe laifla cheoir 5c à qui
on dit, Pauvre bê te, penfes-tu lire au dejfus de
ta tête ? En e ffe t, Copernic, G a lilé e , ICaJJîni,
H a lley , ont très-bien lu au deffus de leur tête ; 5c
le meilleur des aftronomes peut fe laiffer tomber
fans être une pauvre bête..
L ’Aftrologie judiciaire eft à la vérité une charlatanerie
très-rïcUcule : mais ce ridicule ne confif-
toit pas à regarder le c i e l ; i l confîftoit à croire
€>u à vouloir taire croire qu’on y lit ce qu’on n’y lit
point. Plufîeurs de ces F a b le s , ou mal choifîes ou
mal écrites1, poüvoient mériter en effet la cenfure de
Boileau.
Rien n’eft plus infipide que la femme n o y é e, dont
on dit qu’i l faut chercher le çorps en remontant le
cours de la rivière , parce que çette femme avoit été
contredifante.
. L e tribut des animaux envoyé au roi Alexandre , eft
une Fable q u i, pour être ancienne , n’en eft pas meilleure.
Les animaux n’envöient pas d’argent à un
roi ; 5c un lion ne s’avife pas de voler de l ’argent.
V L
P 11 ra£y re reÇoit ch ez.lu i un paffant, ne doit
point/le renvoyer fur ce qu’i l fouffle d’abord dans
les doigts, parce qu’i l a trop froid; 5c qu’enfuite, en
- OR. & L i t t . Tome.U.
prenant YécuelU a u x d e n ts , i l fouffle fur fon
potage qui eft trop chaud. L ’homme avoit très-
grande raifon, 5c le latyre étoit un fot ; d’ailleurs
on.ne prend point l’écuelle avec les dénis.
Mère écteviffë qui reproche à fà fille de ne pas»
aller droit, 5c la fille qui lui réporid que fa mère va,
tortu , n’a pas paru une Fable agréable.
Le.buiffon 5c le canard en focieté avec line chauve-
fouris pour des marchandifes , ayant d es comptoirs ,
des fa c teu r s , des a g en ts , p ayant le p r in c ip a l &
• les intérêts, & ayant des fergents à leur p o r te , ri’a
ni v érité, ni naturel, ni agrément."
U n buiffoii qui fort de fon pays avec une chauve-
fouris pour aller trafiquer, eft une de ces imaginations?
froides.5c hors de la nature, que L a Fontaine ne devoir
pas adopter, r
U n logis plein de chiens 5c de chats vivant
entre eu x comme coufins , f e brouillant pour un p o t
de potage , femble bien indigne d’un homme de
goût.
L a p ie margot caquet-bon-bec eft encore pire 5
l ’aig le lu i dit., q u e lle n’a que faire de fa com-r
pagnie , .parce qu’elle parle trop : ïur quoi L a Fon-;
taine remarque qu’ i l fa u t à la Cour porter habit dit
d eux paroijfes.
Que fignifie un milan préfenté par un oifeleurà
un roi , auquel i l prend le bout du nez avec fes
griffes ? ■■ -
U n finge qui avoir époufé une fille parifienne 5c
qui la b attoit, eft un: très-mauvais conte qu’on avoit
fait à L a Fontaine , 5c qu’i l eut le malheur dé mettre
en vers.
De telles Fables , 5c quelques autres , pouLToîent
fans doute juftifier Boileau; i l fe pouvoit même que
L a Fontaine ne fût pas diftinguer fes mauvaifes F a bles
dès bonnes.
Madame de la Sablière appèloit L a Fontaine wt
fa b li e r , qui portoit naturellement des Fables ,
comme un prunier des prunes. I l eft vrai qu’i l n’avoit
qu’un f ty le , 5c qu’i l écrivoit un opéra de ce même
ftyle dont i l parloit de Janot Lapin 5c de Romina-s
grobfs. I l dit dans Topéra de Daphné ;
J’ai vu le temps qu’une jeune filltte
Pouvoit fans peur aller au bois feulette :
Maintenant, maintenant les bergers font loups;
Je vous dis , je vous dis , Filles , gardez-vous.
Jupiter vous vaut bien;
Je ris au(ïi? quand l’amour veut qu’ il pleure:'
Vous autres dieux n’attaquez rien
Qui fans vous étonner s’ofe défendre une heure, .
Que vous êtes reprenante
Gouvernante !
Malgré tout c e la , Boileau devoit rendre juftice
au mérite fingulier du bon homme ( c’eft ainfi qu’i l
l ’appeloit ) , 5c être enchanté avec tout le Public du
ftyle de fes bonnes Fables*