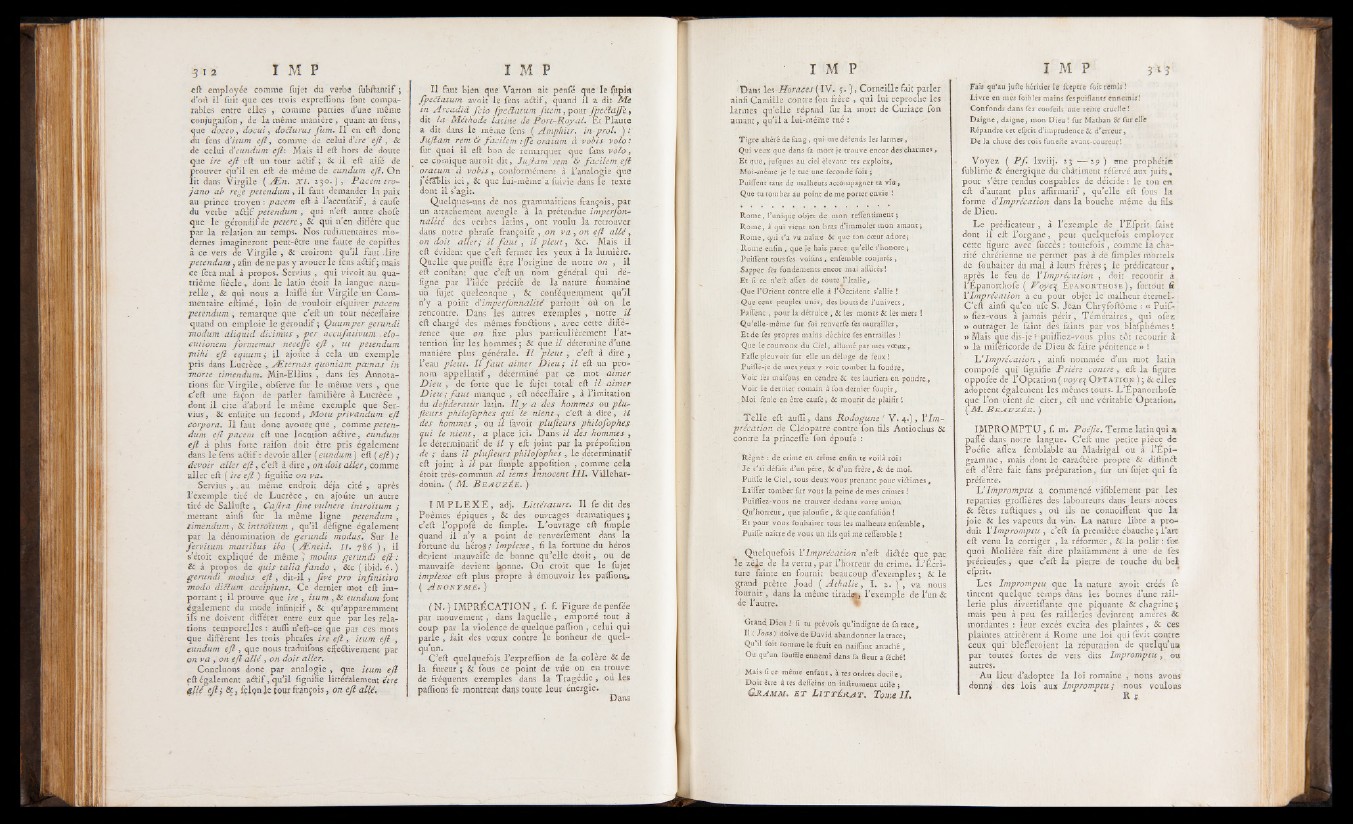
eft employée comme fujet du verbe fubftantif j
d’où i l fuie que ces trois expreffions font comparables
entre elles , comme parties d'une même
conjugaifon , de la même manière , quant au fens,
ue aoceo, d ocu i, docturus fum . I l en eft donc
u fens d’itum eft y comme de celui d’ire ' eft , &
de celui dé eundum e ft: Mais i l eft hors de doute
que ire e/? eft un tour actif ; & i l eft aifé de
prouver q u'il en eft de même de eundum ejt. On
li t dans V irg ile [Æ n . X I. 130. ) , P a c em tro-
ja n o ab rege petendum, i l faut demander la paix
au prince troyen : pacem eft à l ’accufatif, à caufe
du verbe aétif petendum, qui n’eft autre chofe
que le gérondif de petere,, & qui n’en diffère que
par la relation au temps. Nos rudimentaires modernes
imagineront peut-être une' faute de copiftcs
à ce vers de V irg ile , & croiront qu'il faut .lire
petendam, afin de ne pas y avouer le fens aétif 3 mais
ce fera mal à propos. Se mu s , qui vivoit au quatrième
f îè e le , dont le latin étoit la langue nature
lle , & qui nous a laiffé fur V irg ile un Commentaire
eftimé, loin de vouloir efquiver pacem
petendum , remarque que c’eft un tour néceffaire
quand on emploie le gérondif j Quumper gerundi
modum aliqu id dicimus , p e r accufativum . e lo-
cutionem formemus neceffe e ji , ut petendum
Ttùhï eft equum; i l ajoute a cela un exemple
pris dans Lucrèce., Æ te rn a s quoniam poenas in
morte timendum. Min.-Ellius , dans fes Annotations
fur V i r g i le , obferve fur le mêm.e vers , que
c'eft une façon de parler familière à Lucrèce ,
dont i l cite d’abord le même exemple que Ser-
v ius, & enfuite un fécond , M o tu privandum eft
corpora. I l faut donc avouer que , comme petendum
eft pacem eft une locution active, eundum
eft a plus forte raifon doit être pris également
dans le fens aéfcif : devoir aller ( eundum) eft [e ft) ;
devoir aller e f t , c’eft a dire , on doit alle r, comme
a lle r eft ( ire eft ) fignifie on va»
Servius , . au même endroit déjà cité , après
l ’exemple tiré de L u c rè c e , en ajoute un autre
tiré de Sallufte , Caftra f in e vulnere introitum ;
mettant ainfi fur la même ligne petendum ,
timendum, & introitum , qu’i l aefigne également
par la dénomination de gerundi modus. Sur le
fervitum matrihus ibp ( Æ n e id . i l . 7 $6 ) , i l
s’étoit expliqué de même modus gerundi eft :
& à propos de q.uig talia fa n d o , &c ( ibid. 6. )
gerundi modus eft , dit-il , five pro infinitivo
modo diclum acoipiünt, C e dernier mot eft important
3 i l prouve que ire , itum , & eundum font
egalement du mode infinitif, & qu’apparemment
ils ne doivent différer entre eux que par les relations
temporelles : aufli n eft-ce que par ces mots
que diffèrent lés trois phrafes ire e ( l , itum eft ,
eundum eft -, que nous traduifons effectivement par
on va y on eft a l l é , on doit aller.
Concluons donc par analogie , cjue itum eft
eft également a é t if , qu’i l lignine littéralement erre
{ illé eft 3 & , fçlçn le jour françois, on eji allé.
I l faut bien que Varron ait penfé que le ftipîa
fpeclatum avoit le fens a é tif, quand i l a dit M e
in A r ca d iâ fc io fpeclatum fu tm , pour fpeclajfty
dit la Méthode latine de P o r t-R o y a l. Et Plaute
a dit dans le même fens ( Amphitr. in-prol. ) :
Juftam rem & fa c i le m effe oratùm à vobis volo:
fur quoi i l eft bon de remarquer que fans v o lo ,
ce comique auroit dit, Juftam rem & facilem eft:
oratum~ à vobis ^conformément à l ’analoçrie que
j’éfëblis i c i , & que lui-même'afuivie dans le texte
dont i l s’agit.
Quelques-uns de nos grammairiens françois, par
un attachement aveugle à la prétendue imperfon-
n a lité des verbes la tin s , ont voulu la retrouver
dans notre phrafe françoife , on va y on eft a l l é , -
on doit alle r; i l fa u t y i l pleu t y & c. Mais i l
eft évident que c’eft fermer les yeux à la lumière.
Q u elle quepuiffe être l ’origine de notre on , i l
eft confiant que c’eft un nom général qui dé-
figne par l ’idée précife de la nature humaine
un fujet quelconque , & conféquemment qu’i l
n’y a point dl imper form alité partout où on le
rencontre. Dans les autres exemples , notre i l
eft chargé des mêmes fonctions, avec cette différence
que on fixe plus particulièrement l ’attention
fur les hommes ; & que i l détermine d’une
manière plus- générale. I l p leu t , c’ eft à dire ,
l ’eau pleu t. I l fa u t aimer D ie u y i l efKun pronom
ap p e lla t if , détérminé par çe mot aimer
D ie u y de forte que le fujet total eft i l aimer
D ie u ; f a u t manque , eft néceffaire , à l ’imitation
du defideratur latin. I l y a des hommes ou p lu fieurs
philofophes qui le n ie n t , c’eft à dire, i l
des hommes , ou i l lavoir plufieurs philofophes
qui le nient y a place ic i. Dans i l des hommes ,
le déterminatif de i l y eft joint par la prépofition
de , dans i l plufieurs, philofophes y le déterminatif
eft joint à i l par fimple appofition , comme cela
étoit très-commun a l tems Innocent I I I . V illeh a r-
douin. ( M . B e a u z é e . ) '
I M P L E X E , adj. Littérature. I l fe dit des
Poèmes épiques , & des ouvrages dramatiques 5
c’eft l ’oppofé de fimple. L ’ouvrage eft fimple
quand i l î f y a point de renverfement dans la
fortune du héros ; impie x e , fi la fortune du héros
deyient mauvaife de bonne qu’e lle é to it , ou de
mauvaife devient bonne. O n croit que le fujet
implexe eft plus propre a émouvoir les paffions,
( A n o n ym e , )
(N. ) IM P R É C A T IO N , f. f. Figure depenfée
par mouvement, dans laquelle , emporte tout a
coup par la violence de quelque paffion , celui qui
parle , fait des vepux contre le bonheur de quelqu’un.
C ’eft quelquefois l ’exprefïion de la colère & de
la fureur 3 & fous ce point de vue on en trouve
de fréquents exemples dans la Tragédie , où les
paffions fe montrent dans toute leur énergie.
D an s
Dans les Horaces ( IV . ç . ) , Corne ille fait parler
âinfî Camille contre fon frère , qui lui reproche les
larmes qu’elle répand fur la mort de Curiace fon
amant, q u'il a lui-même tué :
Tigre altéré de fang, qui me défends les larmes,
Qui veux que dans fa more je trouve encor des charmes,
■ Et que, jufques au ciel élevant tes exploits,
Moi-jnéme je le tue une fécondé fois ;
Puiflent tant de malheurs accompagner ta v ie ,
Que tu tombes au point de me porter envie I
Rome, Punique objet de mon reffentiment;
Rome, à qui vient ton bras d’immoler mon amant;
Rome, qui t'a vu naître ôc que ton coeur adore;
Rome enfin, que je hais parce qu’elle t’honore ;
Puiflent tousfes voifins, enfemble conjurés,
Sapper fes fondements encor mal aflurcs 1
Et fi ce n’ eft aflez de toute l’ Italie,
- Que l’Orient contre elle à l’Occident s’allie !
Que cent peuples unis-, des bouts de l’univers,
Paffent , pour la détruire, & les monts 5c les mers !
Qu’elle-même fur foi renverfe fes murailles,
Et de fes propres mains déchire fes entrailles !
Que le courroiix du Ciel , allumé par mes voeux,
Fafle pleuvoir fur elle un déluge de feux [
Puiflé-je de mes yeux y voir tomber la foudre,
Voir fes maifons en cendre & tes lauriers en poudre.,
Voir le dernier romain à fon dernier foupir,
. Moi feule en être caufe, ôc mourir de plaifir î
T e l le eft au fli, dans Rodogune ( V . 4 .) , VImprécation
de Cléopâtre contre fon fils Antiochus &
contre la princeffe foii époufe :
Règne : de crime en crime enfin te voilà rôi :
Je t’ai défait d’un père, & d’ un frère, St de moi.
Puilfe le C ie l, tous deux vous’ prenant pour viétiraes ,
Laiffer tomber fur vous la peine demies crimes !
Puifllez-vous ne trouver dedans votre union
Qu’horreur, que jaloufie , & que çonfufion !
Et pour vous fbuhaiter tous les malheurs enfemble ,
Puifie naître de vous un fils qui me reflemble !
Quelquefois l ’ Imprécation n’eft di&ée que par
le zè|e de la vertu, par l ’horreur du crime. L ’Écriture
fainte en fournie beaucoup d’exemples 3 & le
grand prêtre Joad ( A t h a l i e , I. z . ) , va nous
fournir , dans la même tirad^fc l ’exemple de l ’un &
de l ’autre.
Grand D ie u ! 'fi tu prévois qu’ indigne de fa race.
Il ( Joas) doivë de David abandonner la trace;
Qu il foit comme le fruit en naiflant arraché ,
Ou qu’un fouffle ennemi dans fa fleur a feehé!
Mais fi ce même enfant, à tes ordres docile ,
Doit être à tes de (Teins un inftrumept utile ;
Gm.a m m . e t L i t t éma t . Tome I L
Fais qu’au jufte héritier le feeptre foit remis !
Livre en mes foibles mains fespuiflantî ennemis'!
Confonds dans fes cdnfeils une reine cruelle !
Daigne , daigne, mon Dieu ! fur Mathan &' fur elle
Répandre cet efprit d’imprudence Sc d’erreur,
De la chute des rois funefte avant-coureur!,
V o y e z ( P f . lxviij. 13 — zp ) tme prophétie
fublime & énergique du châtiment réfervé aux juifs «
pour s’être rendus coupables de déicide : le ton en
eft d’autant plus affirmatif , qu’e lle eft fous la
forme d’imprécation dans la bouche même du fils
de Dieu.
L e prédicateur, à l ’exemple de l ’Efprit faine
dont i l eft l ’organe, peut quelquefois employer
cette figure avec fiiccès : toutefois , comme la charité
chrétienne ne permet pas à de fimples mortels
de fouhaiter du mal à leurs frères 3. le prédicateur „
après le feu de l ’Imprécation , doit recourir à
l ’Épanorthofe ( Vqye-^ É p a n o k t h o s e ) , furtout f i
Y Imprécation a eu pour objet le malheur éternel-
-C’eft ainfi qu’en ufe S. Jean Chryfoftôme : « Puif-
» fiez-vous à jamais p érir, Téméraires,, qui ofez
» outrager le faint des faints par vos blafphêmesî
» Mais que dis-je ? puifiîez-vous plus tôt recourir à
» la miléricorde de Dieu & faire pénitence » !
U Imprécation , ainfi nommée d’un mot latin
compofé qui lignifie Prière contre , eft la figure
oppofée de l ’Optation {yoye\ O p t a t i o n ) j & e lles
adoptent également les mêmes tours. L ’Épanorthofe
que l ’on vient de citer, eft une véritable Optation.
\ M . B e a u z é e . )
IM P R O M P T U , fi m. Poéfié. Terme latin qui a
paffé dans notre langue. C ’eft une petite pièce de
Poéfie affez femblable au Madrigal ou a l ’É p i -
gramme , mais dont le cara&ère propre & diftinél
eft d’être fait fans préparation, fur an fujet qui fe
préfente.
U Impromptu a commencé vifiblement par les
reparties groflières des laboureurs dans leurs nôces
& fêtes ruftiques , où ils ne connoiffent que la
joie & les vapeurs du vin. L a nature libre a produit
Y Impromptu , c’eft fa première ébauche j l ’arc
eft venu la corriger , la reformer, & la polir : fu*r
quoi Molière fait dire plaifamment a une de fes
précieufes, que c’ eft la pierre de touche du bel
efprit.
Les Impromptu que la nature avoit créés fe
tinrent quelque temps dans les bornes d’une raillerie
plus divertiffa'nte que piquante & chagrine 3
mais peu à peu fes railleries devinrent ameres &
mordantes : leur excès excita des plaintes, & ces
plaintes, attirèrent à Rome une lo i qui févit contre
ceux qui’ blefferoient la réputation de quelqu’un
par toutes fortes de vers dits Impromptu, ou
autres.
A u lieu d’adopter la lo i romaine , nous avons
donné des lois aux Impromptu ; nous voulons
É |