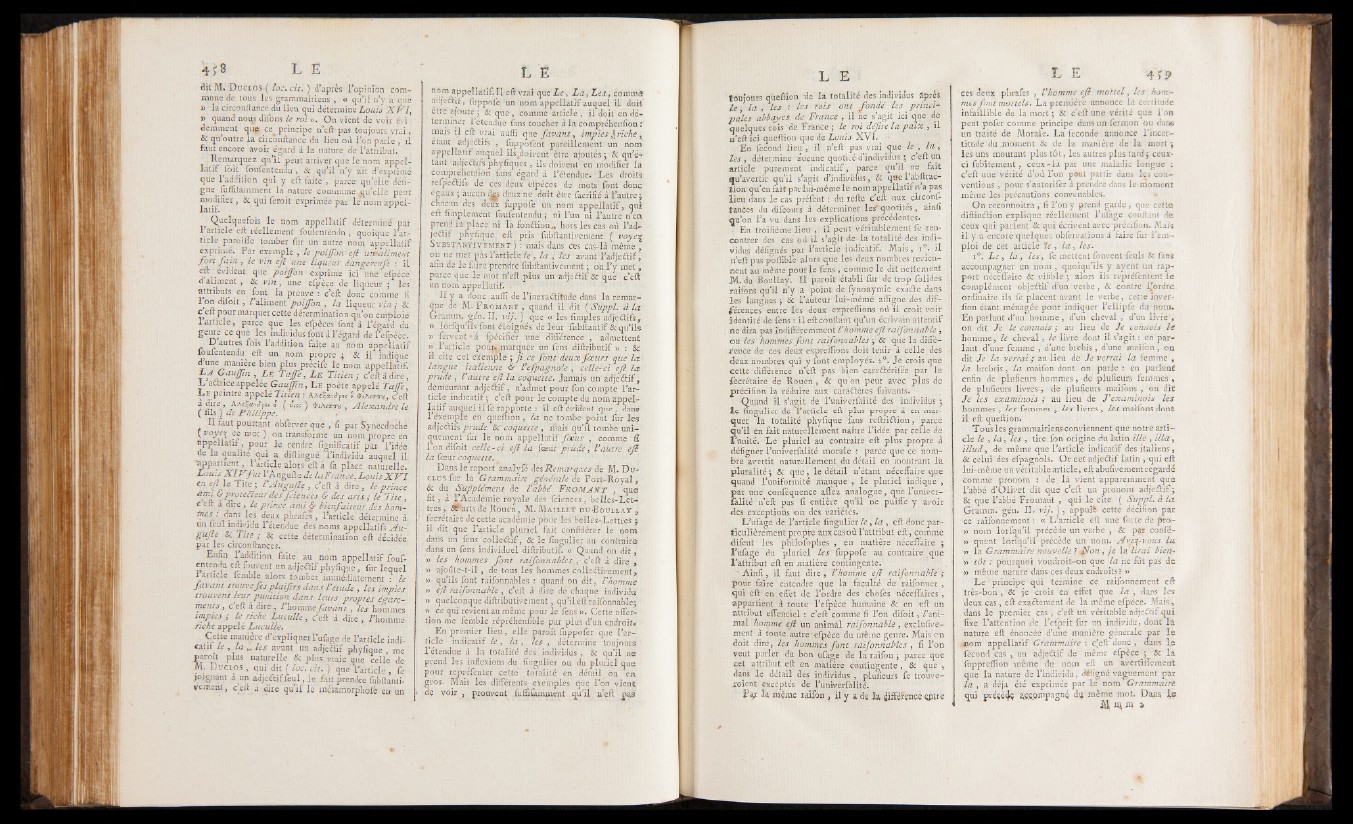
^ît M. D uglos ( loc. c itï ) d'après l ’opinion commune
de tous les grammairiens , « qu’i l n’y a que
» la circonflance du lieu qui détermine Lou is X V I ,
ï> quand nous difons Is toi », On vient de voir é v idemment
que ce# principe n’ eft pas toujours v r a i,
& qu’outre la circônftance du lieu où l ’on parle , il
faut encore avoir égard à la nature de; l ’attribut.
Remarquez qu’i l peut arriver que le nom appel-
la t i f foit foufentendu , & qu’i l n’y ait d’exprimé
que l ’addition qui y eft faite , parce qu’elle défi—
gne fuffifâmment la nature commune qu’elle peut
mo^ fier 3 & qui feroit exprimée par le nom appei-
Quelquefois le nom ap pella tif déterminé par
1 article eft réellement foufentendu , quoique l ’art
icle paroiffe tomber fur un autre nom ap pella tif
exprimé. Par exemple , le poiffon eft uiv aliment
fo r t f a i A , le vin eft une liqüeur dangereufe : i l
eft évident qut poiffon exprime ici une; efpèce
d aliment , & v in , une efpèce de liqueur ; les
attributs en font la preuve : c’eft donc comme .fi
Ton d ifo it , /’aliment poiffon , la liqueur vin y &
c eft pour marquer cette détermination qu’on emploie
1 a r tic le, parce que les efpèces font à l ’égard du
genre ce que les individus font à l’égard de 1 efpèce.
D autres fois l’addition faite au nom ap p e lla tif
foufentendu eft un nom propre ; & i l indique
d une maniéré bien plus précife le nom appellatif.
^ftG-au Jfin , L e T a f fe , L e T itien y c’eft à dire,'
L actrice appelée G auftin, L e poète appelé Taffe,
L e peintre appelé Titien : AAï|àr«fp«s o */A«r7ry, c’eft
a dire, AAî^ayJ'ms o ( vus ) Æ’ /A/^ttv , A lexan d r e le
( fils ) de Philip p e . . ' ;
I l faut pourtant obferver que , fi par Synecdoche
y voye^ ce root ) on transforme un nom propre en
a p p e lla tif , pour le rendre fignificatif par l ’idée
ne la qualité qui a diftingué l ’individu auquel i l
'“appartient, l ’article alors eft à fa place naturelle.
L ou is X I V f u t l ’Augufte de laFrance, L ou is X V I
en eft le T i t e ; T A u g u fte , c’eft à dire, le prince
arm. & protecteur des ftien a es & des a r t s y le Tite ,
c e f t a dire, le prince ami & bienfaiteur dès hom-
mes-. dans les deux phrafes , l ’article détermine à
un feul individu l ’étendue des noms appellatifs A u -
gu fte 8c T ite y & cette détermination eft décidée
par les circonftances.
Enfin 1 addition faite au nom ap pella tif fouf-
entendu eft fouvent un ad je â if phyfique , fur leque l
1 article femble alors tomber immédiatement ■ le
/a v an t trouve f isp la i/ ir s dans l ’étude , Us Impies
trouvent leur punition dans leurs propres égare- .
ment s , c’eft à d ite , /’homme / a v a n t , Us hommes
impies ; U riche L iicu lle , ce ft à d ire , /’homme
■ riche appelé L u cu lle.
Cette manière d’ expliquer l ’ufage de l ’article indic
a tif le , la U s avant un ad je â if phyfique me
paroît pins naturelle & pins vraie que ce lle de
M. D uclos , qui dit ( loc. f it. ) que l ’article , fe
joignant à un a d je â if fe u l , le h i t prendre fnbftanti-
vemenf, c’ eft à dire qu’i l le métamorphoiè en un
no.m aPpella!Îf. I l eft vrai que L e , L a , Les-, commit
; ïtojeâ it, fuppofe un nom appella tif auquel i l doit
etre ajouté 5 & que , comme artic le , i l doit eri déterminer
retendue fans toucher a la compréhenfion i
mais i l eft vrai aufli que fa v a n t , im pie s ,] riche ,
étant adjeâifs , fuppofent pareillement un nom
ap pella tif auquel ils^doivent être ajoutés; & qu’é-
tant adjeâifs phyfiques, ils doivent en modifier la
compréhenfion fans égard à l ’étendue. Les droits
refp’eâ ifs de cés deux efpèçes de mots font donc
égaux ; aucun dgs deux ne doit être facrifié à l ’autre;
chacun des deux fuppofe un nom ap p e lla tif, qui
eft Amplement foufentendu ; ni l ’un ni l ’autre n’en
prend la place, ni là fon âioh,, hors les cas où l ’ad-
je étif phyfique. eft pris fubftantivement. .( voyez
S u b s t a n t i v e m e n t ) : mais dans ces cas-là même ,
on ne-met pas l ’article le , la , les avant F a d je â if ,
afin de le faire prendre fubftantivement ; oh l ’y met ,
parce que le mot n’ eft plus un ad je â if 8c que c’eft
un nom appellatif. - -
I l y a donc aufli de l ’inexaâitude dans la remar-
qpe de M. F romant. , quand, i l dit ( S u ppl. à la
Gramrn. gén. II. v i f ) que « lès fiinples .adjeâifs,
» lorfqu’ils font éloignés de leur fubftantif & qu’ ils
»• fervent • à fpécifier une différence , admettent
» l ’article pour. înàrq'uer un fens 'diftribùtif » : 8c
i l cite c et exemple ; j i ce fo n t deux focurs que la
langue italienne & Vefpagnole , ce lle-ci eft la
prude , Vautre eft la coquette. Jamais un a d je â if ,
demeurant a d je â if , n’admet pour fon compte l ’article
indicatif ; c’eft pour le compte du nom appella
t i f auquel i l fe rapporte : i l eft évident que , dans
l ’éxemplé en queftion , /<z ne tombe'point fur le s
adjeâifs prude. 8c~coquette , mais qu’i l tombe uniquement
fur le nom ap pella tif foe u r , comme û
l ’on difoit c e lle - c i eft la foeur p ru d e , Vautré eft
la foeur coquette.
DansJe raport analyfë AesRemarques àt M. D uc
l o s fur la Grammaire générale de P o r t -R o y a l,
& du Supplément de l ’abbé F r o m a n t , que
. f i t , à l ’Académie royale dés fciences ,'belles-Lettrés
, d£*arts de Rouen, M. Maillet d u -Bô u l l a y ,,
fe'crétairè de cette academie pour les'belles-Lettres ;
i l dit que l ’article pluriel fait confiéerer le nom
dans un f e n s 'c o lle â if , & le fingulier au contraire
dans un fèns individuel diftribùtif. « Quand on d i t ,
» les hommes fo n t raifonnables.,- c’eft à dfie ,
n a jou tn -t-il, de tous les- hommes çolieâiveinent
» qu’ils font raifonnables : quand on dit, Vhomme
» eft raifonnable , c’eft à dire de chaque individu
» quelconque diftributivement, qu’il eft raifonnable;
» ce qui revient au même pour le fens ». Cette afler^
tion me femble répréhenfibie par plus d’un endroit.
_ En premier lie u , elle paroît fuppofer que- l ’article
indicatif l e , la , les , détermine toujours
l ’étendue à la totalité des. individus , & qu’i l ne
prend les inflexions du fingulier ou du pluriel que
pour repréfenter cette totalité en détail ou en
gros. Mais les différents exemples que l ’on vient
aç voir , prouvent fufSfomjiient qu’i l n’eft pas
toujours queftion -de la totalité des individus après
le j l a , les : les rois ont fo n d é les _ p r in c ip
a le s abbayes de France , i l ne s’agit ic i que de
quelques rois de France ; le roi déjire la p a ix , i l
n’eft ici queftion que de L ou is X V I . -
En fécond lieu , i l n’eft pas vrai que le , l a ,
les détermine aucune quotité d’individus ; c’ eft un
article purement indicatif, parce qu’i l ne fait
qu’ avertir qu’i l s’agit d’individus, & qwe l ’abftrac-
tion; qu’en fait par lui-même le nom ap pella tif n- a pas
lieu dans le cas préfent : du refté c’eft aux circonfi
tances du difèours à déterminer les' quotités., ainfi
qu’on l ’a vu dans les explications précédentes.
• En troifîème lieu' , i l peut véritablement ie rencontrer
dès cas où i l s’agit de la totalité dés individus
défignés par l ’article indicatif. M a is , i ° . i l
n’eft pas poflible alors que les deux nombres reviennent
au même pour le fens , comme le dit nettement
M . du Boullay. I l paroît établi fur de trop folides
raifons qu’i l n’y a point de fynonymie ex aâ e dans
les langues ; &■ l ’auteur lui-même afïlgne des différences
entre' les deux éxpreffions où i l croit voir
identité de féhs : i l eft confiant qu’un écrivain attentif
ne dira pas indifféremment Vhomme eft raifonnable ,
ou les hommes fo n t raifonnables y 8c que la différence
de ces deux expreflions'doit tenir à ce lle des
deux nombres qui y font employés. i ° . Je crois que
cette 'différence n’eft pas bien careâérifée par le
fecrétaire de R o u en , & qu’on peut avec plus de
préciflon la réduire aux carââères fuivants.
Quand i l s’agit dé l ’univerfalité dés individus ;
l e fingulier de l’article eft plus propre à en marquer
la totalité phyfique fans re ftr iâ io n , parce
qu’i l en fait naturellement naître l ’idée par celle de
Funité. L e pluriel au contraire eft plus propre à
défigner l ’univerfalité morale : parce que ce nombre
avertit naturellement du détail en montrant la
pluralité ; & q u e , le détail n’étant néceffaire que
quand l ’uniformité manque , le pluriel indique ,
par «ne conféquence affez analogue, que l ’univer-
îa lité n’eft pas fi entière qu’i l ne puiffe y avoir
•des exceptions ou des variétés.
L ’ufage dé l ’article fingulier l e , la , eft donc particulièrement
propre aux cas où l ’attribut e ft , comme
difent les philofophes , en matière néceffaire ;
l ’ufage du pluriel le s ' fuppofe au contraire que
l ’attribut eft en matière contingente.
• A in f i, i l faut d ire , V.homme eft raifonnable ;
pour faire entendre que la faculté de raifonner ,
qui eft' en effet de l ’ordre des chofes néceffaires ,
appartient à toute l ’efpèce humaine & en eft un
attribut effenciel : c’eft cpmme fi l ’on d ifo it, /’animal
homme eft un animal raifonnable , exclnfive-
ment a toute autre efpèce du même genre. Mais on
doit dire, les hommes fo n t raifonnables , fi l ’on
veut parler du bon ùfage de la raifon ; parce que
cet attribut eft en matière contingente , & que ,
dans le détail des individus , plufieurs fe trouve-
xoient exceptés de Tuniverfalite.
Ï V la même raifon, il y a de la ^ifféhnce çptre
ces deux phrafes , l ’homme eft m orte l, le s hommes
fon t mortels. L a première annonce la certitude
infaillible de la mort ; & c’eft une vérité que l ’on
peut pofer comme principe dansunfermon ou dans
un traité de Morale. L a fécondé annonce l ’incertitude
du .moment & de la manière de la mort ;
les uns mourant plus tô t , les autres plus tard ; ceux-
ci fubltement, c e u x - là par une maladie longue :
c’eft une: vérité d’où l ’on peut partir dans les conventions
, pour s’autorifér à prendre dans le moment
même les précautions convenables.
O n reconnoitra , fi l ’on y prend g arde, que cette
diftinâion explique réellement l ’ufage confiant de
ceux qui parlent & qui écrivent avec précifion. Mais
i l y a encore quelques obfervations à faire fur l ’emp
lo i de cet article le , l a , les.
i° . L e , lai, le s , fe mettent fouvent feuls & fans
accompagner un nom , quoiqu’ils y ayent un rapport
néceffaire & vifible ; alors ils repréfentent le
complément o b je â if d’un v erbe, & contre l ’ordre
ordinaire ils fe placent avant le verbe, cette inver-
fion étant ménagée pour indiquer l’ellipfe du nom*
En parlant d’un homme , d’un cheval , d’un livre ,
on dit Je le connais y au lieu de Je cohnois le
homme , le ch e v a l, le livre dont i l s’agit : en parlant
d’une femme , ,d’une brebis, d’une mai fon , on
dit Je la verrai y au lieu de Je verrai la femme ,
la brebris, la maifon dont on parle : en parlant
enfin de plufieurs hommes, de plufieurs femmes,
de plufieurs livres , de plufieurs maifons , on dit
Je le s examinois y au lieu de J ’examinois les
hommes , tes femmes , les liv re s , les maifons dont
i l eft queftion.
Tous les grammairiens conviennent que notre artic
le le 3 la , les , tire fon origine du latin ille , ilia ,
illu d , de même que l ’article indicatif des italiens,
& celui des efpagnols. O r cet a d je â if latin , qui eft
lui-même un véritable article, eft abufivement regardé
comme pronom : de là vient apparemment que
l ’abbé d’O liv e t dit que c’eft un pronom ad je â if ;
& que l ’abbé Fromant , qui le cite ( Suppl, à la
Gramm. gén. II. v i f ) , appuie cette décifion par
ce laifonnement : « L ’article eft une forte de pro-
» nom lorfqu’ i l précède un verbe , & par confé-
» quent lorîqu’i l précède un nom. Ave^-vous lu
» la Grammaire nouvelle i fd o n , j e la lira i bien*
» tôt : pourquoi voudroit-on que la ne fut pas de
» même nature dans ces deux endroits? »
L e ^principe qui termine ce raifonnement eft
très-bon', & je crois en effet que l a , dans les
deux cas , eft ex a â e ment de la même efpèce. Mais,
dans le premier cas , c’eft un véritable ad jeâ if q ui
fixé l ’attention de l ’efprit fur un individu, dont la
nature eft énoncée d’une manière générale par le
Æom ap pella tif Grammaire : c’eft donc , dans lé
fécond cas , un a d je â if de même efpèce ; 8c la
fupprefïion même du nom eft un avertiffement
que la nature de l ’individu, défigné vaguement par
la , a déjà été exprimée par le nom Grammaire
qui prççè^Ç ?«çcp^Tp aSn^ ^ IT1^me m°t- Dans i e
M a j w i