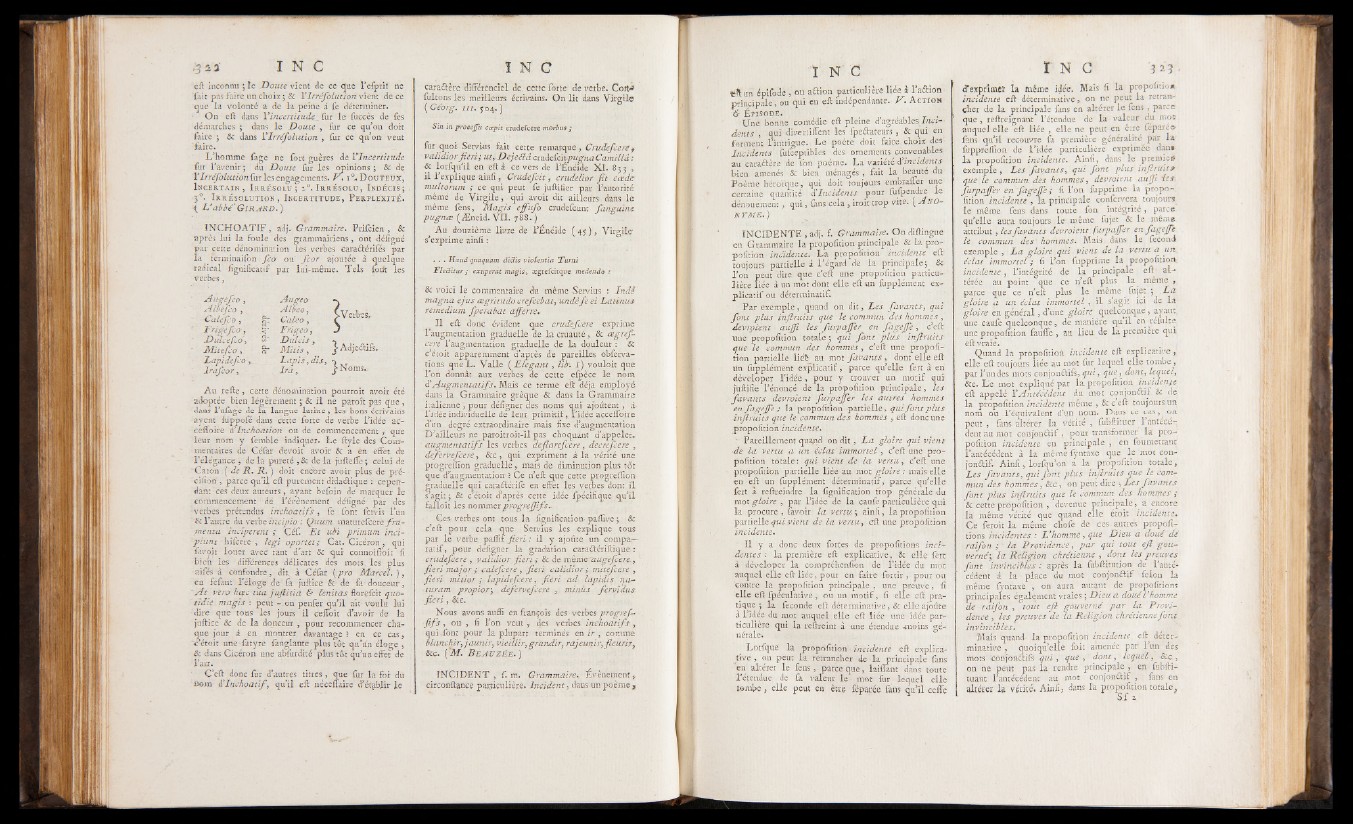
eft inconnu ; le D o u te vient de ce que Tefprif ne
fait pas faire un choix j & l ’Irréfolution vient de ce
que la volonté a de la peine à fe déterminer.
O n eft dans l ’ incertitude fur l e fuccès de fes
démarches ; dans le D ou te , fur ce qu’on doit
faire ; & dans l ’Irréfolution fur ce qu’on veut
•faire.
L ’homme fage ne fort guères de l ’ Incertitude
fur l ’avenir ; du Doute fur lés opinions ; & de
VIrréfolution fur les engagements. V . i°-. Douteux,
Incertain , I rrésolu ; z°. Irrésolu, Indécis;
5°. Irrésolution, Incertitude, P erplexité.
( L 'a b b é 1 G i r a r d . )
IN C H O A T I F , adj. Grammaire. Prilcien , &
après lui la foule des grammairiens, ont défîgné
par cette dénomination les verbes eara&érifés par
la terminailbn fc o ou fc o r ajoutée à quelque
radical fignifîcatif par lui-même. T e ls forit les
verbes,
A u g e f c o - ,
Aïbèfco , .
Cale fco ,
F r i g e f c o ,
Didcefio',
M ite fc o ,
Lapide fco-
Irafcor
Augeo-
A lb e o ,
Caleo y
F ri geo y
Or D u l c i s ,
o* M i t i s ,
Verbesr
y Adjectifs*
oms..-
L a p is y d is y
Jm , j - î
A u r e lie , cette dénomination pourroit avoir été
adoptée bien légèrement ; & i l ne paroît pas que ,
dans 1’ulage de la langue la t in e , les bons écrivains
ayent lüppofé dans cette forte de verbe l ’idée ac-
cefloire d’ Inchoation ou de commencement , que
leur nom y femble indiquer. L e ft-yle des Commentaires
dé Céfar devoit avoir & a en effet dfe
l ’élégance , de la pureté ,& de la jufteffe ; celui de
‘ Caton ( de R . R . ) doit encore.avoir plus de pré-
c i fion , parce qu’i l eft purement didactique : cependant
ces deux auteurs, ayant befoin de marquer le
commencement dé l ’évènement défîgné par des
-verbes prétendus in ch o a t ifs , le font fends l ’un
& l ’autre du vtébt iticipio : Quum maturefcere f r u -
' ment a indperent ,* Céf. E t ubi primum inci-
p iu n t hifcere , h g i oportet ; Car. Cicéron, qui
favoit louer avec tant d’art & qui connoiffoit fï
bien les différences délicates des mots, le s plus
aifés à confondre, drt^ à Céfàr {pro Marcel. ) ,
eu fêlant l ’éloge de la jiiftice & de fa douceur,
' A t verg-hoec tua ju j li t ia & lenitas florçfcit quo-
tidie magis : peut -.on penfer qu’i l ait voulu lui
dire que tons les jours i l ceffoit d’avoir de la
juftice & de la douceur , pour recommencer chaque
jour à en montrer davantage ? en ce ca s,
«étoit une fatyre fanglante plus tôt qu’ itn éloge ,
& dans Cicéron une abfurdité plus tôt qu’un effet de
Tant.
Ç’eft donc fur d’autres titres, que fur la foi du
»om â’In ch oa tif, qu’i l eft néeeflaire d’établir le
caraéfère différenciel de. cette forte de verbe. C o f lj
fultons les meilleurs écrivains. O n lit dans Virgile?
( Céorg. i n . yo*. )
Sin in proeejfu capit erudefcere morbus ;
fur quoi Servius fait cètte remarque, C r u d e f c e r e ^
v a l id i o r f i e r i ; u t yD e j e é î â cmdefcitpugna Camiüâ :
& lorfqu’i l en eft à ce vers de l ’Énéide X I . 833 ,
i l l ’explique ainfî, C r u d e f c i t , c r u d e l io r f i t c c e d t
m u l t o r u m ; ce qui peut fe juftifier par l ’autorité
mèmè de V ir g ile , qui avoit dit ailleurs dans le
même fens, M a g i s e f f u f o crudefcunt f a n g u i n e
p u g n oe (Æneid. V I I . 788. )
A u douzième livre de TÉnéide (4.5) , V ir g ile
s’ exprime ainfî :
. . . Haud quuquam diclis violentia Turni
Fleâitur j cxuperat magis, ægrefcitqüe medendo-:
& voici le commentaire du même Servius : I n d é
m a g n a e j u s oe g r i tu d o c r e f c e b a t , u n d è .f e e i L u t i n u s
r em e d iu m f p e r a b a t a f f e r r e ;
I l eft donc évident que c ru c te fc e r e exprime
Taugmentation graduelle de la cruauté, & c e g r e f -
c e r e Taugmentation graduelle de la dquleur : &
ç’écoit apparemment d’après de pareilles obferva-
tîons que L . V a lle ( E l é g a n t , lib \ ,r) vouloit que
Ton donnât aux verbes de cette efpèce le nom
d’A u g m e n t a t i f s . Mais ce terme eft déjà employé
dans la Grammaire grèque & dans la Grammaire
italienne , pour défîgner dès noms qui ajoutent, à-
l ’idée individuelle de leur primitif, l ’idée acceffoire
d’un degré extraordinaire mais fixe d’augmentation
D ’ailleurs ne paroitroit-11 pas choquant d’appeler»
a u g m e n t a t i f s les verbes d e f lo r e f c e r e , d e c r e f c e r e ,
d e f e r v e f c e r e , & c , qui expriment à la vérité une
progreffion graduelle , mais de diminution plus tôt
que d’augmentation ? Ce n’eft que cette progreffion
graduelle qui caraélérifê en effet les verbes dont i l
s’agit ; & c étoit d’après cette idée fpécifique qu’i l
falloit les nommerp r o g r e f f i f s „
C e s verbes ont tous la fignification- paffiye ; ! &
c’eft pour cela que Servius les explique tous
par le verbe paffif f i e r i : i l y ajoute un compa.—
ra tif, pour défîgner la gradation caradtériftique :
c r u d e f c e r e , v a lu l i o r f i e r i ; & de mêmo 'U .u g e fc e r e . ,
f i e r i m a jo r ÿ c a l e f c e r e , f i e r i c a l i d i o r ,■ m i t e f c e r e ,
. f i e r i m i t i o r ÿ la p id e f c e r e , f i e r i a d la p i d i s n a -
tu r a m p r o p io r 'y d e f e r v e fc e r e , m in ù s f e r v i d u s
f i e r i y &e.
No-us avons auffi en françois dès'verbes p r o g r e f -
j i f s , ou , fi Ton veut y des verbes i n c h o a t i f s - ,
qui.font pour la plupart terminés en i r , comme
b la n c h i r y j a u n i r y v i e i l l i r , g r a n d i r y r a j e u n i r , f l e u r i r ,
& c. ( *M . B e a u z é e . )
IN C ID E N T , f. m. G r a m m a i r e Évènement 9
circonflanee particulière. I n c i d e n t , dans un poème j
t â u n épifodé , ou aôfcion particulière liée à l ’aétion•
principale, ou qui en eft indépendante. V . A ction
6 É pisod e. ; ^ / .
Une bonne comédie eft pleine d’agreables I n c i dents
., qui divertiffent les fpeéfateurs , & qui en
forment l ’intrigue. L e poète doit faire choix des
Incid ents fufeeptibles des ornements convenables
au caractère de fon poème. L a variété Üincidents
bien amenés & bien ménagés , fait la beauté du
Poème héroïque, qui doit toujours embraüer une
certaine quantité d’incidents pour fu{pendre le
dénouement, q u i, fans c e la , iroit trop vite. ( A n O-
R TME. )
IN C ID E N T E , adj. f. Grammaire. O n diftingue
en Grammaire la proposition principale & la pro-
pofîtion incidente. L a propoficion incidente eft
toujours partielle à 1 egard de la principale; &
l ’ on peut dire que c’eft une propofition particuliè
re liée à un mot dont e lle eft un fupplément exp
lica tif ou déterminatif.
Par exemple, quand on d i t , L e s fa v a n ts , qui
fo n t p lu s infiru its que le commun des hommes f
devraient auffi les furpajfer en fa g e j f e , c’eft
une propofition totale ; qui fo n t p lu s infiruits
que le commun des hommes, c’eft une propofition
partielle liéfc au mot fa v a n ts , dont e lle eft
lin fupplément e x p lica tif, parce qu’e lle fert à en
dèveloper l ’id é e , pour y trouver un motif qui
juftifiè l ’énoncé de la propofition principale, les
fa v a n t s devroient furpajfer le s autres hommes
en fage jfe ; la propo fit ion partielle -, qui fo n t p lu s
infiru its que le commun des hommes , eft donc une
propofition incidente.
‘ Pareillement quand on d i t , L a gloire qui vient
■ de la vertu a ün éclat immortel, c’ eft une propofition
totale : qui vient de la vertu , c’eft une
propofition partielle lié e au mot gloire : mais elle
en eft un fupplément déterminatif, parce qu’e lle
fert a reftreindre la fignification trop générale du
mot gloire , par l ’idée de la caufe particulière qui
la procure , {avoir la vertu ainfî, la propofition
partielle qui v ient de la vertu y eft une propofition
incidente.
I l y a donc deux fortes de propofîtions incfc
dentes : la première eft explicative, & elle fert
à dèveloper la compréhenfion de l ’idée du mot
auquel e lle eft lié e , pour en faire fortir ,- pour ou
contre la propofition principale , une preuve , fi
e lle eft fpéculative , ou un m o t if, fi e lle eft pratique
; la fécondé eft déterminative, & elle ajoute
à l ’ idée du mot auquel elle eft liée une idée particulière
qui la reûreint à une étendue .moins générale.
.
Lorfque la propofition - incidente eft explicat
iv e , on peut la retrancher de la principale fans
én altérer le fens t parce q u e , laiffant dans toute
l'étendue, de fa valeur le- mot fur leque l elle
tombe, elle peut en être féparée fans qu’i l eeffe
d1 exprime!- la même idée. Mais fi la propofitioa
incidente eft déterminative, on ne peut la retran--
cher de la principale fans en altérer le fens , parce
q u e , reftreignant l ’ étendue de la valeur du mot-
auquel elle eft lié e , elle ne peut en être feparee
fans qu’i l recouvre fa première généralité par la
fuppreffion de l ’ idée particulière exprimée dans
la propofition incidente. A in fî, dans le premier
exemple , L e s fu y a n ts , qui fo n t p lu s infiru it»
que le commun des hommes, devroient auffi le s
furpajfer en fa g e jfe ÿ fi l ’on fiipprime la propo-
fition incidente , la principale confervera^ toujours
le même fens dans toute fou intégrité, parce
qu’elle aura toujours le même fujet & le meme,
attribut, les fa v a n ts devroient furpajfer en fage jfe
le. commun des' hommes. Mais dans le fécond
exemple , L a gloire qui vient de la vertu a un.
éclat immortel, fi Ton fupprime la propofition:
incidente , l ’intégrité de la principale eft - a ltérée
au point que ce n’ eft plus la^ même ,
parce que ce- n’eft plus le même fujet.; .L a
gloire a un éclat immortel , i l s’agit ici de la
gloire en g én é ral, d’une gloire quelconque, ayant,
une caufe quelconque, de manière qu’i l en refulte
une propofition fauffe , au lieu de la première qui
eft,vraie. - ,
Quand la propofition incidente eft explica tive,
e lle eft. toujours liée au mot fur lequel e lle tombe,
par l ’un des mots conjonftifs, q u i, q ue, donty lequel,
&c. L e mot expliqué par la, propofition incidente
eft appelé Y Antécédent du mot conjonétif & de
la propofition incidente même , & c’eft- toujours un
nom ou .l ’équivalent d’un nom. Dans ce cas on
peut-, fans- altérer la vérité , fubftituer 1 antécédent
au mot conjonélif , -pour transformér la propofition
incidente en principale , en foumettanr
l ’antécédent à la même fÿntaxe que le mot con-
jonétif. A in f î, lorfqu’on a la propofition tota le,
L e s fa v a n ts y qui fo n t p lu s infiru its que le commun
des hommes y & c , on peut dire ; L e s fa v a n t s
fo n t p lu s infiru its que le commun des hommes ,*
& cette propofition , devenue principale, a encore'
la même vérité que quand elle étoit incidente.
C e feroit la même chofe de ces autres propofîtions
incidentes : L ’homme, que D ie u a doue de
raifon ÿ la Pro v id en ce , p a r qui tout e jl g ou verné,
la R e ligion chrétiemie , dont les p reuves
fo n t ' invincibles : après la fubftitution de l ’antécédent
à la place du mot conjonftif félon la
même fyntaxé , on aura autant de propofitions
principales également vraies ; D ie u a doué l ’homme
de raifon , tout e jl gouverné p a r la Providence
, les preuves de la R e ligion chrétienne f o n t .
invincibles i . „ f
Mais quand la propofition incidente -efl déterminative
7 quoiqu’e lle {bit amenée par 1 un des
mots conjonôtifs qui , que , d on t, le q u e l, & c ,
on ne péut pas la rendre principale , en fubfti-
tuant l ’antécedent au mot conjonétif , fans en
altérer la vérité. Ainfi, dans la propofition totale?