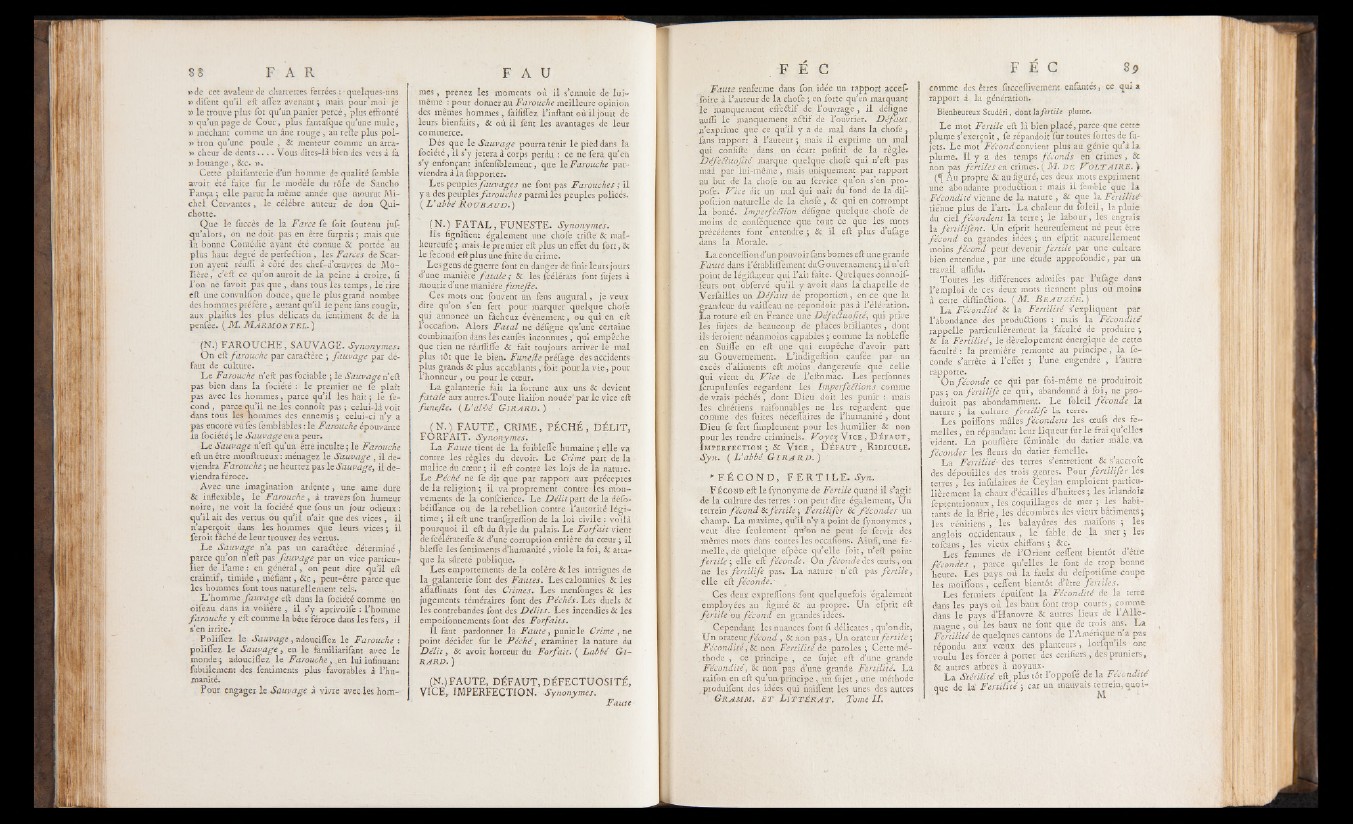
»de cet avaleur de charrettes ferrées : quelques-uns
» difent qu’i l eft allez avenant 3 mais pour moi je
» le trouve plus lot qu un panier p ercé} plus effronté
» qu’un page de C ou r , plus fantafque qu’une mu le,
» méchant comme un âne rouge , au relie plus pol-
» tron qu’une poule , & menteur comme un arra-
» cheur de dents. . . . V ous dites-lâ bien des vers à fa
» louange , &c. ». 1
Cette plaifanterie d’un homme de qualité femble
avoir été faite fur le modèle du rôle de Sancho
Pan ça ; e lle parut la même année que mourut Mich
el Cervantes, le célèbre auteur de don Qu ichotte.
Que le fuccès de la Farce fe foit foutenu ju f
qu’alors, on ne doit pas en être furpris ; mais que
l a bonne Comédie ayant été connue & portée au
plus haut degré de perfection, les Farces de Scar-
ron ayent réuffi à côté des chef-d’oeuvres de Moliè
re , c’efl ce qu’on auroit de la peine à croire, fi
l ’on ne favoit pas q u e , dans tous les temps, le rire
eft une convulifon douce, que le plus grand nombre
des hommes préfère , autant qu’i l le peut fans rougir,
aux plaifîrs les plus délicats du fentiiiient & de la
penfée. ( M . M a r m o n t e l . )
(N.) F A R O U C H E , S A U V A G E . Synonymes.-
O n eft farouche par caractère ; fau va ge par défaut
de culture.
L e Farouche n’eft pas fociable ; le Sauvage n’eft
pas bien dans la fociété : le premier ne fe plaît
pas avec les hommes, parce qu’i l le s hait ; le fécond
, parce qu’i l ne Les connoît pas ; celui-là voit
dans tous les nommes des ennemis 3 celui-ci n’y a
pas encorè vu fes femblables : le Farouche épouvante
la fociété j le Sauvage en a peur.
L e Sauvage n’eft qu’un être inculte 3 le Farouche
eft un être monftrueux : ménagez le Sauvage , i l deviendra
Farouche 3 ne heurtez pas le Sauvage, i l deviendra
féroce.
A v ec une imagination ardente, une ame dure
& inflexible, le F arou che , à travers fon humeur
noire, ne voit la fociété que fous un jour odieux :
qu’ i l ait des vertus ou qu’i l n’ait que des v ice s , i l
n’aperçoit dans les hommes que leurs vices ; i l
feroit fâché de leur trouver des vertus.
L e Sauvage n’a pas un caractère déterminé ,
parce qu’on n’eft pas fau va ge par un vice particulie
r de l ’ame : en général, on peut dire qu’i l eft
craintif, timide , méfiant, 8cc, peut-être parce que
les hommes font tous naturellement tels.
L ’homme fauvage eft dans la fociété comme un
oifeau dans la voliere , i l s’y aprivoifè ; l ’homme
farouche y eft comme la bête féroce dans les fers, i l
s’en irrite.
P o liffez le S a u v a g e , adouciffez le Farouche :
p oliffez l e S a u v a g e , en le familiarifant avec le
monde 3 adouciffez le Farouche, ,en lui infinuant
fubtilement des fentiments plus favorables à l ’humanité.
Pour engager le Sauvage à vivre avec les hommes
, prenez les moments ou, i l s’ennuie de lu i-
même : pour domier au Farouche meilleure opinion
des mêmes hommes, faififfez l ’inftant ou i l jouît de
leurs bienfaits, & où i l fent les avantages de leur
commerce.
Dès que le Sauvage pourra tenir le pied dans la
fociété, i l s’y jetera à corps perdu : ce ne fera qu’ en
s’y enfonçant infènfiblement, que le Farouche parviendra
à la fupporter.
Les peupies fau va ge s ne font pas Farouches ; i l
y a des peuples farouches parmi les peuples policés.
{ L ’ abbé K o u b A U D .)
(N . ) F A T A L , F U N E S T E . Synonymes.
Ils lignifient également une chofe trifte' & mal-
heureufe ; mais le premier eft plus un effet du fort, &
le fécond eft plus une fuite du crime.
Les gens de guerre font en danger de finir leurs jours
d’une manière fa ta le ,* & les fcéléràts font fujets à
mourir d’une manière fu n e fîe .
Ces mots ont fouvent un fens au gura i, je veux
dire qu’on s’en fert pour marquer quelque chofe
qui annonce un fâcheux évènement, ou qui en eft
loccafîon. Alors F a ta l ne défîgne qu’une certaine
combinaifon dans les caufes inconnues, qui empêche
que rien ne réiiflîffe & fait toujours arriver le mal
plus tôt que le bien. Funejle préfage des accidents
plus grands & plus accablants ,'foit pour la v ie , pour
l ’honneur, ou pour le coeur.
L a galanterie fait la fortune aux uns & devient
fa ta le aux autres.Toute liaifon nouée'par le vice eft
fu n e jle . ( L ’a t ë é G i r a r d . ) -
( N . ) F A U T E , C R IM E , P É C H É , D É L IT ,
F O R F A IT . Synonymes.
L a Fau te tient de la foibleffe humaine ; elle va
contre les règles du devoir. L e Crime part de la
malice du coeur 5 i l éft contre les lois de la nature.
L e P é c h é ne fe dit que par rapport aux préceptes
de la religion j i l va proprement contre les mouvements
de la confcience. L e D é lit part de la défb-
béiffance ou de la rébellion contre l'autorité lé g itime
3 i l eft une tranfgreffion de la lo i civile : voilà
pourquoi i l eft du ftyle du palais. L e F o r fa it vient
de fcélérateffe & d’une corruption entière du coeur 3 i l
bleffe les fentiments d’humanité , viole la foi, 8c attaque
la sûreté publique.
Les emportements de la colère & le s intrigues de
la galanterie font des Fautes. Le s calomnies & les
affaflinats font des Crimes. Les menfonges & les
jugements téméraires font des P é ch é s ; Les duels &
les contrebandes font des D é lit s . Le s incendies & les
empoifonnements font des F o r fa its .
I l faut pardonner la F a u te , punir le Crime , ne
point décider fur le P é c h é , examiner la nature du
D é l i t , 8c avoir horreur du F o r fa it. ( Labbé G i r
a r d . )
(N.) F A U T E , D É F A U T , D É F E C T U O S IT É ,
V IC E , IM P E R F E C T IO N . Synonymes.
Faute
Faute renferme dans fon idée un rapport accef-
foire à l ’auteur de la chofe 3 en forte qu’en marquant
le manquement effectif de l ’ouvrage, i l défîgne
auffi le manquement a é lif de l ’ouvrier. D é fa u t .
n’ exprime' que ce qu’i l y a de mal dans la ch o fe ,
fans rapport à l ’auteur j mais i l exprime un mal
qui confifte .dans un écart pofîtif de la règle.
D é fe cîu ofité marque quelque chofe qui n’ eft pas
mal par lui-mênie, mais uniquement , par rapport
au but de la chofe ou au fervice qu’on s’en pro-
pofe. V ic e dit un mal qui naît du fond de la dif-
pofidon naturelle de la ch ofe, 8c qui en corrompt
la bonté. Imperfection défîgne quelque chofe de
moins de conféquence que tout ce que les mots
précédents font entendre 3 & i l eft plus d’ufage
dans la Morale. . ,
L a co.nceffi on d’un pouvoir fans bornes eft une grande
F a u te dans l ’établiflement duGouvernement 3 i l n’ eft
point de légiflateur qui l ’ait faite. Quelques connoif-
leurs ont obfervé qu’ i l y avoit dans la chapelle de
.Verfailles un D é fa u t de proportion, en ce que la
grandeur du vaifleau ne répondoit pas à l ’élévation.
L a roture eft en France une Défecîuofité, qui prive
les fujets de beaucoup de places brillantes , dont
ils feroient néanmoins capables 3 comme la nobleffe
en Suiffe en eft une qui empêche d’avoir part
au Gouvernement.. L ’indigeftion caufée par un
excès d’aliments eft moins dangereufe que ce lle
qui vient du V ic e de l ’eftomaç. Le s perfonnes
forupuleufes regardent les Imperfections comme
de vrais péchés, dont Dieu doit les punir : mais
les chrétiens raifonnables, ne les regardent que
comme des fuites nécèffaires de l ’humanité , dont
D ieu fe fert Amplement pour les humilier & non
pour les rendre criminels. V oy e \ V ice , D efaut,
Imperfection 3 & V ice , D éfaut , Ridicule.
S y n . ( L ’abbé G i r a r d . )
. * F É C O N D , F E R T I L E . Syn.
F écond eft le fynonyme de Fertile quand i l s’agit
de là culture des terres. : on peut dire également, U n
terrein fécond. 8cfertile 3 Fertilifer 8c fé co n d e r un
champ. L a maxime, qu’ i l n’y a point de fynonymes ,
veut dire feulement qu’on ne peut fe fervir des
mêmes mots dans toutes'les occafibns. Ainfî, une fe melle
, de qüelque efpèce qu e lle fo i t , n’eft point
fe r t ile 3 elle eft féconde. O n fécondedes oeufs , on
ne les fe r tilife pas. L a nature n’eft pas f e r t i le ,
e lle ’ eft féconde. • ,
Ces deux expreffions font quelquefois egalement
employées au figuré & au propre. Un efprit eft
fe r tile ou f écond en grandes idées.
Cependant les nuances font fi délicates , qu’on dit,
. U n orateur f é c o n d , & non p a s, U n orateur fe r t ile 3
Fé con d ité, & non Fe r tilité de paroles 3 Cette m é-
. thode •, ce principe , ce fujet eft d’une grande
Fécondité, & non pas d’une grande Fertilité. L a
. raifon en eft qu’un/^rincipe , un fu je t, une méthode
^roduifent des, idées qui naiffent les unes des autres
G r a m m . e t L i t t é r a t . Tome I I .
comme des êtres fuccefiivement enfantés, ce qui a
rapport à la génération.
Bienheureux Scudéri, dont lu fertile plume.
L e mot Fertile eft là bien p la c é , parce-que cette
plume s’ exerçoit, fe répandoit fur toutes fortes de fujets.
L e mot Fécond convient plus au génie qu’ à l a
plume. I l y a des temps féconds en crimes, &
non pas fe r t ile s en crimes. ( M . de VOLTAIRE. )
' |®[ A u propre & au figuré, ces deux mots expriment
une abondante production : mais i l femble que la
Fécondité vienne de la nature , & que la Fertilité-
tienne plus de l ’art. 'L a chaleur du fo le i l, la pluie
du c ie l fécondent la terre 3 le lab o u r , les engrais
la fe r tilifen t. U n efprit heureufement né peut être
fé co n d en grandes idées. 3 un efprit naturellement
moins fé co n d peut devenir fe r t ile par une culture
bien entendue, par une étude approfondie, par un
travail aflidu.
Toutes les différences admifes par l ’ufage dans
l ’emploi de ces deux mots tiennent plus ou moins
à cette diftinétion. ( M . B E AUZ É E . )
L a Fécondité 8c la F e r tilité s’expliquent par
l ’abondance des productions : mais la Fé con d ité
rappelle particulièrement la Jf&ulté de produire ;
& la F e r tilité , le dèvelopement énergique de cette
faculté : la première' remonte au principe , la fécondé
s’arrête à l ’effet 3 l ’une engendre , l ’autre
rapporte.
On féconde ce qui par foi-même ne produiroit
pas 3 on fe r tilife ce qui, abandonné à fo i , ne produiroit
pas abondamment. L e fo le il fécond e la
nature 3 la culture fe r t ilife la terre.
Le s poiffons mâles fécondent les oeufs des femelles,
en répandant leur liqueur fur le frai qu’elles
vident. L a pouflière féminale du datier mâle, va
féconder les fleurs du datier femelle.
L a F e r tilité • des terres s’ entretient 8c s’accroît
des dépouilles des trois genres. Pour fe r tilife r les
terres , les infulaires de Ce ylan emploient^ particulièrement
la chaux d’écailles d’huitres 3 les irlandois
feptentrionaux, les coquillages de mer 3 les habitants
de la B r ie , les .décombres des vieux bâtiments 3
les vénitiens , les balayures des maifons 3 le s
anoiois occidentaux , le fable, de la mer 3 les
tofeans , les vieux chiffons 3 &c. . f i
Les femmes de l ’Orient ceffent bientôt d’être
fécondes , parce qu’elles le font de trop bonne
heure. Le s pays ou la faulx du defpotifme coupe
les moiffons, ceffent bientôt d’être fe r tile s .
Les fermiers épuifent la Fécondité de la terre
dans les pays ou les: baux font trop courts, comme
dans le pays d’Hanovre & autres lieux de l ’A i l e -
mao-ne, où les baux ne font que de trois ans. L a
F e n i li t é de quelques cantons de l ’Amérique n a pas
répondu aux voeux des planteurs, lorfqu’ils ont
voulu les forcer à porter des cerifiers, des pruniers,
& autres arbres à noyaux. f ,
L a Stérilité eft, plus tôt l ’oppofé de la Fécondité
que de la' F e r t ilit é 3 car un mauvais terrein, quoi-
.'i M -