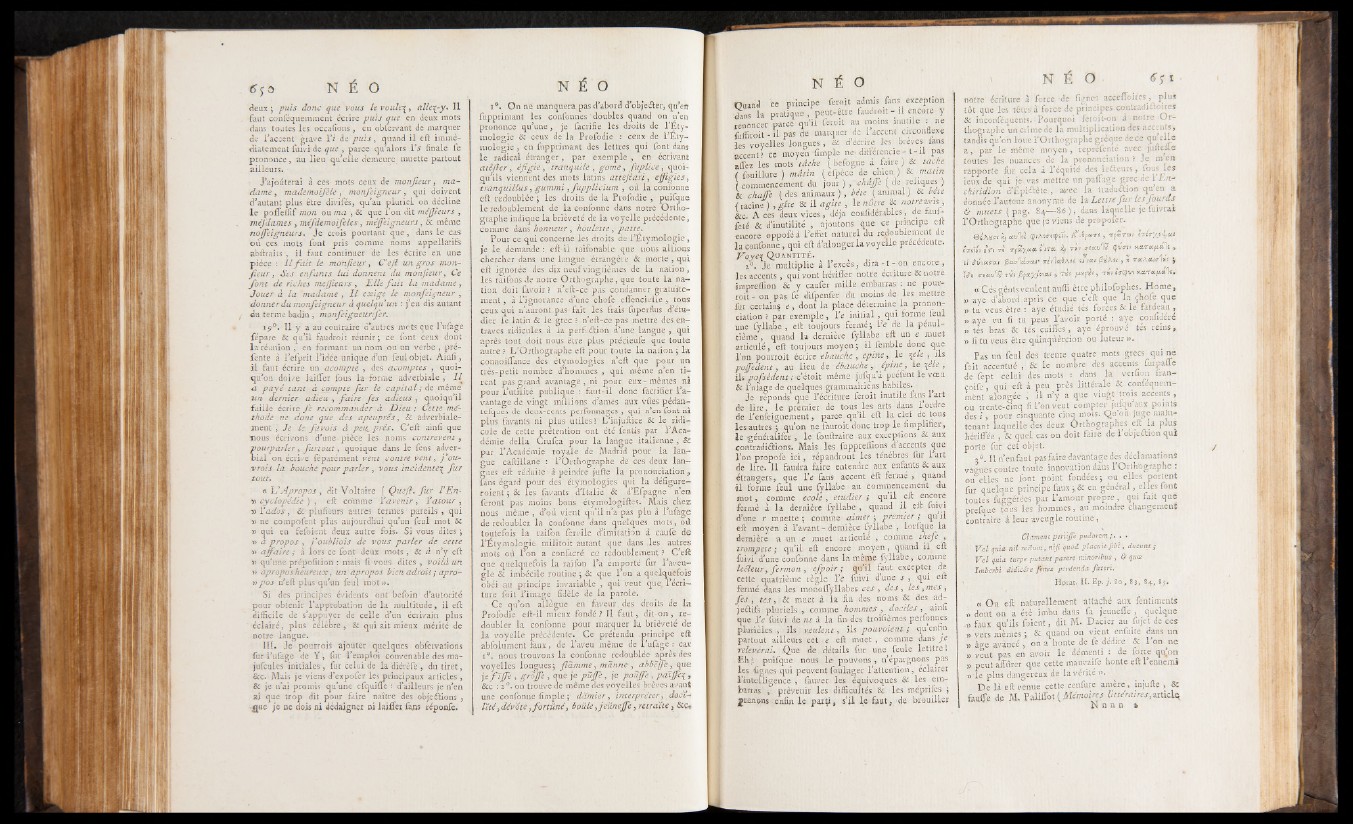
6 $ o N É O
deux j puis donc que vous le vouh\ , alle\-y. Tl
faut conféquemment écrire p u is que en deux mots
dans toutes les o.cca fions , en obfervant de marquer
de l ’accent grave l ’i de p u i s , quand i l eft immédiatement
fuivi de que , parce qu alors l ’j finale fe
prononce, au lieu qu’elle demeure muette partout
ailleurs. -
J’ajouterai à ces mots ceux de monjieur, madame
, mademoifèle , monfeigneur, qui doivent
d’autant plus être divifés, qu’au pluriel on décline
le poffelïif mon ou ma , & que 1 on dit méjjieurs ,
méfiâmes , méfdemoifeles, méffeigneurs, 6c même
nojfeigneurs. Je crois pourtant q u e , dans le cas
où ces mots font pris comme noms appellarifs
abftraits , il faut continuer de les écrire en une
pièce : I l f a i t Le monjzeur, C ’efl un gros moniteur
, Se s enfants lui donnent du monjieur, Ce
fo n t de riches mejjîeurs , E l le f a i t la madame,
Jouer à la 'madame , I l exige le monfeigneur ,
donner du monfeigneur à quelqu’ un : j’en dis autant
du terme badin , monfeigneur fe r .
• ip ° . I l y a au contraire d’autres mots que l ’ufage
fépare & qu’i l faudroic réunir; ce font ceux dont
la réunion, en formant un nom où un verbe, préfente
à i ’efprit l ’idée unique d’ un feul objet. Ainfi ,
i l faut écrire un acompte , des acomptes , quoiqu’on
doi/e lai fier fous la-forme adverbiale ,• I l
a p a y é tant à compte fu r le ca p ita l; de même
u n dernier adieu , fa ir e f e s a d ieu s , quoiqu’i l
fa ille écrire Je recommander à D ie u ; Cette méthode
ne doue que des apeuprês, & adverbialement
, Je le fa v o is à p a u p r è s . G’eft ainfi que
nous écrivons d’une pièce les noms contrevent,
pourparler, fu r to u t , quoique dans le fens adverbial
on écrive féparément vent contre v en t, f o u -
vrois la bouche pour p a r le r , vous incidente^ fu r
tout.
« L JA p r o p o s j dit Voltaire ( Quefl. fu r VEn-
» cyclopédie ) ', eft comme Y av en ir , Yatour ,
» Y a d o s , & plufieurs autres termes pareils , qui
» ne compôfent plus aujourdhui qu’un feul mot &
» qui en fefoient deux autre fois. Si vous dites;
» a propos , j ’ oubliois de vous parler de cette
» affair e; à lors ce font deux mots, & à n’ y eft
» qu’une prépofition : mais fi vous dites , voilà un
» apropos heureux, un apropos bien adroit ; apro-
» p o s n’eft plus qu’un feul mot».
Si des principes évidents ont befoin d’autorité
. pour obtenir l ’approbation de la multitude, i l eft
difficile de s’appuyer de ce lle d’un écrivain plus
éc la iré, plus célébré , & qui ait mieux mérité de
notre langue.
III. Je pourrois ajouter quelques obfèrvations
fur l ’ufage de Y , fur l ’emploi convenable des ma-
jufcules initiales, furcelui.de la diérèfe , du tiret,
&c. Mais je viens d’expofer les principaux articles ,
& je n’ai promis qu’une efquiüe : d’ailleurs je n’en
ai que trop dit pour faire naître des objections ,
•gue je ne dois ni dédaigner ni laiffer fans réponfe.
N É o
i ° . O n ne manquera pas d’abord d’ objeéter, qu’en
fupprimant le s confonnes ' doubles quand on n’ en
prononce qu’u n e , je facrifie le s droits de l ’É ty m
o lo g ie 8c ceux de la P ro fod ie : ceux de l ’É ty m
o lo g ie , en fupprimant des le ttre s qu i font dans
l e rad ica l é t r a n g e r , par e x em p le , en écrivant
a tè jier , éfigie , tranquile , gome, fu p lic e , quo iq
u ’ ils viennent des mots latins a tte jia r i, effigies,
tranq uillus, gummi , fupplic ium , o ù la confonne
eft redoublée ; le s droits de la Pro fod ie , pu ifqu e
l e redoublement de la confonne dans notre O r th o graph
e indique la. b rièveté de la v o y e l le p réc éd en te,
comme dans honneur, houlette, patte.
Pour ce qui concerne les droits de l ’É tym o lo g ie ,
je le demande eft-il raifonabie que nous allions
chercher dans une langue étrangère & morte , qui
eft ignorée des dix neuf vingtièmes de la nation,
les raifons de notre Orthographe, que toute la nation
doit favoir ? n’eft-cè pas. condanner gratuitement
, a l ’ignorance d’une chofe e flen cielie, tous
ceux qui n’auront pas fait les frais fuperflus d’étudier
le latin & le grec ? n’eft-çe pas mettre des entraves
ridicules à la perfection d’une langue r qui
après tout doit nous .être plus précieufe que toute
autre ? L ’Orthographe eft pour toute la nation ; la
connoifiance des étymologies n’eft que - pour un
très-petit nombre d’hommes 3 qui même n’en tirent
pas grand avantage , ni pour eux - mêmes ni
pour l ’utilité publique : faut-il donc facrifîer l ’avantage
de vingt millions d’ames aux vues pédan-
tefques de deux-cents perfonnages , qui n’en font ni
plus favants ni plus utiles? L’injuftice & le ridicule
de cette prétention ont été fentis par l ’Académie
délia Crufca pour la langue italienne , &
par l ’Académie royale de Madrid pour la langue
caftillanè : l ’Orthographe de ces deux langues
eft réduite • à peindre jufte la prononciation,
tans égard pouf des étymologies qui la défigure—
roient ; & les favants d’Italie & d’Efpagne ' n’en
feront pas moins bons, étymologiftes. Mais chez
nous même , d’où vient qu’i l n’a pas plu à l ’ufage
de redoubler la confonne dans quelques mots, où
toutefois la raifon lervile d’imitation a caufè de
l ’Étymologie militoit autant que dans des autres
mots où. 1 on a confacré ce redoublement ? C ’èft
que quelquefois la raifon l ’a emporté fur l ’aveug
le & imbécile routine ; & que l ’on a quelquefois
obéi au principe invariable , qui veut quef l ’écriture
foit l ’image fidèle de la parole.
C e qu’on a llè g u e en fa v eu r, des droits de la
P ro fod ie e f t- il mieux fondé ? I l f a u t , dit-on , redoubler
l a confonne pour marquer l a b r iè v e té de
l a v o y e l le précédente. C e prétendu .p r in c ip e eft
ab fo lument f a u x , de l ’aveu même de r u f a g e : ca r
i ° . nous trouvons la confonne redoublée après des
v o y e lle s lo n g u e s ; flamme, manne, abbeffe, que
je ƒ ïfft, groffe , que je pùffe, je pouffe , paîffe^ ,
& c : z°. on trouve de même des v o y e lle s brèves avant
une confonne fim p le ;' damier, llté, dévote, fortuné3 boule, jeunienftfeer,p rrtétrteari,t ed ,oeï-t &Ct
N É O
Ouand ce principe feroit admis fans exception
dans la pratique , peut-être faudroit - i l encore y
renoncer parce qu’ i l feroit au moins mutile : ne
fuffiroit - i l pas de marquer de l ’accent circonflexe
les voyelles longues j 6c d’écrire les brèves fans
accent? ce moyen fimple ne'différencie - t - i l pas
affez les mots tâ c h e ( b'efogne à faire ) & ta c h e
( fouillure ) m â t in ( efpèce de chien. ) 8c m a t in
) commencement du jour ) c h â f f e ( de reliques )
& c h a f f e ( des. animaux ) , b é t e ( animal ) 8c b e ie
( racine V , g î t e & i l a g i t e , le n ô t r e & n o t r e avis -,
&c. A ces deux v ice s , déjà confidérables, de lauf-
feté & d’inutilité , ajoutons que ce principe eft
encore oppofé à l ’effet naturel du redoublement de
la confonne, qui eft d’alonger la v o y e lle précédente.
V o y e x Q uantité.
i °. Je multiplie à l ’excès, d i r a - t - o n encore ,
les accents, qui vont hérifler notre écriture & notre
impreilion & y caufer mille embarras-: ne pourvoit
- on pas fe difpenfer du moins de les mettre
fur certain§ e , dont la place détermine la prononciation
? par exemple, Y e initial , qui forme feul
une fy lla b e , eft toujours ferme ; Ye de la pénultième
, quand la dernière fyllabe eft un e muet
articulé, eft toujours moyen; i l femble donc que
l ’on pourroit écrire ébauché , epine, le \ele , ils
poffedent, au lieu de • ébauche , ^ épine, le \èle ,
ils pofsèdent : c’étoit même jufqu’ a prefent le voeu
& l ’ufage de quelques grammairiens habiles. •
Je réponds que l ’écriture feroit inutile fans 1 art
de lir e , le premier de tous les arts dans 1 ordre
de l ’ enfeignement, parce qu’i l eft la c le f de tous
les autres ; qu’on ne fauroit donc trop le Amplifier,
le >géaéralifer , le fouftraire aux exceptions & aux
contradictions. Mais les fupprefiions d accents que
l ’on propofe i c i , répandront les tenebres fur 1 art
de lire. I l faudra faire entendre aux enfants & aux
étrangers, que Y e fans accent eft fermé ; quand
i l forme feul une fyllabe au commencement du
m o t , comme é c o l e , e t u d i e r qu i l eft encore
fermé a la dernière fyllabe , quand i l eft fuivi
d’une r muette ; comme a im e r ; p r em i e r ; qu il
eft moyen à l ’avant- dernière fyllabe , lorfque la
dernière a un e muet articulé , comme t k e f e ,
tr om p e té ; qu’il eft encore moyen , quand i l eft
fuivi d’une confonne dans la même fyllabe , comme
l e c l e u r , f e r m o n , e f p o i r ; qu’i l faut excepter de
cette quatrième règle Y e fuivi d’une s , qui eft
fermé dans le s monoffyllabes c e p , d e s , l e s , m e s ,
f e s , t e s , 6c muet à la fin des noms & des -ad-
jeftifs pluriels ,, comme h om m e s , d o c i l e s , ainfi
que Y e fuivi de n i à la fin des troifîèmes perfonnes
plurièies., ils v e u l e n t , ils p o u v a i e n t , ; qu enfin
partout ailleurs cet. e eft mu et, comme dans ye
r e lè v e r a i . Qu e de détails fur une feule letttre 1
. Eh ;! puifque nous le' pouvons , n’ épargnons pas
les lignes qui peuvent foùlager l ’attention, éclairer
rinteuigence , fauver les équivoques 8c les embarras
, prèvénir les difficultés & les méprifes ;
^tejions enfin le p a rt i, s’i l le fau t , de brouiller
I N É O 6 ; I
n o t r e é c r i tu r e à f o r c e d e l ig n e s a c c e ( f o i r e s , p lu s
t ô t q u e l e s t ê t e s à f o r c e d e p r in c ip e s c o n t r a d ic to i r e s
& in c o n fé q u e n t s . P o u r q u o i fe r o i t -o n a n o t r e O r t
h o g r a p h e u n c r im e de l a m u l t ip l i c a t io n d e s a c c e n t s ,
ta n d is q u ’ o n l o u e l ’ O r t h o g r a p h e g r è q u e d e c e q u e l l e
a , p a r l e m êm e m o y e n , r e p r e fe n t é a v e c ju f t e f l e
to u t e s l e s n u a n c e s d e l a p r o n o n c ia t io n ? J e m e n
r a p p o r t e fu r c e l a à l ’ é q u i t é d e s l e d e u r s , fo u s l e s
ie u x d e q u i je v a s m e t t r e u n p a f f a g e g r e c d e 1 i ü n -
chiridion d’ É p i d è t e , a v e c l a t r a d u d io n q u en a
d o n n é e l ’ a u t e u r a n o n ym e d e l a Lettre fu r les fou rd s
& muets ( p a g . 84— 36 ) , d an s l a q u e l l e je f u i v r a t
l ’ O r t h o g r a p h e q u e je v ie n s d e p r o p o f e r .
X) a.V%l (p<A0!T0Cp£Î». AS/V0 f airt , 7rpÔ>T«V
oTTolty i f i ro 7rpZ-y/J-a l'ira. ièj r»v yta.v% (Çvcrii x a r e t/ ta lî ,
ii èvioLTCLi ficar'\d<ra.r nlAcdMi u iui fivtei , « TraÀaitr l-u ;
Ut crexvWrVf f y a f '1*5 > P * ? * ’ ™ KttTetAw*1^
« C é s a ê n t s v e u l e n t a u f f i ê t r e p h i l o f o p h e s . H o m e ,
» a y e d’ a b o rd a p r is c e q u e c e f t q u e l a ç h o f e q u e
» tu v e u s ê t r e : a y e é tu d ié té s fo r c e s & l e f a r d e a u ,
» a y e v u f i tu p e u s l ’ a v o i r p o r t e : a ^ e c o n f id e r é
» té s b ra s & t é s c u i f f e s , a y e é p r o u v é té s r e i n s ,
» fi tu v e u s ê t r e q ù in q ù è r c io n o u lu t e u r » .
P a s u n f e u l d e s t r e n te q u a t r e m o t s g r e c s q u i n e
f o i t a c c e n tu é , & l e n om b r e d e s a c c e n t s fu r p a f l e
d e f e p t c e lu i d e s m o ts : d ans l a v e r f io n I r a n—
ç o i f e , q u i e f t à p e u p r è s l i t t é r a l e & c o n f é q u e m -
m è n t a l o n g é e , i l n ’ y a q u e v in g t t r o i s a c c e n t s ,
o u t r e n t e - c in q fi l ’ o n v e u t c o m p t e r ju fq u a u x p o in t s
d e s i , p o u r c in q u a n te c in q m o t s . Q u ’ o n ju g e m a in te
n a n t l a q u e l l e d e s d e u x O r t h o g r a p h e s e f t l a p lu s
h é r i t f é e , 8c q u e l c a s o n d o i t fa i r e d e 1 o b je c t io n q u i
p o r t e fu r c e t o b je t . /
2®. I l n’ en f a u t p a s fa i r e d a v a n t a g e d es d é c lam a t io n s
v a g u ë s c o n t r e t o u t e in n o v a t io n dans l ’ O r t h o g r a p h e :
o u e l l e s n e fo n t p o in t f o n d é e s ; ou e l l e s p o r t e n t
fu r q u e lq u e p r in c ip e fa u x ; & e n g é n é r a l , e l l e s f o n t
to u t e s fu g g é r é e s p a r l ’ am o u r p r o p r e , q u i f a i t q u e
p r e fq u e to u s l e s h o m m e s , a u m o in d r e c h a n g em e n t
c o n t r a i r e ' à l e u r a v e u g l e r o u t i n e ,
Clament periijje pudorem . .
Vel quia, ml rectum, nife quod placuit jib t, ducunt ;
Vel quia turpe putaht parère minoribus , & quoe
Imberbi didïcére fîtes perdenda fateri.
Hoiaç. IL Ep. j . 8 0 , 83, 8 4, 85.
« O n e f t n a tu r e ll em e n t a t t a c h é a u x f e n t im e n t s
» d o n t o n a é t é im b u d ans fa je u n e f fe , q u e lq u e
f a u x q u ’ i l s f o i e n t , d i t M . D a c i e r au fu je t d e c e s
» v e r s m êm e s ; 8c q u a n d o n v ie n t e n fu ite d an s u n
„ â g e a v à n c é , o n a h o n te d e l e d e d ife 8c 1 o n n e
» v e u t p a s e n a v o i r l e d ém e n t i : d e fo r c e q u o n
» p e u t a f f i l ie r q u e c e t t e m a u v a is e h o n t e e f t l ’ e n n em i
» l e p lu s d a n g e r e u x d e l a v é r i t é » . ■
D e l à e ft v e n u e c e t t e c e n fu r c a m e r e , in ju fte , &
f a u f f e d e M . P a l i f f o t ( Mémoire? littéraires,MÙdo.
N n n n %