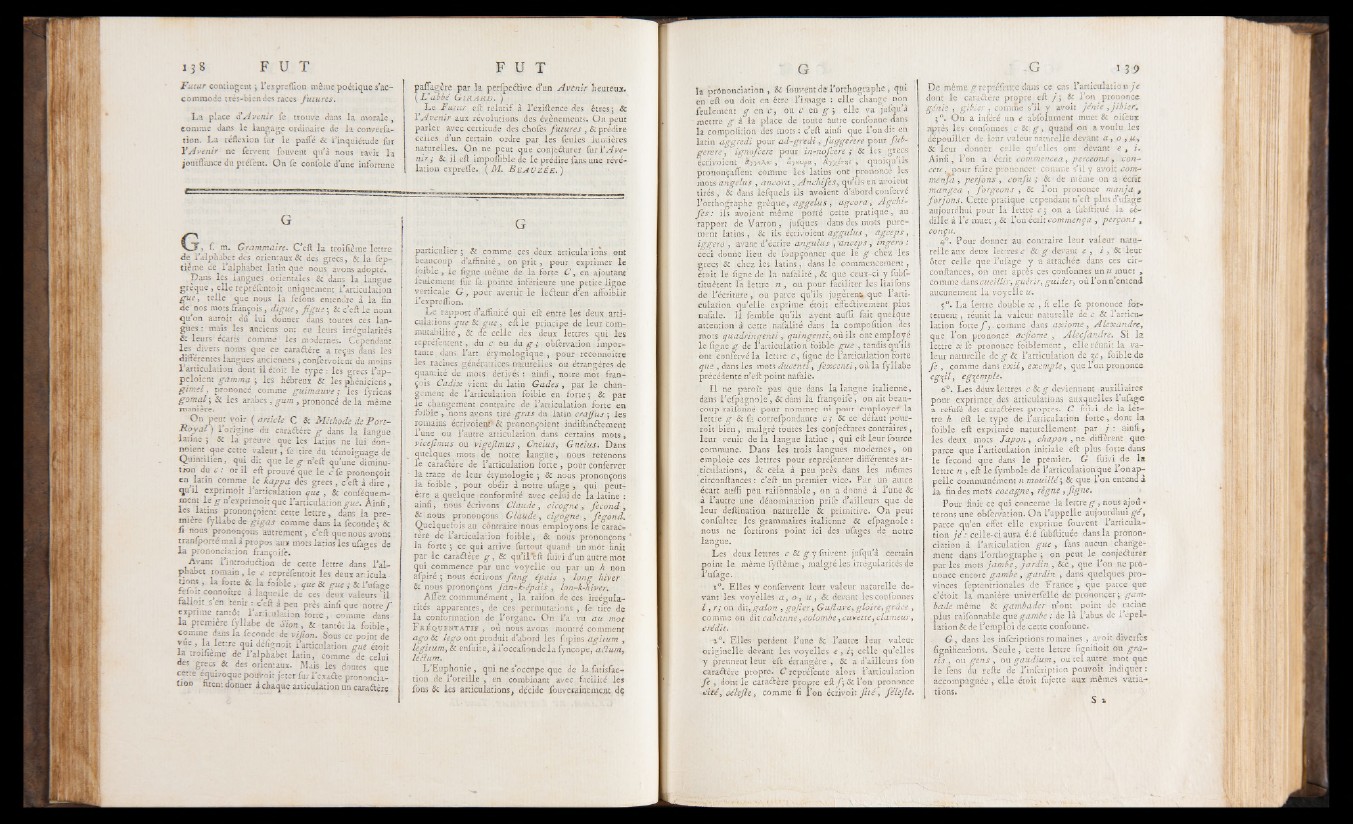
138 FF UU TT F U T
F u tu r contingent 5 l’ exprelïîon même poétique s’accommode
très-bien des races fu tu r e s .
paffagère par la perlpe&ive d’un A v en ir heureux.
( L ’ abbé G i r a r d . ) ■
L e F u tu r eft relatif à l ’exiftence des êtres ; &
L a place ci A v en ir fe trouve dans la morale }
comme dans le langage ordinaire de la c o n v en tion.
L a réflexion fur le paffé & l ’inquiétude fur
V A venir ne fervent fouvent qu’à nous ravir la
jouïflance du préfent. G n fe conîole d’une infortune
V A venir aux révolutions des évènements. G n peut
parler avec certitude des chofes fu tu r es , & prédire
celles d’un certain ordre par les feules lumières
naturelles. On ne peut que conjecturer fur VA ve -
nir j & i l eft impoffible de le prédire fans une révélation
expreffe. ( M . B e a ü z é e . )
G G
C 3 * j f. m. Grammaire. C ’eft la troifième lettre
de l ’alphabet des orientaux & des grecs, & la fep-
tiéme ce l ’alphabet latin que nous avons adopté.
Dans les langues . o rientales & dans la langue
g rèq u e , e lle reprëfentoit uniquement l ’articulation
g u e , te lle que nous la fefons entendre à la fin
de nos mors François, d ig u e , fig u e ; & c’eft le nom
qu on auroit dû lui donner dans toutes ces langues
: mais les anciens ont eu leurs irrégularités
& leurs écarts comme les modernes. Cependant
le s divers noms que ce caraCtère a reçus dans les
differentes langues anciennes , confervoieùc du moins
l ’articulation dont i i étoit le type : les grecs l ’ap-
peloient gamma j les tébreux & les phéniciens,
g im e l , prononcé comme guimauve ; les fyriens
g om a l, 8c les arabes , gum , prononcé de la même
manière.
O n peut voir ( article C & Méthode de P o r t -
R o y a l ) l ’origine du caraCtère g dans la langue
latine ÿ & la preuve que les latins ne lui don-
noient que cette v a leu r , fe tire du témoignage de
Qu intiiien, qui dit que le g n’eft qu’une diminu-
tion du c : or i l eft prouvé que le c fe prononçoit
en ^ latin comme le kappa des g re c s , c’eft à dire ,
<ju i l exprimoic 1 articulation que , 8c conféquem-
ment le g n exprimoit que l ’articulation gue. A in f i,
les latins prononçoient cette le tt re , dans la première
fyllabe de g ig a s comme dans la fécondé; &
il nous prononçons autrement, c’ eft que nous avons
tranlponèma l à propos aux mots latins les ufages de
l a prononciation françoife.
Avant l ’introduCtion de cette lettre dans l ’alphabet
romain, le c repréfentoit les deux articula -
tions , la forte & la foible , que & gue ; & l ’ufage
feloit connoître a laquelle de ces deux valeurs i l
ralioit s en tenir : c’eft à peu près ainfi que notre f
exprime tantôt 1 articulation forte , comme dans
la première fy llabe de S io n , & tantôt la fo ib le ,
comme dans la fécondé de vifion. Sous ce point de
vue , la lettre qui défignoit i ’articulation gu e étoit
a iroifieme de 1 alphabet latin, comme de celui
des grecs & des orientaux. Mais les doutes que
cette équivoque poifvoit je te r fur l ’exacte prononciation
firent donner à chaque articulation un cara&ère
particulier ; & comme ces deux articula-ions ont
beaucoup d’affinité, on p r i t , pour exprimer le
fo ib le , le figne même de la forte C , en ajoutant
feulement fur fa pointe inférieure une petite lign e
verticale G , pour avertir le leéieur d’en affoiblir
l ’expreffion.
L e rapport d’affinité qui eft entre les deux articulations
que 8c g u e , eft le principe de leur com-
mutabilicé, & de ce lle des deux lettres qui les
reprefentent , du c ou du g ,* obfervation importante
dans l ’art étymologique y pour reconnoître
les racines génératrices naturelles ou étrangères de
quantité de mots dérivés : ainfi , noire mot fran-
çois Ca d ix vient du latin Gades , par le changement
de l ’articulation foible en forte ; & par
le changement contraire de l ’articulation forte en
foible , .nous ayons tiré gra s du latin crafius ; les
romains écrivoient & prononçoient indiftinétemenc
1 une ou l ’autre articulation dans certains mots,
vicefimus oii v igefimus, Cneius, Gne ius. Dans
_ quelques mots de notre' lan gu e , nous retenons
le caraétère de i ’articulation forte , pour conferver
" la trace de leur étymologie ; & lions prononçons
la foible , pour obéir à notre ufage , qui peut-
être a quelque conformité avec celui de la latine :
ainfi, nous écrivons Claude ci cogne., f é c o n d ,
& nous prononçons GlaUde, cigogne , fegond .
Quelquefois au contraire nous employons le caractère
de l ’articulation foible,, & nous prononçons
la forte ; ce qui arrive furtout quand un mot finit
par le caraélère g , & qu’il^ f t fuivi d’un autre mot
qui commence par une vo y e lle ou par un h non
afpiré ; nous écrivons fa n g épais , long hiver
8c nous prononçons fanrk-épais , lon-k-hiver.
A lle z communément, la raifon de ces irrégularités
apparentes, de ces permutations, fe tire de
la conformation de l ’organe. G n l ’a vu au mot
F réquentatif , où nous avons montré comment
ago 8c lego ont produit d’abord les fupins agitum ,
legitum, 8c enfuite, à l ’occafiondela fyncope, aclum,
lecîum.
L ’Euphonie , qui ne s’occupe que de la fatisfac-
tion de l ’oreille , en combinant avec facilité les
fions 8c les articulations, décide fiouvesainemeot de
G G
la prononciation , & fouvent d e 'l’orthographe, qui
en eft ou doit en être l ’image : elle change non
feulement g e n r , o u t en g ; elle va jufqu’à
mettre g à la place de toute autre confonne dans
la compofidon des mots: c e ft ainfi que l ’on dit en
latin aggredi pour a d -g r ed ifu g g e r e r e pour fub -
gerere, ignofcere pour in-nofcere ,• & les grecs
écrivoient HyytKo? , uyKvpct, Kyxjo-Yis , quoiqu ils
prononçaient comme les latins ont prononcé les
mots angélus , ancora , A n ch ife s , qu’ils en avoient
tirés , & dans lefquels ils avoient d’abord confervé
l ’orthographe g rèqu e, a g g e lu s , agcora, A g c h i-
f e s : ils avoient même porté cette pratique, au .
rapport de Varron, jufques dans des mots purement
latins , & iis écrivoient aggulüs , a g c ep s , .
iggero , avant d’écrire angulus , "anceps, ingero •' ;
ceci donne lieu de foupçonner que le g chez les
grecs & chez les latins , dans le commencement ,
etoit le ligne de la nafalité , & que ceux-ci y lu b f -
tituèrent la lettre n , ou pour faciliter les liaifons
de l ’écriture , ou parce qu’ils ju g è r e n t , q u e l ’articulation
qu’e lle exprime étoit e f f e c t iv em e n t plus
n a t a le . I l f e rn b le qu’ils ayent a u f ï i fait quelque
attention à cette natalité dans la compofidon des
mots quadringenti , quingenti, où ils ont employé
le ligne g de l ’articulation foible gue , tandis qu’ils
ont confervé la lettre c , ligne de l ’ a r t ic u la t io n forte :
que , dans les mots d ucen ti, f e x c e n t i , où la fyllabe
précédente n’eft point natale.
I l ne paroît pas -que dans la langue italienne,
dans l ’e fpagn o le, & dans la françoife, on ait beaucoup
raifonné pour nommer ni pour employer la
lettre g & fa correlpondante c ; 8c ce défaut po'ur-
roit bien, malgré toutes les conjectures contraires ,
leur venir de la langue latine , qui eft leur fource
commune. Dans les trois langues modernes, on
emploie ces lettres pour repréfenter différentes articulations
, & cela à peu près dans les mêmes
circonftances : c’eft un premier vice. Par un autre
-écart auffi peu raifonnable, on a donné à l ’une &
a l ’autre une dénomination prife d’ailleurs que de
leur deftination naturelle & primitive. O n peut
confulter les grammaires italienne & elpagnole :
nous ne fôxtirons point ici des ufages de notre
langue.
Les deux lettres c 8c g y fuivent jufqu’à . certain
point le même fyftême , malgré les irrégularités de
i ’ ufage.
i ° . Elles y confervent leur valeur naturelle devant
les voyelles <2, 0 , u , & devant lesconfonnes
l , r ; on dit, ga lon , g o fier , Guflave , gloire, grâce ,
comme on dit cabanne, colombe, cuvette, clameur,
crédit.
i ° . Elles perdent l ’un.e & l ’autre leur valeur
originelle devant les voyelles -e, i ; ce lle qu’elles
y prennent leur eft étrangère , & a d’ailleurs fon
caraCtère propre. C repréfente alors l ’articulation
f e , dont le caraCtère propre eft ƒ ; & l ’on prononce
c ité , oétefie, comme fi l ’on écrivoit f i lé , fé le jle .
* 39
D e même g repréfeme dans ce cas l ’articulation j e
dont le caraCtère propre eft j ; 8c l ’on prononce
génie , gibier , comme s’i l y avoir jén ie ,jib ie r .
50. On a inféré un e abfolument muet & oifeux
après les conformes c 8c, g , quand on a voulu les
dépouiller de leur valeur naturelle devant <2, 0 , u:,
& leur donner ce lle qu’elles ont devant e , i.
A in f i, l ’on a écrit commencea, perceons , con-
c e u , pour faire prononcer comme s’i l y avoit commenta
, perfons , confit ; 8c de même on a écrit
mangea , fo rgeon s , 8c l ’on prononce manja 9
fo r jo n s . Cette pratique cependant n’eft plus d’ufage
aujourdlîui pour la lettre c ; on a fubftitué la cédille
à Ve mu et, 8c l ’on écrit commença , perçons ,
conçu.
4°. Pour donner au. contraire leur valeur naturelle
aux deux lettres c & ^ d ev an t e , i , & leur
ôter ce lle que i ’ufage y a attachée dans ces circonftances,
on met après ces confonnes un u muet >
comme dan s cueillir, guérir, guider, où l ’on n’ entend
aucunement la v o y e lle u.
' 50. L a lettre double x , fi elle fe prononce fortement
, réunit la valeur naturelle de c 8c l ’articulation
forte f i , . comme dans axiome , A le xan d r e ,
que l ’on prononce aefiome , Alecfiandre. Si la
lettre x Te prononce foiblement, elle réunit la valeur
naturelle de g 8c l ’articulation de \e, foible de
fie , comme dans e x i l , exemple, que l ’on prononce
egfiil, eg^e triple.
6°. Les deux lettres c 8c g deviennent auxiliaires
pour exprimer, des articulations auxquelles i ’ufage
a refufé des caractères propres. C füivi de la lettre
h eft le type de l ’articulation for te , dont la
foible eft exprimée naturellement par / : ainfi 9
les deux mots J a p o n , chapon , ne diffèrent que
parce que l ’articulation initiale eft plus forte dans
le fécond que dans le premier. G fuivi de la
lettre n , eft le fymbole de l ’articuianon que l ’on appelle
communément n mouillé\ 8c que 1 on entend a
la fin des mots cocagne, règne , figne.
Pour finir ce qui concerne la lettre g , nous ajou terons
une obferyadon. O n l’appelle aujoürdhui g é t
parce qu’en effet e lle exprime fouvent l ’articulation
j e : ce lle-ci aura été fubftituée dans la prononciation
à l ’articulation gue , fans aucun changement
dans l ’orthographe ; on peut le conjecturer
par les mots jam b e , ja r d in , &c , que l ’on ne prononce
encore gambe , ■ gardïn , dans quelques provinces
feptentrionales de F rance , que parce que
c’ étoit la manière univerfelle de prononcer ; gambade
même 8c gambader n’ont point de racine
plus raifonnable que gambe : de là T abus de 1 épellation
& de l ’emploi ae cette confonne.
G , dans les inferiptions romaines , avoit diverfes
lignifications. Seule , cette lettre fignifîoit ou grat
is , ou g en s , ou ga ud ium , ou tel autre mot que
le fens du refte de l ’infcripticn pouvoit indiquer :
accompagnée , e lle étoit fujette aux mêmes variations.
S 1