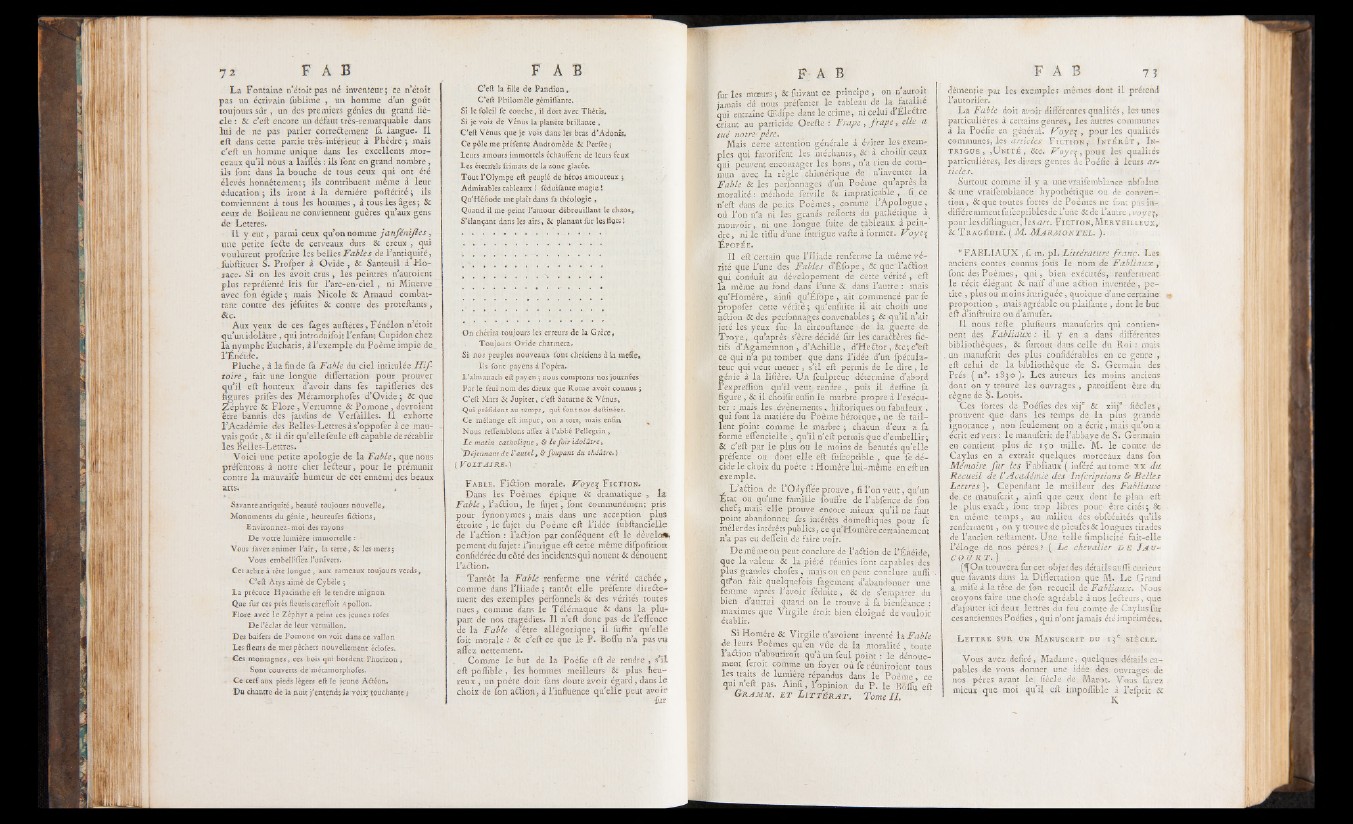
L a Fontaine n étoitpas né inventeur; ce n’étoit
pas un écrivain fublime , un homme d’un goût
toujours sûr , un des premiers génies du grand lîê-
c le : & c’eft encore un défaut tres-remarquable dans
lu i de ne pas parler correctement fa langue. I l
eft dans cette partie très-inférieur à Phèdre ; mais
c’eft un homme unique dans les excellents morceaux
q u i l nous a laiffés : ils font en grand nombre,
ils font dans la bouche de tous ceux qui ont été
élevés honnêtement; ils contribuent même a leur
éducation ; ils iront à la dernière poftérité ; ils
conviennent à tous les hommes, à tous les âges ; &
ceux de Boileau ne conviennent guères qu’aux gens
de Lettres.
I l y eu t , parmi ceux quon nomme ja n fé n ijle s ,
une petite feéte de cerveaux durs & creux , qui
voulurent profcrire les belles F a b le s de l ’antiquité,
_ fubflituer S. Profper à O v id e , & Santeuil à H o race.
Si on les avoit crus , les peintres n’auroient
plus repréfenté Iris fur l ’arc-en-ciel , ni Minerve
avec fon égide ; mais N ico le & Arnaud combattant
contre des jéfuites & contre des proteftants,
&c.A
u x yeux de ces fages auftères, Fénélon n’étoit
qu’ un idolâtre , qui introduifoit l ’enfant Cupidon chez
la nymphe Eucharis, à l ’exemple du Poème impie de_
l ’Enéide.
Plu ch e , à la fin de fa Fable du ciel intitulée H i s toire
, fait une longue differtation pour prouver
qu’i l eft honteux d’avoir dans fes tapifferies des
figures prifes des Métamorphofes d’Ovide ; & que
Zéphyre & F lo r e , Vertumne & Pomone, devroient
être bannis des jardins de Verfailles. I l exhorte
l ’Académie des Belles-Lettres à s’oppofer à ce mauvais
g o û t , & i l dit qu’elle feule eft capable de rétablir
le s Belles-Lettres.
V o ic i une petite apologie de la F a b le , que nous
préfentons à notre cher leéteur, pour le prémunir
contre la mauvaife humeur de cet ennemi des beaux
arts. t
Savante antiquité, beauté toujours nouvelle,
Monuments du génie, heureufes fi&ions,
Environnez-moi des rayons
De votre lumière immortelle : '
Vous favez animer l’air , la terre, & les mers;
Vous embèlliffez l’ univers.
Cet arbre à tête longue, aux rameaux toujours verds,
C’eût Atys aimé de Cÿbèle ;
La précoce Hyacinthe eft le tendre mignon
Que fur ces prés fleuris carefloit Apollon. -
Flore avec le Zéphyr a peint ces jeunes-rofes
De l’éclat de leur vermillon.
Des baifers de Pomone on voit dans ce vallon
Les fleurs de mes pêchers nouvellement éclofes.
' Ces montagnes, ces bois qui-bordent l’horizon,
Sont couverts de métamorphofes.
Ce cerf aux pieds légers eft le jeune Aftéon.
Du chantre de la nuit j’entends laYoix touchante ;
C’ eft la fille de Pandion,
C’eft Philomèle gémiflante.
Si le foleil fe couche, il dort avec Thétîs.
Si je vois de Vénus la planète brillance ,
C ’eft Vénus que je vois dans les bras d’Adonis,
Ce pôle me préfente Andromède Se Perfée-j
Leurs amours immortels échauffent de leurs feux
Les éternels fri mats de la zone glacée.
Tout l’Olympe eft peuplé de héros amoureux ;
Admirables tableaux ! féduifante magie 1
Qu’Héfiode me plaît dans fa théologie ,
Quand il me peint l’amour débrouillant le chaos,
S’élançant dans les airs , Se planant fur les flots l
On chérira toujours les erreurs de la Grèce,
Toujours Ovide charmera.
Si nos peuples nouveaux font chrétiens à la mefîe,.
Ils font payens à l’opéra.
L ’ almanach eft payen ; nous comptons nos journées
Par le feul nom des dieux que Rome avoir connus ;
C ’ eft Mars Se Jupiter, c'eût Saturne 8c Vénus,
Qui préfîdent au temps, qui font nos deftinées.
Ce mélange eft impur, on a tort; mais enfin %
Nous reffemblons affez à l’abbé Pellegrin ,
Le matin catholique , & le foir idolâtre, .
'Déjeunant de Vautel, & foupant du théâtre.)
( Vo ltaire.),
F able. Fiction morale. Hoye^ Fiction.
Dans les Poèmes épique 8c dramatique , la
F a b le , l’ aétion, le fujet font communément pris
pour fynonymes ; mais dans une acception plus
étroite , le fujet du Poème eft l ’idée fubflancielle
de l ’aétion : l ’aétion par conféquent eft le dèvelo»»
pement du fujet: l ’intrigue eft cette même difpofition
confidérée du côté des incidents qui nouent & dénouent
l ’action.
Tantôt la Fab le renferme une vérité cachée ,
comme dans l ’Iliade ; tantôt elle préfente directement
des exemples pérfonnels & des vérités toutes
nues, comme dans le Télémaque & dans la plupart
de nos tragédies. I l n’eft donc pas de l ’effence
de la Fable detre allégorique; i l fuffit qu’elle
foit morale : & c’eft ce que le P . Boffu n’a pas vu
affez nettement.
Comme le but de la Poéfie eft de rendre , s’i l
eft poffible> les hommes meilleurs & plus heureux
, un poète doit fans doute avoir égard, dans le
choix de fon aétion, a l ’influence qu’elle peut avoir
fur les moeurs ; & fuivanî ce principe , on nauroit
jamais dû nous préfenter le tableau de la fatalité
qui entraîne OEdipe dans le crime, ni celui d Éleétre
criant au parricide O refie : F râpe , f r a p e , elle a
tu é notre-• père.
Mais cette attention générale â éviter les exemples
qui favorifent les méchants, & à choifir ceux
qui peuvent encourager les bons, n a rien de commun
avec la règle chimérique de n’inventer la
Fable & les personnages d’un Poème qu’apres la
moralité: méthode, ferviie 8e impraticable, fi ce
n’eft dans de petits Poèmes, comme 1 A p o lo g u e ,
où l ’on n’ a ni les grands refïorts du pathétique a
mouvoir’ ,, ni une longue fuite de tableaux a peindre,
ni le tiffu d’une intrigue vafte à former. V oy e \
É p o p é e ,
I l eft certain que l ’ Iliade renferme la même vérité
que l ’une des Fables d’É fo p e , 8c que* l ’aétion
qui conduit au dèvëlopement de cette vérité , eft
la même au fond dans l ’une & dans l ’autre : mais.
qu’Homère, ainfi qu’ iifope , ait commencé par fe
propofer cette vérité; quenfuite i l ait choifi une
aétion & des perfonnages convenables ; & qu’i l n’aic
jeté les yeux fur la circonftance de la guerre de.
T ro y e , qu’après s’être décidé fur les caraétères fictifs
d’Agamemnon , d’A ch ille , d’Heétor , &c; c’fefl
ce qui n a pu tomber que dans l ’idée d’un fpécula-
teur qui veut mener, s’i l eft permis de le dire , le
finie à la lifîère. Un fculpteur détermine d’abord
expreflion qu’i l veut>‘ rendre , puis i l deffine fa '
figure , & i l cnoific enfin le marbre propre à l ’exécuter
: mais, les .évènements , hiftoriques ou fabuleux ,
qui font la matière du Poème héroïque, ne fe ta illent
point comme le marbre ; chacun d’eux a fa
forme effencielle , qu’i l n’eft permis que d’embellir ;
8c c’eft par le plus ou le moins de beautés qu’elle
| préfente ou dont elle eft fufceptible , que fe décide
le choix du poète. : Homère lui-même en eft un
î exemple.
L aétion de l ’Odyffée p rouve, fi l ’on v eu t, qu’ un
État ou qu’une famille fouffre de l ’abfence de fon
chef; mais elle prouve encore mieux qu’i l ne faut
point abandonner fes intérêts domeftiqucs pour fe
meler des interets publics, ce qu’Homère certainement
n’a pas eu deffein de faire voir.
’ D e même on peut conclure de l ’aétion de l ’Énéide,
que la valeur & la piété réunies font capables des
plus" grandes chofes, maison en peut conclure aufii
qtl*oii fait quélquefois fagement d’abandonner une
• femme après l ’ avoir féduite., & de s’emparer du
bien d’autrui" quand on le trouve à fa bienfeance :
maximes que Virgile étoic bien éloigné de vouloir
établir. , 6
Si Homère & V irg ile n’avoient inventé la Fable
de leurs Poèmes qu’en vûe de la moralité , toute
l ’aétion n’aboutiroit qu’à un feul point : le dénouement
feroit comme un foyer où fe réuniroient tous
; le s traits de lumière répandus dans le P o èm e , ce
qui n’eft pas. A in fi, l'opinion du P . le Boffu eft
Gr a m m . e t L i t t é r a t , Tome U.
démentie par les exemples mêmes dont i l prétend
l ’autorifer.
L a Fable doit avoir différentes qualités, les-unes
particulières à certains genres, les autres communes
à la Poéfie en général. F o y e \ , pour les qualités
communes, les articles F ic t io n , In t é r ê t , Int
r i g u e , ,U n it é , &c. Foye-^, pour les qualités
particulières, les divers genres de Poéfie à leurs articles.
Surtout comme i l y a une vraifemblance abfolue
& une vraifemblance hypothétique ou de convention
, & que toutes fortes de Poèmes ne font pas indifféremment
fufceptiblesdei’une & de l ’autre, voyeç,
pour les diftinguer, les art. Fiction, Merveilleux,
& T ragédie. (M . M a r m o n t e l . ).
* F A B L IA U X , f. m, p l. Littérature fr a iiç . Les
anciens contes . connus fous le nom de F a b lia u x ,
font des Poèmes, q u i ,. bien exécutés, renferment,
le récit élégant & naïf d’une aétion inventée, petite
, plus pu moins intriguée, quoique d’une certaine
proportion , mais agréable ou plailante , dont le but
eft d’inftruire ou d’amufer.
I l nous relie plufieurs manuferits qui contiennent
des. F a b lia u x : i l y . en a dans différentes1
bibliothèques, & furtout dans ce lle du Roi : mais
un manuferit des plus considérables .en ce genre ,
eft celui de la bibliothèque de S. Germain des
Prés ( n°. 1830 ). Les auteurs les moins anciens
dont on y trouve les ouvrages , paroiffent être dix
règne de S. Louis.
Ces fortes de Poéfîes des xije & xiije 1 fièc ies,
prouvent que dans les temps de la plus grande
ignorance , non feulement on a éc rit, mais qu’on a
écrit dive r s: le manuferit. de l ’abbaye de S. Germain
en contient plus de 150 mille. M. le comte de
Caylus en a extrait quelques morceaux dans fon
Mémoire fu r les Fabliaux ( inféré au tome x x dit
R e cu e il de VAcadémie des Infcriptions & B e lle s
Lettres ). Cependant le meilleur des F a b lia u x
de.ee manuferit, ainfi que ceux dont le plan eft
le p luse xa ét, font trop libres pour être cités; &
en même temps, au milieu des obfcénités qu’ils
renferment, on y trouve de pieufes & longues tirades
de l ’ancien teftament. Une. te lle fimplicité fait-elle
l ’éloge de nos pères.? ( L e chevalier D E J a u -
c o u r t . ) .
(*fOn trouvera fur cet objet'des détails aufli curieux
que lavants dans la Differtation que M. L e Grand
a mife à la tête de fon recueil de F a b lia u x . Nous
croyons faire une çhofe agréable à nos leéteurs, que
d’ajouter ici deux lettres du feu comte de Caylus fur
ces anciennes Poéfies, qui n’ont jamais été imprimées.
L ettre s u r un Manuscrit du 13e siècle.
Vous avez defiré, Madame, quelques détails capables
de vous donner une idée des? ouvrages de
nos pères avant le, fièçle de Maroc. Vous favez
mieux que moi qu’i l eft impoflible à l ’efprit 8c
K