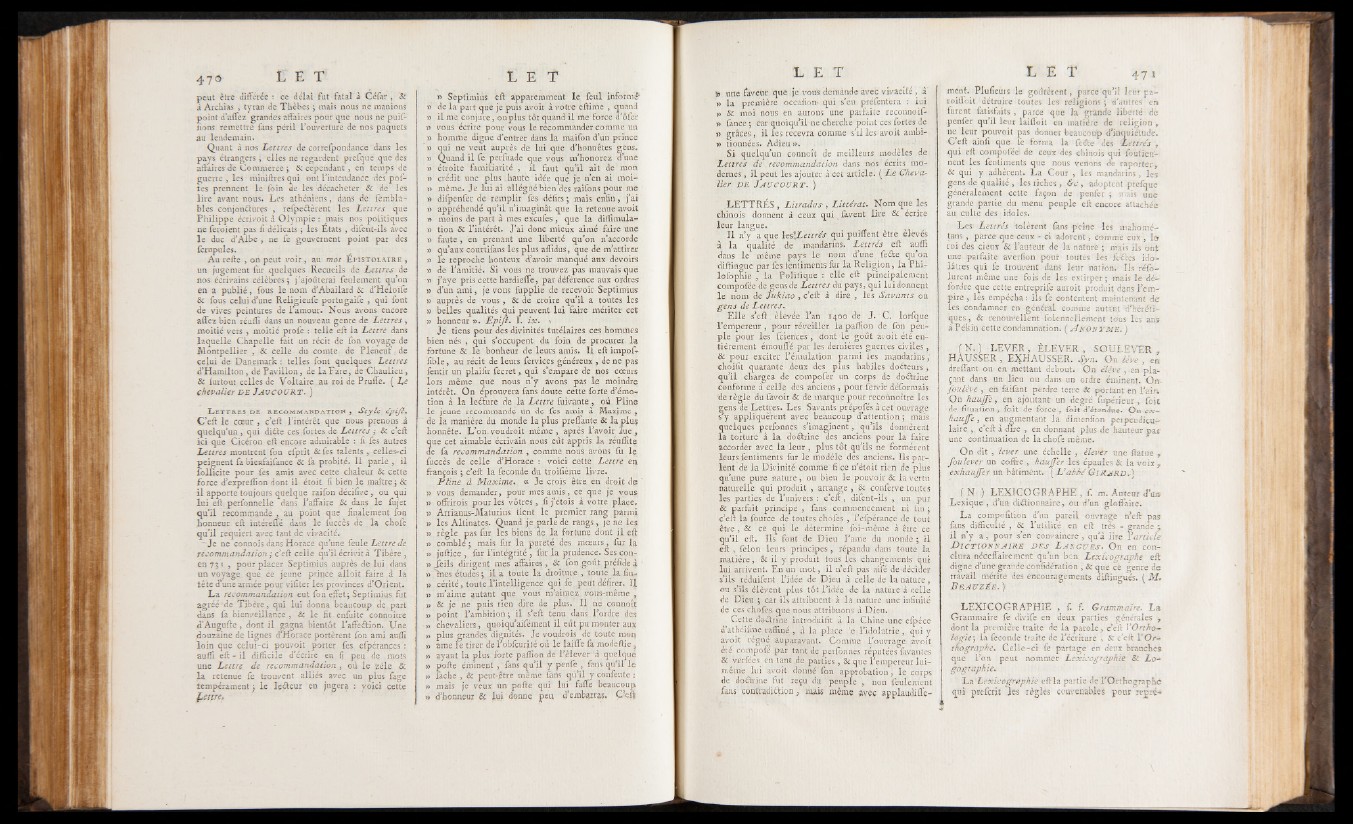
peut être différée : ce délai fut fatal à Céfkr , &
à Archias , tyran de Thèbes ; mais nous ne manions
point d’affez grandes affaires pour que nous ne puif-
iîons remettre fans péril l ’ouverture de nos paquets
au lendemain.
Quant à nos Le ttres de correfpondance dans les
pays étrangers , elles ne regardent prefque que des
affaires de Commerce ; & cependant, en temps de
guerre , les miniftres qui ont l ’intendance des pof-
tes prennent le foin de les décacheter & de les
lire avant nous. Les athéniens, dans de fembla-
bles conjonctures , refpedtèrent les Lettres que
P h ilip pe écrivoit à Olympie : mais nos politiques
ne feroient pas h délicats ; les États , difent-ils avec
l e duc d’A ib e , ne fe gouvernent point par des
lcrupules.
A u refte , on peut voir , au mot Épistolaire ,
un jugement fur quelques Recueils de Lettres de
nos écrivains célèbres j j'ajouterai feulement qu on
en a p u b lié , fous le nom d'Abailard & d’Héioïfe
& fous celui d’une Religieufe portugaife , qui font
de vives peintures de l ’amour. Nous avons encore
affez bien réufli dans un nouveau genre de L e ttr e s ,
moitié vers , moitié profe : telle eft la Lettre dans
laque lle Chapelle fait un récit de fon voyage de
Montpellier , & ce lle du comte de Pléneuf de
celui de Danemark : telles font quelques Lettres
d’Hamilton, dé P a v illon , de la F a r e , de Chauiieu,
& furtout celles de Voltaire au roi de Pruffe. ( L e
çKevalier DE JAUCOURT. )
L ettres de recommandation , S ty le épijl.
C ’eft le coeur , c’eft l ’intérêt que nous prenons _à
quelqu’un , qui dicte ces fortes de L e ttr e s ,• & c’eft
ic i que Cicéron eft encore admirable : fi fes autres
Lettres montrent fon efprit &fes talents , celles-ci
peignent fabienfaifance & fa probité* I l p a r le , i l
lo llic ite pour -fes amis avec cette chaleur' & cette
force d’expreffion dont i l étoit fi bien le maître ; &
i l apporte toujours quelque rai fon décifive, ou qui
lu i eft perfonnelle dans l ’affaire .& dans le fujet
qu’i l recommande , au point que finalement fon
honneur eft intéreffé dans le fuccès de la chofe
qu’i l requiert avec tant de vivacité.
~Je ne connois dans Horace qu’une feule Lettre de
recommandation ; c’eft ce lle qu’i l écrivit à T ib è re ,
en 73 i , pour placer Septimius auprès de lui dans
un voyage que ce jeune prince a ilo it faire à la
tête d’une armée pour vifiter les provinces d’Orient.
L a recommandation eut fon effet3 Septimius fut
agréé de T ib è re , qui lui donna beaucoup de part
dans fà bienveillance , & le fit- enfuite connoître
d’À u gu fte, dont i l gagna bientôt l ’affefition. Une
douzaine de lignes d Horace portèrent fon ami auffi
lo in que ce lu i-ci pouvoit porter fes efpérançes :
auffi eft - i l difficile d’écrire en fi peu de mots
une Lettre^ de recommandation, où le zè le &
la retenue fe trouvent alliés avec un plus fage
tempérament; le lecteur en jugera : voici cette
Retire.
» Septimius eft apparemment le feul informé"
» de la part que je puis avoir d votre eftime , quand
» i l me conjure, ou plus tôt quand i l me force d’ôfer
» vous écrire pour vous le recommander comme un
» homme digne d’entrer dans la maifon d’un prince
» qui ne veut auprès de lui que d’honnêtes gens.
» Quand i l fe perfuade que vous m’honorez a’une
» étroite familiarité , i l faut qu’i l ait de mon
» crédit une plus haute idée que je n’en ai moi-
» même. Je lu i ai allégué bien des raifons pour me
» difpenfer de remplir fe$ défirs 3 mais enfin, j’ai
» appréhendé qu’i l n’imagihât que la retenue avoit
» moins de part à mes exeufes, que la diffimula-
» tion & l ’intérêt. J’ai donc mieux aimé faire une
» fau te , en prenant une liberté qu’on n’accorde
» qu’aux courtifans les plus affidus, que de m’attirer
» le reproche honteux d’avoir manqué aux devoirs
» de l ’amitié. Si vous ne trouvez pas mauvais que
» j’aye pris cette hardieffe, par déférence aux ordres
» d’un am i, je vous fupplie de recevoir Septimius
» auprès de vous , & de croire qu’ i l a toutes les
» belles qualités qui peuvent lui faire mériter cet
» honneur ». E p i j i . I. i x . ,
Je tiens pour des divinités tutélaires ces hommes
bien nés , qui s’occupent du foin de procurer- la
fortune & le bonheur de leurs amis. I l eft impofo
fib le, au récit de leurs fervices généreux ? de ne pas
fentir un plaifir fecre t, qui s’empare de nos coeurs
lors même que nous n’y“ avons pas le moindre
intérêt. O n éprouvera fans doute cette forte d’émo-?
tion à la leCture de la Lettre fuivante, où Pline
le jeune recommande un de fes amis à Maxime ,
de la manière du monde la plus preffante & la plus
honnête. L ’on- veudroit même , après l ’avoir lue\,
que cet aimable écrivain nous eût appris la réuffite
de fa recommandation , comme nous avons fu le
fuccès de ce lle d’Horace : voici cette Lettre en
franeois 3 c’ eft la féconde du troifième livre.
P lin e à M axime. a Je crois être, en droit de
». vous demander, pour mes amis, ce que je vous
» offrirois pour les vôtres, fi j’ étois à votre place,
» Arrianus-Maturius tient le premier rang parmi.
» les Altinates. Quand je parle de rangs, je ne les
» règ le pas fur les biens de la fortune dont i l eft
» comble 3 mais fur la pureté des moeurs, fur la
» juftice, fur l ’intégrité , fur la prudence. Ses con-
» JTeils dirigent mes affaires , & fon goût préfide à
»^mes études3 i l a.toute la droiture , .toute la.fin-
» cérité, toute l ’intelligence qui fe peut défirer. I l
» m’aime autant que vous m’aimeZ: vous-même ,
» & je ne puis rien dire de plus. I l ne connôît
» point l ’ambition 3 i l s’eft tenu dans, J’ordre des
• » chevaliers , quoiqu’aifément i l eût pu'monter aux
» plus grandes dignités. Je voudrois de toute mot}
» ame le tirer de l ’oblcurjté où le laiffe fa modeftie,
» ayant la plus, forte paffion de l ’èle v e r 'à quelque
» pofte éminent , fans qu’ i l y penfe , fans qu’i l le
» fâche , & peut-être même farts qu’i l y confente ;
» mais je veux un pofte qui lui faffe beaucoup
» d’honneur & Jhai donne peu d’embarras. Ç>e$
>5 une faveur que i je vous demande avec viv a cité, a
» la première occafiom qui s’éu préfentera : lui
» 8c moi nous en aurons une parfaite reconnoif-
» lance 3 car quoiqu’i l ne cherche point ces fortes’de
» grâces , i l fes recevra comme s’i l les avoit ambi-
» données. Adieu».
S i quelqu’un conncît de meilleurs modèles de
Le ttres de recommandation dans nos écrits modernes
, i l peut les ajouter à cet article. ( L e Chevalier
D E J A U CO U R T , )
LE T T R É S , L itr a d a s , Litté rdt. Nom que les
chinois donnent â ceux qui lavent lire & écrire
leur langue, ‘ '
I l n’y a que lesIfe ttr é s qui puifîent être élevés
à la qualité de mandarins. Le ttrés eft auffi
dans le même pays le nom d’une, .fede qu’on
diftiügue par fes lentiments fur la R e lig io n , la Phi-
lofophie , la Politique : elle èft principalement
compofée de gens de Lettres du pays, qui lui donnent
le nom de Jiikiao , c’eft à dire , les Savants où
gen s de Lettres,
E lle s’eft élevée l ’an 1400 'de J. C. lorfque
l ’empereur , pour réveiller la paffion de fon peuple
pour les fciences , dont le goût avoit été entièrement
émouffé par les dernières guerres civiles ,
& pour exciter l ’émulation; parmi le s mandarins ,'
choifit quarante .deux des plus habiles doéteurs ,
qu’i l chargea de compofer un corps de doétrine
conforme à ce lle des anciens, pour fervir déformais
de règle du favoir & de marque pour reconnoître les
gens de Lettres. Les Savants prépofés à cet ouvrage
s’y appliquèrent avec beaucoup d’attention 5 mais
quelques perfonnes s’imaginent, qu’ils donnèrent
la torturé à la doctrine des anciens pour la faire
accorder avec la leur , plus tôt qu’ils ne formèrent
leurs fontiments fur le modèle des anciens. Ils parlent
de la Divinité comme fi ce n’ étoit rien de plus
qu’une pure nature, ou bien le pouvoir & la vertu
naturelle qui produit , arrange , & conferve toutes
les parties de l ’univers : c’ e f t , difent-ils , un pur
& parfait principe , fans commencement ni fin 3
c’eft la fource de toutes chofes , l’efpérance de tout
être , & ce qui le détermine foi-même à être ce
qu’i l eft. Ils font de Dieu l ’ame du monde 3 i l
eft , félon leurs principes, répandu dans toute la
matière , & i l y produit tous les changements' qui
lui arrivent. En un mo t, i l n’eft pas aifé de-décider
s’ils réduifent. l ’idée de Dieu à celle de la nature ,
ou s’ils élèvent plus tôt l ’idée de la nature à celle
de Dieu 3 car ils attribuent à la nature une infinité
de ces chofes que nous attribuons a Dieu.
Cette doctrine introduifit à la Chine une- efpèce
d’alhéifme raffiné , d la place ’e l ’idolâtrie, qui y
avoit régne auparavant. Comme l ’ouvrage avoit
été compofé par tant de perfonnes réputées favantes
& verfées en tant de parties , & que l’empereur lui-
même lui avoit donné fon approbation, le corps
de dodrine fut reçu du peuple , non feulement
fans contradiction, mais même avec applaudiffement.
Plufieurs le goûtèrent, parce qu’il leur pa-
roiffoit détruire toutes les religions 3 d’antres er»
furent fatisfaits , parce que la grande liberté de
.penfer qu’il leur laiffoit en matière de religion ,
ne leur 'pouvoit pas donuer beaucoup d’inquiétude.
-C’eft ainfi que fe forma la feele des •Lettrés ,
•qni eft compofée; de ceux des chinois qu-i foutien-
nent les fentiments que nous venons de raporter-,
& qui y adhèrent. L a Cour , les mandarins , les
gens de' qua lité , les riches , & c , adoptent prefque
généralement cette façon de penfer 3 mais une
grande partie du menu peuple eft encore attachée
au culte des idoles.
Les Lettrés tolèrent fans -peine les mahorné-
tans , parce que ceux - ci adorent -, comme eux , l e
roi des deux & l ’auteur de la nature 5 mais ils ont
une parfaite averfion pour toutes les fdCces ido-
lâ très qui fe trouvent dans leur nation.- Iis réfo-
lurent même une fois de les extirper j mais le dé-
fordre que cette entreprife auroit produit dans l ’empire
, les empêcha : ils fe contentent maintenant der
-les condamner en général comme autant d’hérétiques,
& renouvellent folennellement tous les ans
à Pékin cette condamnation. ( A n o n y m e . )
. (N . ) L E V E R , É L E V E R , S O U L E V E R ,
H A U S S E R , EXH A U S SE R . Syn. O n lève , en
dreffant ou en mettant debout. O n élève , en pla çant
dans un lieu ou dans- un ordre éminent. On-
foulève ,■ en faifant perdre terre & portant en l ’ain
On h a u jfe , en ajoutant un degré fupérieur , foit
de fituation , foit de force., foit d’étendue. On
h a u jfe , en augmentant la dimenfîon perpèudicu-
laire ,, c’ eft id i r e , en donnant plus de hauteur par-
une continuation de lachofo même.
On dit , lever une échelle élever une ftatue 9
foulever un coffre , haujfer les épaules & la voix ,
exhaujfer un bâtiment. ; ( L ’abbé QlRARD
( N- ) L E X IC O G R A P H E ', f. m. Auteur d’ua
Lexique , d’un dictionnaire, ou d’un gloffaire.
L a compofitiôn d’un pareil ouvrage n’eft pas
fans difficulté , & l ’utilité en eft très - grande £
i l n’y a , pour s’en convaincre, qu’à lire l ’article
D i c t i o n n a i r e d e s L a n g u e s . On en conclura
néceffairement qu’un ben Lexicographe eft
digne d’une grande eonfidération , & que cë genre de
travail mérite des encouragements diftingués. ( M ,
B e A U Z É e . )
L E X IC O G R A P H IE , f. £ Grammaire. L a
Grammaire fe divife en deux parties générales ,
dont la première traite de la pa role, c’eft VOrtho-
iôgie 3 la féconde traite de l ’écriture , & c’eft i ’ O r -
thographe. C e lle - c i fe partage en deux branches
que l ’on peut nommer Lexicographie & L o -
gographie.
Lu'Lexicographie eft la partie de l ’Orthographe
qui preferit les règles convenables pour repré-*