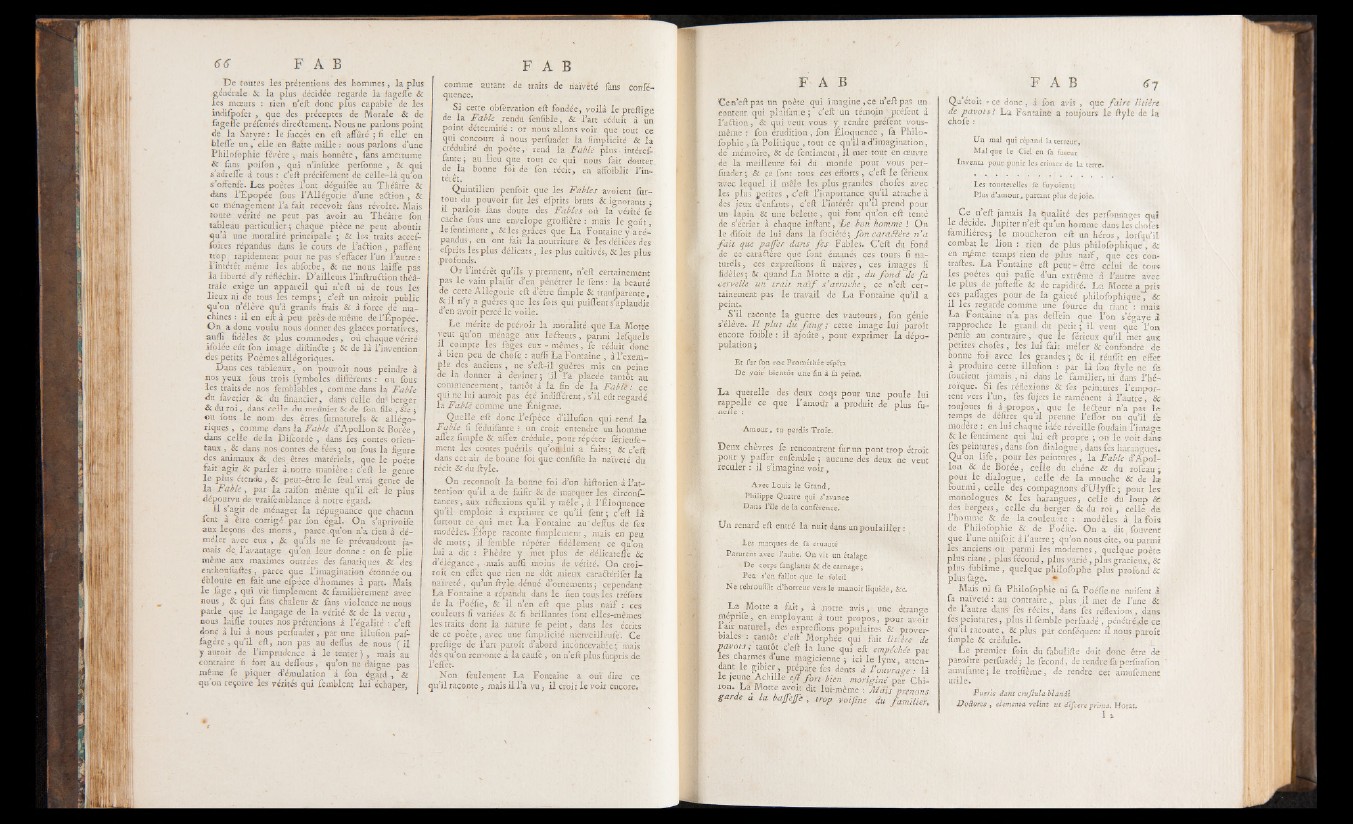
D e toutes les prétentions des hommes , la plus
générale & la plus décidée regarde la fàgeffe &
les moeurs : rien n’eft donc plus capable de les
indifpofer , que des préceptes de Morale & de
îagene préfentés dire élément. Nous ne parlons point
de la Satyre : le fucçès en eft affiné ; fi elle’ en
bleffe u n , elle en flatte mille : nous parlons d’une
Philofophie févère , mais honnête, fans amertume
& fans poifon , qui n’infiike perfonne , & qui
s’adreffe a tous: c’eft précifement de ce lle - là qu’on
s ’offenfe. Les poètes l ’ont déguifée au Théâtre &
dans l ’Épopée fous l ’A llé gor ie d’une aétion , &
ce ménagement l ’a fait recevoir fans révolte. Mais
toute vérité ne peut pas avoir au Théâtre fon
tableau particulier; chaque pièce ne peut aboutir
qu à une moralité principale ; & le-s. traits accef-
foires répandus dans le cours de l ’aétion , paffent
trop rapidement pour ne pas s’effacer l ’un l’ autre :
l ’intérêt même les ablorbe, & ne nous laiffe pas
la liberté d’y réfléchir. D ’ailleurs l ’inftruétion théâtrale
exige un appareil qui n’eft ni de fous les
lieux ni de tous les temps ; c’eft un miroir public
qu’on n’élève qu’à grands frais & à force de machines
: i l en eft à peu près» de même de l ’Épopée.
O n a donc voulu nous donner des glaces portatives,
auffi fidèles & plus commodes, où chaque vérité
ifç lé e eut fon image diftinéte ; & de là l ’invention
des petits Poèmes allégoriques.
Dans ces tableaux, on pouvait nous peindre à
nos yeux fous trois. fymboles différents : où fous
le s traits de nos fomblables, comme dans la Fable
du favetier & du financier, dans ce lle du* berger
& du r o i , dans ce lle du meunier & de fon fils , &c 5
ou fous le nom des êtres furnaturels & a llég o riques
, comme dans la Fable d’A p o llon & Boré e,
dans ce lle d e là Difcorde , dans les contes orientaux
, & dans nos contes de fées ; ou fous la figure
des animaux & des hêtres matériels, que le poète
fait agir & parler à.notre manière : c’eft le genre
le plus étendu, & peut-être le foui vrai genre de
la F a b le , par la raifon même qu’i l efÉ le plus
dépourvu de vraifemblance à notre egard.
I l s agit de ménager la répugnance que chacun
fent a être corrigé par fon égal. O n s’aprivoife
aux leçons des morts., parce.qu’on n’a rien à démêler
avec eux , qu ils ne fe- prévaudront jamais
de l ’avantage qu’on leur donne : on fë p lie
même aux maximes outrées des fanatiques & des
enthoufiaftes, parce que l ’imagination étonnée ou
éblouie en fait une efpèce d’hommes à part. Mais
le f à g e , qui vit Amplement & familièrement avec
nous , & qui fans chaleur & fans violence ne nous
parle que le langage de la vérité & de la v ertu ,
nous laiffe toutes nos prétentions à l ’égalité : c’eft
donc à lui à nous perfiiader, par une îilufion paf-
fagère , qu’ i l eft, non pas au deffus de nous ( i l
y auroit de l ’imprudence à le tenter ) , mais au
contraire fi fort au deffous, qu’on ne daigne pas
même fe piquer d’émulation à fon égard , & j
qu’on reçoive les vérités qui fombient lui échaper,
comme autant de traits de haïvëté fans confé-
quence.
Si cette obfervation eft fondée, voilà le preftîge
de la Fable rendu fenfible, & l ’ art réduit à un
point détermin'é : or nous allons voir que tout ce
qui concourr à nous perfuad.er la fimplicité & la
crédulité du poète,» rend la Fable p lu s ■ intérêt-
fhnte j au lieu que tout ce qui nous fait douter
de la bonne foi de fon récit, en affoiblit l ’intérêt.
Quintilien penfoit que les Fables avoient fur-
tout du pouvoir fur les efprits bruts & ignorants ;
i l parloir- fans doute des F ab les où' la vérité fe
cache fous une envelope groflièrè : mais le g o û t ,
lefentiment , & les grâces que L a Fontaine y a ré -
pandus, en ont fait la^nourriture & les délices des
efprits les plus délicats, les plus cultivés, & les plus
.profonds.
O r l ’intérêt qu’ils y prennent, n’eft certainement
pas le vain plaifir d’en pénétrer le fens: la beauté
de cette A llé g or ie eft d’être Ample & tranfparente,
& i l n’ y a guères que les fots qui puiffent s’aplaudir
d’en avoir percé le voile.
L e mérite de prévoir la moralité que L a Motte
veut qu’on ménage aux le d e u r s , parmi lefquels
i l compte les fages eu x -m êm e s , fe réduit donc
à bien peu de chôfe : auili L a Fontaine , à l ’exemple
des anciens , ne s’eft-il guères mis en peine
de la donner à deviner j ,il l ’a placée tantôt au
commencement, tantôt à la fin de la Fablè : ce
qui ne lui auroit pas été indifférent, s’i l eut reo-ardé
la Fab le comme une Énigme.
Q u e lle eft donc l ’efpèce d’illufîon qui rend la
Fable fi féduifante ? on croit entendre un homme
affez fîmple & affez crédule, pour répéter férieufo-
ment les contes puérils qu’ondui a faits ; & ç’eft
dans cet air de bonne foi que confifte la naïveté du
récit & du ftyle.
O n reconnoît l a bonne foi d’un hiftorien à l ’ attention'
qu’i l a de faifir & de marquer les circonstances',
.aux réflexions qu’il' y mêle , à l ’Éloquence
qu’i l emploie à exprimer ce qu’i l fent; c’eft là
furtout ce qui met L a Fontaine au'deffus de fes
modèles. Éfope raconte Amplement, mais en peu
de mots; i l femble répéter fidèlement ce qu’on
lui a dit : Phèdre y met plus de", déiicateffe &
d’élégance , -mais auffi moins de vérité. On croi-
roit en effet que rien ne dut mieux çara&érifer la
naïveté, qu’un ftyle dénué d’ornéments; cependant '
L a Fontaine a répandu dans le fien tous les tréfors
de la Poéfie, & i l n’en eft que plus naïf : ces
couleurs fi variées & fi brillantes font elles-mêmes
les traits dont la nature fe peint, dans les écrits
'de ce poète , avec une fimplicité merveilleufe. C e
preftige de l ’art paroît d’abord inconcevable ; mais
dès qu’on remonte à la caüfe, on n’eft plus furpris de
l ’effet.
Non feulement L a Fontaine a ouï dire ce
qu’i l raconte, mais i l l ’a v u , i l croit le voir encore.
C e n’eft pas un poète qui imagine , ce n’eft pas un,
conteur, qui plaifan:e ; c’eft un témcyin ' préfent à
l ’aé lion, & qui veut vous y rendre préfent vous-
même : fon érudition, fon Éloquence , fa Philofophie
, fa Politique , tout ce qu’i l ard’imagination,
de mémoire, & de fentiment, i l mec tout en oeuvre
de la meilleure foi dii monde pour vous per-
fuader ; & ce font tous ces efforts , c’eft le férieux
■ avec lequel i l mêle les plus grandes chofes avec
les plus petites , c’eft l ’importance^ qu’i l attache à
des jeux d’enfants, c’eft l ’intérêt qu’i l prend pour
un lapin & une b elette, qui font qu’on eft tenté
de s’écrier à chaque inftant, L e bonhomme i On
le difoit de lui dans .la fociété; fo n caractère n a
f a i t que pujfer dans f e s Fables. C ’eft du fond
de ce caractère que font émanés ces tours fi naturels
, ces expreffions fi naïves, ces images fi
fidèles; 8c quand L a Motte a dit , du f o n d de f a
cervelle un trait n a i f s ’arrache -, ce n’eft certainement
pas le travail de L a Fontaine qu’i l a
peint..
S’ i l raconte la guerre des vautours, fon génie
s’élève. I l p lu t du fd n g ; cette imageTui paroît
encore foible : i l ajoute , pour exprimer la dépopulation
;
Et fur fon roc Prométhée efpêra
De .voir bientôt uixe fin à fa peiné.
L a querelle des deux coqs pour une poule lui
rappelle ce que l ’ amour a produit de plus fu-
nefte :
Amour, tu perdis Troie.
Deux chevres fe rencontrent fur un pont trop étroit
pour y paffer enfemble ; aucune des deux ne veut
reculer : i l s’imagine v o ir ,
Avec Louis le Grand,
Philippe Quatre qui s’avance
Dans l’île de la conférencë.
Un renard eft entré la nuit dans un poulailler :
Les marques de fa cruauté
Parurent avec l’aube. On vit un étalage
1 De corps fanglants & de carnage 5
Peu s’ en fallut que le foleil
Ne rebrouffât d’horreur vers le manoir liquide, Scc.
, a -notre a v is , une êtràno-e
méprife, en employant à tout propos, pour avoii
l air naturel, des expreffions populaires & proverbiales
: tantôt .c’eft Morphée qui fait litière de
pavots i tantôt c’eft la lune qui eft empêchée pai
les charmes d’une magicienne ; ici le ly n x , attendant
le gibier | prépare fes dents à l'ouvrage : ls
le jeune A ch ille e jl fo r t bien moriginé par Chiron.
L a Motte avoit dit lui-même : M a is prénom
garde a la baffejfe , trop voifine du fam ilie r
Qu étoit - ce donc, à fon avis , que fa ir e litière
de p a v o ts ‘i L a Fontaine a toujours le ftyle de la
chofe :
Un mal qui répand la terreur,. 1
Mal que le Ciel en fa fuseur
Inventa pour punir les crimes de la terre.
Les tourterelles fe fuyoient;
Plus d’amour, partant plus de joie.
C e ^ n eft jamais la qualité des perfonnages qui
le décide. Jupiter n’eft qu’un homme dans les chofes
familières; le moucheron eft un héros, io r fq u ii
combat le lion : rien de plus philofophique, &c
en njpme temps rien de plus n a ïf, que ces con-
traftes. L a Fontaine eft p eu t -ê t re celui de tous
les po et es qui paffe d’un extrême à l ’autre avec
le plus de jufteffe & de rapidité. L a Motte a pris
ces paffages pour de là gaieté philofophique, 8c
i l les regarde comme une fource du riant : mais
L a Fontaine n a pas deffein que l ’on s’égaye à
rapprocher le grand du p e t it ; i l veut que l ’on
penfe au contraire, que le férieux qu’i l met aux
petites chofes, les lui fait mêler & confondre de
bonne foi avec les grandes ; & i l réufïït en effet
à produire cette illufion : par là fon ftyle ne fe
fondent jamais , ni dans le familier, ni dans l ’héroïque.
S i fes réflexions & fes peintures l ’emportent
vers l ’un, fes fujets le ramènent à l ’autre, &
toujours fi à propos, que le le&eur n’a pas l e
temps de délirer qu’i l prenne l ’effor ou qu’ i l fe
modère : en lui chaqué idée réveille foudain l ’image
8c le fentiment qui lui eft propre ; on le voit dans-
fos peintures, dans fon dialo gue, dans fes harangues»
Qu ’on l i f e , pour les peintures , la Fab le d’A p o llon
& de B o ié e , ce lle du chêne & du rofeau ;
pour le d ialo gu e , ce lle de la mouche & de la
Fourmi, ce lle des compagnons d’ U ly f fe ; pour les
monologues & les harangues, ce lle du loup 8c
des bergers, ce lle du berger & du roi , ce lle de
l ’homme & de la couleuvre : modèles à la fois
de Philofophie 8ç de Poéfie. On a dit fou vent
que l ’une nuifoit à l ’autre ; qu’on nous cite, ou parmi
les anciens<ou parmi les modernes, quelque poète
plus riant, plus fécond, plus varié , plus gracieux, 8c
plus fublime, quelque philpfophe plus profond &
plus fage. *
Mais ni la Philofophie ni fa Poéfie ne nuifent à
fa naïveté: au contraire,. plus i l met de l ’une &
de 1 autre dans fes récits, dans fes réflexions, dans
fos peintures, plus i l femble perfuadé , pénécré^de ce
qu i l raconte, & plus par conféquent i l nous.paroît
ample & crédule.
Le premier foin du fabuiifte doit donc être de
paroître perfuadé; le fécond, de rendre fa perfuafion
amufante; le troifîème, de rendre cet amufement
utile.
Pueris dant crujiula blatidi
Boclores , elemento velint ut difcere prima. Horat. I i