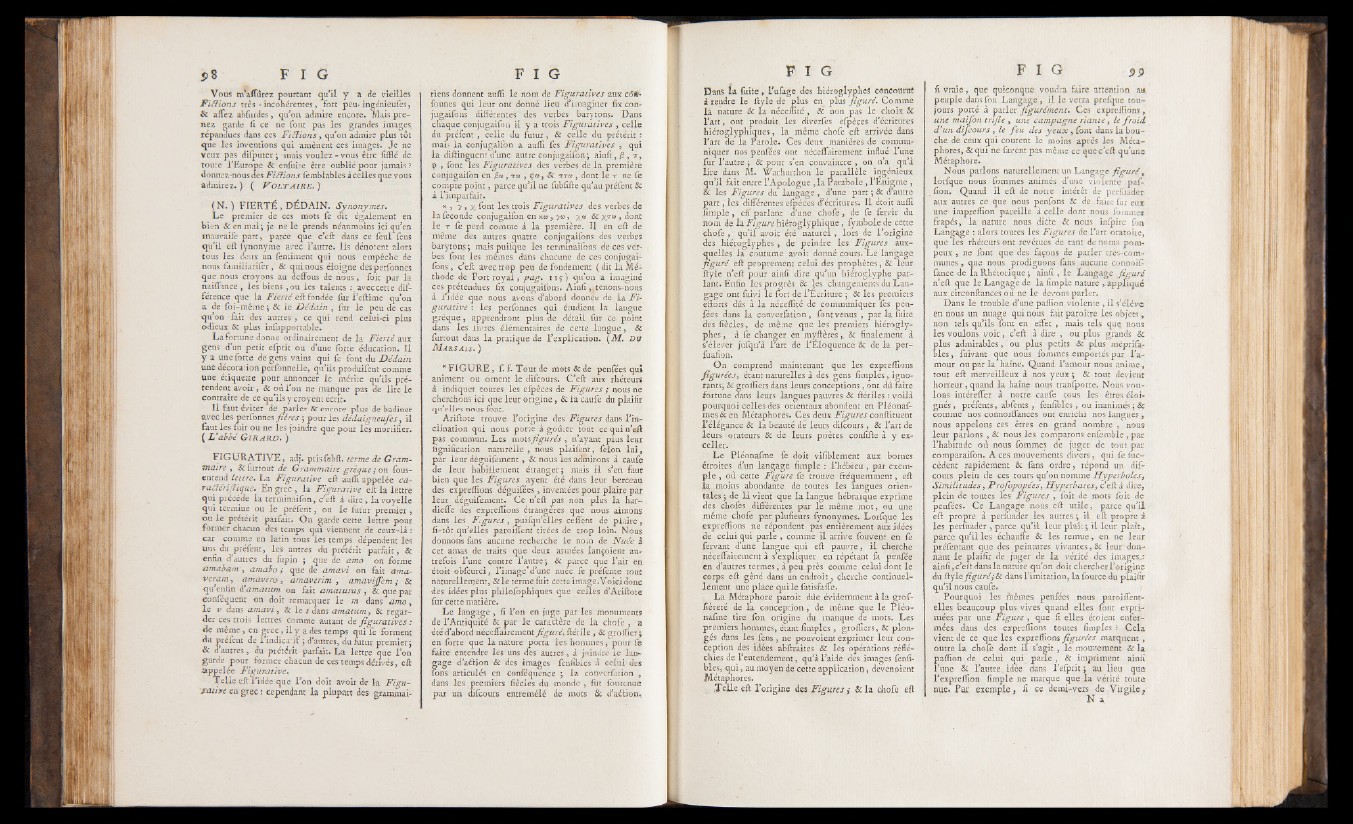
Vous maflùrez pourtant qu’ i l y a de vieilles
F ic tio n s très - incohérentes, fort peu-ingénieufes,
& allez abfurdes, qu'on admire encore. Mais prenez
garde fi ce ne font pas les grandes images,
répandues dans ces F ic t io n s , qu'on admire plus tôt
que les inventions qui amènent ces images. Je ne
veux pas difputer ; mais voulez - vous être fifflé de
toute l ’Europe & enfui te être oublié pour jamais ?
donrrez-nous des F ictions fèmblables à celles que vous
admirez. ) ( V o l t a ir e . )
( N . ) F IE R T É , D É D A IN . Synonymes.
L e premier de ces mots fe dit également en
bien & en m al} je ne le prends néanmoins ici qu’en
mauvaife parc, parce que c’eft dans ce feul fens
qu’i l eft fynonyme avec l ’autre. Ils dénotent alors
tous les deux un fèntiment qui nous- empêche de
nous fàmiliarifèr, & qui nous éloigne desperfonnes
que nous croyons au deflous de nous, foit par la
naiflance , les biens ,o u les talents avec cette différence
que la F ie r té eft fondée fur l ’eftime qu’on
a de foi-même} & le D éd ain , fur le peu de cas
qu’on fait des autres , ce qui rend celui-ci plus
odieux & plus infopportable.
L a fortune donne ordinairement de la F ie rté aux
gens d’un petit efprit ou d’une forte éducation. I l
y a une forte de gens vains qui fe font du D éd ain
une décoration pèrfonnelle, qu’ils produifent comme
une étiquette pour annoncer le mérite qu’ils prétendent
a vo ir , & où l’on ne manque pas de lire le
contraire de ce qu’ils y eroyent écrit.
I l faut éviter de parler & encore plus de badiner
avec les perfonnes fières ; pour les dédaigneufes, i l
faut les fuir ou ne les joindre que pour les mortifier.
( L ’abbé G i r a r d . )
F IG U R A T IV E , adj. pris fobft. terme de Grammaire
, & furtout de Grammaire grèque ; on fous-
em tn èle ttr e . L a Figurative eft aufli appelée ca-
raciérifiique. En g r e c , la Figurative eft la lettre
qui précède la terminaifon, c’ eft à dire , la voyelle
qui termine ou le préfent, ou le futur premier,
ou le prétérit parfait. O n garde cecte lettre pour
former chacun des temps qui viennent de ceux-là :
car comme en latin tous les temps dépendent lès
uns du préfent, les autres du prétérit parfait , &
enfin d autres du fîipin j que de amo on forme
amabam, amabo ; que de amavi on fait amcp
veram , amavero, amaverim , amavijjem ; &
qu enfin Hamatum on fait amaturus 3 & que par
confequent on doit remarquer le m dans am o ,
le v dans am a v i, & le t dans amatiim, & regarder
ces trois lettres comme autant de figuratives :
de meme, en ^rec , i l'y a des temps qui fe forment
du J>refent de 1 indicatif 3 d’autres, du futur premier}
& d’autres, du prétérit parfait. L a lettre que l ’on
garde pour former chacun de ces temps dérivés, eft
appelée Figurative.
T e lle eft l ’idée que Ton doit avoir de la F ig u rative
en grec : cependant la plupart des grammairiens
donnent aufli le nom de Figuratives aux cd&
fonnes qui leur ont donné lieu d’ imaginer fix con-
jugaifons différentes des verbes barytons. Dans
chaque conjugaifon i l y a trois Figuratives , ce lle
du préfent , celle du futur, & ce lle du prétérit :
mais la conjugaifon a aufli fes Figuratives , qui
la diftinguenc d’une autre conjugaifon} ainfî', /3 , tt,
<p , font les Figuratives des verbes de la première
conjugaifon en , ttw , <p©, & , dont le r ne fe
compte p o in t , parce qu’i l ne fubfifte qu’au préfent &
à l ’imparfait.
h , y , x font les trois Figuratives des verbes de
la fécondé conjugaifon en x« , ya, & x™ > dont
le t fe perd comme à la première. I l en eft de
même des autres quatre conjugaifons des verbes
barytons} mais puifque les terminaifons de ces verbes
font les mêmes dans chacune de ces conjugaifons
, c’eft avec trop peu de fondement ( dit la Méthode
de Port r o y a l , pug . 11 y ) qu’on a imaginé
ces prétendues fix conjugaifons. Ainfi , tenons-nous
a l ’idée que nous avons d’abord donnée de la F i gurative
: les perfonnes qui étudient la langue
grèq u e , apprendront plus de détail fur ce point
dans les livres élémentaires de cette lan gu e , 8c
furtout dans la pratique de l ’explication. (M . D\J
M ars a ï s . )
* F IG U R E , f. f. Tour de mots & de penfées qui
animent ou ornent le difcours. C ’eft aux rhéteurs
à indiquer toutes les efpèces de Figures ; nous ne
cherchons ici que leur or ig in e , & la caufe du p laifîr
qu’elles nous font.
Ariftote trouve l ’origine des Figures dans l ’inclination
qui nous porte à goûter tout ce qui n’eft
pas commun. Le s mots figur és , n’ayant plus leur
lignification naturelle , nous plaifènt, félon l u i ,
par leur déguifement , & nous les admirons à caufe
de leur habillement étranger; mais i l s’en faut
bien que les Figures ayent été dans leur berceau
des expreflîons déguifées , inventées pour plaire par
leur déguifement. Ce n’eft pas no'n plus la har-
dieffe des expreflîons étrangères que nous aimons
dans les F ig u r e s , puifqu’elles ceffent de p la ir e ,
fi-tôt qu’elles paroiflent tirées de trop loin. Nous
donnons fans aucune recherche le nom de Nuée à
cet amas de traits que deux armées lançoient am
trefois Tune contre l ’autre; 8c parce que l ’air en
étoit obfourci, l ’image'd’une nuee fe préfente tout
naturellement, & le terme fuit cette image.Voici donc
des idées plus philofophiques que celles d’Ariftote
for cette matière.
L e langage , fi l ’on en juge par les monuments
de l ’Antiquité & par le caractère de la chofe , a
été d’abord néceflairement figuré\ ftérile , 8c groflier ;
en forte que la nature porta les hommes, pour fe
faire entendre les uns des autres, à joindre le langag
e d’aétion & des images fenfihies à celui des
ions articulés en conféquence } la converfation ,
dans les premiers fiècles du monde , fut foutenue
par un difcours entremêlé de mots 8c d’aétion-
Dans la fuite , l’ufage des hiéroglyphe^ concourut
à rendre le ftyle de plus en plus figur é. Comme
là nature & la néccuïté ,. Ôc non pas le choix &
l ’art, ont produit les diverfes efpèces d’ écritures
hiéroglyphiques, la même chofe eft arrivée dans
l ’ art de la Parole. Ces deux maniérés de communiquer
nos penfées ont néceflairement influé Tune
fur l ’autre ; & pour s’en convaincre , on n’a qu’à
lire dans M. Warhurthon le parallèle ingénieux
qu’i l fait entre l ’Apologue , 1a Parabole, l ’Énigme ,
& les Figures du langage , d’une part ; & d autre
p a r t , les différentes efpèces d’écritures. I l étoit aufli
/im p ie , en parlant d’une ch o fe , de fe fervir du
nom de la Figure h iéroglyphique, fymbole de cette
chofe , qu’i l avoit été natu re l, lors de l ’ origine
des hiéroglyphes , de peindre les Figur es auxquelles
la coutume avoit donné cours. L e langage
fig u r é eft proprement celui des prophètes, & leur
ftyle n’eft pour ainfi dire qu’un hiéroglyphe parlant.
Enfin les progrès & les changements du L angage
ont foivi le fort de l ’Écriture 3 & les premiers
efforts dûs à la néceflité de communiquer fes penfées
dans la converfation, font venus , par la fuite
des fiècles, de même que les premiers hiéroglyphes,
à fe changer en myftères }. 8c finalement à
s’ élever jufqu’à fa r t de l ’Éloquence & de la per-
foafion.
O n comprend maintenant que les expreflîons
figurées, étant naturelles à des gèns fîmples, ignorants,
& grofliers dans leurs conceptions , ont dû faire
fortune dans leurs langues pauvres & ftériles : voilà
pourquoi celles des orientaux abondent en Pléonasmes
& en Métaphores. Ces deux Figur es conftituent
T élégance & la beauté de leurs difcours , & l ’art de
leurs - orateurs. & de fours poètes confîfte à y exceller.
L e Pléonafme fe doit vifiblement aux bornes
étroites d’un langage fimple : l ’hébreu, par exemp
le , où cette Figure fe trouve fréquemment, eft
la moins abondante de toutes les langues orientales
; de là vient que la langue hébraïque exprime
des chofes differentes par le même mot, ou une
même chofe par plufieurs Synonymes. Lorfque les
expreflîons ne répondent pas entièrement aux idées
de celui qui parle , comme i l arrive fouvenc en fe
Servant d’uné langue qui eft pauvre, i l cherche
néceflairement à s’expliquer en répétant fa penfée
en d’autres termes, à peu près comme celui dont le
corps eft gêné dans un endroit, cherche continuellement
une p lace qui le fatisfafte.
L a Métaphore paroit due évidemment à la grof-
fièreté de la conception, de même que le Pléonafme
tire fon origine du manque de mots. Les
premiers hommes, étant fîmples , grofliers, & plongés
dans les fens , ne pouvoient exprimer leur conception
des idées abftraites & les opérations réfléchies
de Tentendement, qu’à l ’aide des images fenfi-
bles, q u i, au moyen de cette application, devenoient
Métaphores.
, T e l le eft l ’origine des F igur es ; 8c la chofe eft
fi v raie , que quiconque voudra faire attention au
peuple dans fon Langage , i l le verra prefque toujours
porté à parler figurément. Ces expreflîons,
une maifon trifie , une campagne rian te , le f r o id
d ’ un d ifcou rs, le f e u des y e u x , font dans la bouche
de ceux qui courent le moins après les Métaphores,
& qui ne favent pas même ce que c’eft qu’une
Métaphore.
Nous parlons naturellement un Langage f ig u r é ,
lorfque nous fommes animés d’une violente paf-
fion. Quand i l eft de notre intérêt de perfuader
aux autres ce que nous penfons & de .faire for eux
une impreflion pareille à ce lle dont nous fommes
frapés, la nature nous diète & nous infpire fon
Langage : alors toutes les Figures de l ’art oratoire,
que les rhéteurs ont revêtues de tant de noms pompeux
, ne font que des façons de parler très-communes
, que nous prodiguons fans aucune connoif
fance de la Rhétorique ; ainfî , le Langage fig u r é
n’eft que le Langage de la fimple nature, appliqué
aux circonftances ou ne le devons parler.
Dans le trouble d’une paflîon violente , i l s’élève
en nous un nuage qui nous fait paroître les objets ,
non tels qu’ils font en effet , mais tels que nous
les voulons v o ir , c’ eft à dire , ou plus grands &
plus admirables, ou plus petits & plus méprifa-
b les, foivant que nous fommes emportés par l ’amour
ou par la haîne. Quand l ’amour nous anime,
tout eft merveilleux à' nos y e u x } & tout devient
horreur, quand la haîne nous tranfporte. Nous voulons
intéreffer à notre caufe tous les êtres éloignés
, préfents, abfents , fenfîbles , ou inanimés ; &
comme nos connoiflances ont enrichi nos langu es,
nous appelons ces êtres en grand nombre , nous
leur parlons , & nous les comparons enfemble, par
l ’habitude où nous fommes de juger de tout par
comparaifon. A ces mouvements divers, qui fe foc -
cèdent rapidement & fans ordre,, répond un d ifcours
plein de ces tours qu’on nomme Hyperboles,
Sim ilitu d e s , Profopopées, Hyperbates, c’eft à dire,
plein de toutes les F igur es , foit de mots foit de
penfées. C e Langage nous eft u tile , parce qu’i l
eft propre à perfuader les autres ; i l eft propre à
les perfuader , parce qu’ i l leur p la ît ; i l leur p la ît ,
parce qu’i l les échauffe & les remue, en ne leur
préfèntant que des peintures vivantes, & leur' donnant
le plaifîr de juger de la vérité des images^
ainfi, c’eft dans la nature qu’on doit chercher l ’origine
du ftyle fig u r é ; 8c dans l ’imitation, la fource du plaifîr
qu’i l nous caufe.
Pourquoi les mêmes penfées nous paroiffent-
elles beaucoup plus vives quand elles font exprimées
par une Figure , que fi elles étoient enfermées
dans des expreflîons toutes fîmples ? C e la
vient de ce que les expreflîons figurées marquent ,
outre la chofè dont i l s’a g i t , le mouvement & la
paflîon de celui qui p a r le , & impriment ainfî
l ’une & l ’autre. idée dans l ’efprit} au lieu que
l ’expreflîon fimple ne marque que la vérité toute
nue. Par e x emple, fi ce demi-vers de V ir g ile i