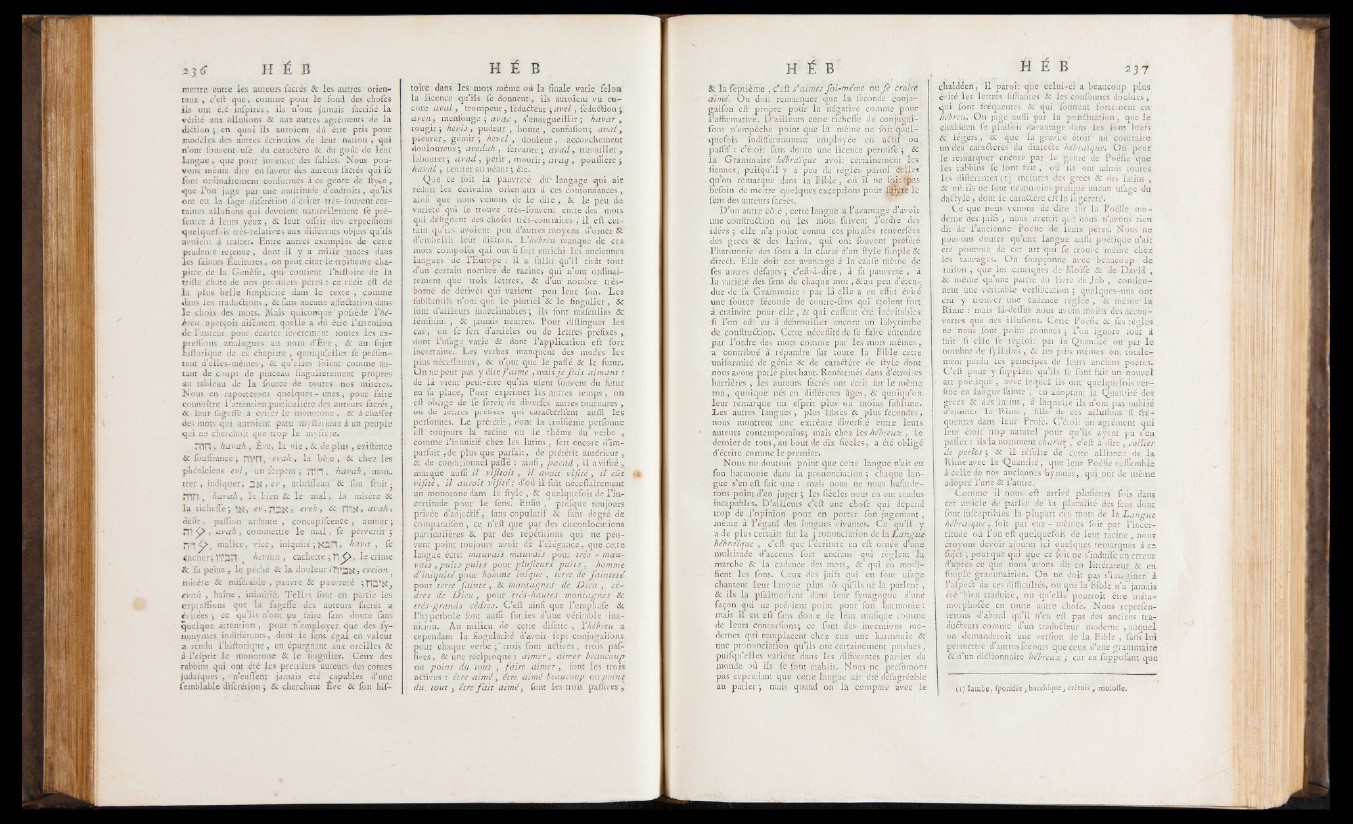
mettre entre les auteurs facrés & les autres orientaux
, c’eft que, comme pour le fond des choies
ils ont é;c infpirés, ils n’ont jamais facrifié la
vérité aux allufions & aux autres agréments de la
diction ; en quoi ils auroient dû être pris pour
modèles des autres écrivains de leur nation > qui
n’ont fouvenc ufé du caractère & du goût de leur
lan gu e, que pour inventer des fables. Nous pouvons
même dire en faveur des auteurs facrés qui fe
font ordinairement conformés à ce pente de f ty îe ,
que l ’on juge par une multitude d endroits, qu’ils
ont eu la (âge difcrétion d’éviter très-fouvent certaines
allufions qui dévoient naturellement fe pré-
fenter à leurs. y e u x , & leur offrir des expreilions
quelquefois très-relatives aux différents objets qu’ils
avoienc à traiter. Entre. autres exemples de cette
prudene retenue, dont i l y a mille ^traces dans
les fainc.es Écritures, on peut citer le trpifième chapitre,
de la Gen èfe, qui contient l ’hiftoire de la
trille chute de nos premiers pères : ce récit effc de
la plus belle {implicite dans le texte , comme
dans les traductions , & fans aucune affectation dans
l e choix des mots. Mais quiconque pofsède Y hébreu
aperçoit aifément quelle a dû être l ’attention
de l ’auteur pour écarter fév ère ment toutes les ex-
preffions analogues au nom d’Eve , & au fujet
hiftorique de ce chapitre , quoiqu’elles fe préfèn-
tent d’elles-mêmesy & qu’elles foient- comme autant
de coups de pinceau fiaguii èrement propres
au tableau de la fource de toutes- nos misères.
Nous en reporterons qu e lq u e s -un e s , pour faire
çonnoître l ’attentionparticulière des auteurs facrés,
& leur fageffe à éviter le monotone, & à chaffer
des mots qui auroient paru myftérieux à un peuple
qui ne cherdioit que trop le myfrère.
Hin > havak , Ève, la vie , & de plus , exiftence
& fouffranee ; HVH, evah , la bête , & chez les
phéniciens e v i , un ferpent 5' p}in > ha va h, montrer
, indiquer; , ev , arbriiTeau"• 3 - . 7 ff*1? \ 7 :& - xf. on_ fruit*?
J^lfl, h a va h , le bien & le mal n la misère &
la richeffe; e v , rD K ? eveh, & n iN , a v a it ,
defir, paffion ardente , concnpifcence , amour ;
n i ÿ , a va h , commettre le m a l , fe pervertir ;
n ^ 5 > , malice, v ic e , iniquité ; K3H » hava , fe
ç a c i ie r jllO n 5 hevion , cachette ; Î1^>, le Crime
& fa peine , le péché & la douleur > Ï1VJN, eveion
misère & miférable , pauvre & pauvreté' ;
evah , haine , inimitié. T e lle s font en partie les
expreffions que la fageffe des auteurs facrés a
évitées ; ce qu’ils n’ont pu faire fans doute fans
quelque âttèntion, pour n’employer que des fy-
nonymes indifférents, dont le lens ég a l en valeur
a rendu l ’hiftorique, en épargnant aux oreilles &
à l ’efprit le monotone & le Singulier. Ceux des
rabbins qui ont été les premiers auteurs des contes
judaïques , n’euffent jamais été capables d’ une
fembiable difcrétion ; & cherchant Ève & fon hiftoire
dans lés mots même où la finale varie félon
la licence qu’ils fe donnent, ils auroient vu encore
a v a l , trompeur, féduCteur ; a v e l , féduCtion y
aven, menlbnge ; avac , s‘enorgueillir ; havar ,
rougir ; hev is , pudeur , honte , confufion ; aval >
pleurer, gémir ; hevel , douleur, accouchement
douloureux; avedah , fèrvante ; a v a d , travailler
labourer ; a v a d , périr , mourir; -avaq , pouffière ;
h a v a l , rentrer au néant ; &c.
Que ce foit la pauvreté du> langage qui ait
réduit les écrivains orientaux à ces confonnances,
ainfi que nous venons de le dire , & le peu de
variété qui fe trouve très-fouvent entre des mots
qui déffgnent des chofes très-contraires , i l eft certain
qu’lis avaient peu d’autres moyens d’orner 8c
d’embeliir leur diCtion. U hébreu manque de ces
mots cô'mpofés qui ont fi fort enrichi les anciennes
langues . de l ’Europe : i l a fallu; qu’i l tirât tout •
d’un certain nombre de racines qui n’ont ordinairement
que trois lettres, & d’un nombre très-
borné, de dérivés qui varient peu leur fon. Les
fubftantirs n’ont que le pluriel & le fingulie r, &
font d’ailleurs indéclinables; ils font mafculins &
féminins , & jamais neutres. Pour diflinguer les
cas, on fe fert d’articles ou de lettres préfixes ,
dont l ’ufage varie & dont l ’application eft fort
incertaine. Le s verbes manquent des modes/ les
plus néeeffaires., & n’ont que le paffé & le futur.
O n ne peut pas y dire ƒ aime , mais j e fu i s a im a n t:
de là vient peut-être qu’ils ufent fouvent du futur
en fa place, Pour exprimer les autres temps, on
eft obligé de fe fervir de diverfes autres tournures,
ou de lettres préfixes qui caraCtérifent auifi les
perfonnes. L e prétérit , dont la troifième perfonne
eft. tou jours la racine ou le thème du verbe ,
comme l ’infinitif chez les la tin s , fert encore d’imparfait
,de plus que parfait, de prétérit antérieur ,
& de conditionnel paffé : ainfi, p aca d , i l avifité ?
marque au (fi i l vifitoit , i l ayoit vifité , i l eût :&■
v i f t é , i l auroit vijîté'j d’où i l fuit neceffairement
un monotone dans le ftyle , & quelquefois de l ’incertitude
pour le fens. Enfin , prefque toujours
privée d’adjeéüf, fans copulatif & fans degré de
comparaifon, ce n’eft. que par des circonlocutions
particulières & par des repentions qui ne peuvent
point toujours avoir dé l ’élégance, que cette
langue écrit mauvais mauvais pour très - mauvais
, p u it s p u its pour plufieurs p u it s , homme
d*iniquité pour homme inique , terre de fa in te té
pour terre f a in t e , & montagnes de D ieu , cèdres
de D i e u , pour très-hautes montagnes &
très-grands cèdres. C ’eft ainfi que l ’emphafe &
l ’hyperbole font auffi forties d’ une véritable inanition.
A u milieu de cette difette , l ’hébreu a
cependant la fingularité d’avoir fept conjugaifons.
pour chaque verbe;* trois font actives, trois paf-
îïves, & une réciproque : a im e r a im e r beaucoup
ou p o in t du tout , fa i r e . aimer., font les trois
aétives : être a im é , être aimé beaucoup ou poinp
du tout y être f a i t aimé y font les trois pafiîves >
& la feptième , c’ eft s'aimer foi-même ou f e croire
aimé. O n doit remarquer que la fécondé conju-
gaifon eft propre pour la négative comme pour
l ’affirmative. D ’ailleurs cette' richeffe de conjugai-
fons n’empêche point que la même ne' foit. quelquefois
indifféremment employée en aétif o u .
paffif : c’ étoit fans doute une licence permife ; &
la Grammaire hébraïque avoir certainement les
fiennes, puifqu’i i y a peu de règles parmi déliés'
qu’on remarque dans la B ib le , où i l ne fiûp ?pas
befoin de mettre quelques exceptions pour f^ je è le
fens des auteurs facrés.
D ’un autre côté , cette langue a l ’âvaritage d’avoir
une conftruétion où lés’ mots fuiVent l ’ordre dès
idées ; elle n’a point connu ces phrafes renverfees
des grecs & des latins, qui ont fouyent préféré
l ’harmonie des fons à la clarté d’un ftyle fimplé &
direèt. E lle doit' cet avantage à la caufe même de
fes autres défauts ; c’eft-à-dirè, à fa pauvreté , à
la variété des fens de chaque mot ,& à u peu d’étendue
de fa Grammaire : par là elle a en effet évité
une fource féconde de eontre-fens qui étoient fort
à craindre pour e l l e , & qui: euffent été inévitables1
fi l ’on eu: eu à débrouiller encore un labyrinthe
de conftmètiop. Cette néceffité de fe faire entendre
par l ’ordre des mots comme par les mots mêmes,
a t:ontribuê à répandre fur toute la Bible cette
uniformité de génie & de caractère de ftyle dont
nous avons parlé plus haut. Renfermés dans d’étroites
barrières , les auteurs facrés ont écrit fur le même
ton , quoique nés en différents âgés, & quoiqu’on■
leur remarque un efprit plus ou moins fubfime.
Le s autres langu es, plus libres & .plus fécondés,
nous montrent une extrême diverfite entre leurs
auteurs contemporains; mais chez les hébreux , le
dernier de tous, au bout de dix fiècles, a été' obligé
d’écrire comme le premier.
Nous ne doutons point que cette langue n’ait eu
fon harmonie dans la prononciation ; chaque langue
s’ en eft fait une : mais nous ne nous hafarde-
rons point d’en juger ; les fiècles nous én ont rendus
incapables. D ’ailleurs : c’eft une chofe qui dépend
trop de l ’opinion pour en porter fon jugement,
même à l ’égard des langues vivantes. C e qu’iL y.
a de plus certain fur la prononciation de la. Langue
hébraïque , c’ eft que l ’écriture en eft ornée d’une
multitude d’accents fort anciens qui règlent la
marche & la cadence des mots, & qui en modifient
les fons. Ceux des juifs qui en font ufage
chantent leur langue plus toc qü’ ils ne la parlent ,
& ils la pfallnodient dans leur fynâgogue d’une
façon qui ne prévient point pour fon narmonie :
mais i l en eft fans dôme de leur mufique comme
de leurs contorfions; ce font des inventions modernes
qui remplacent chez eux une harmonie &
une prononciation qu’ils ont certainement perdues,
puifqu’elles varient dans les différentes parcies du
monde, où ils fe font établis. Nous, ne préfumons
pas cependant que cette langue ait. été défagréable
au parler ; mais quand on là compare avec le
chaldeen, il paroît que celui-ci a beaucoup plus
évité les lettres fiffianres & les confonnes doubles,
qui font fréquentes & qui forment fortement en
hébreu. On juge auffi par la ponctuation, que le
châldée'n fe plaifoit davantage dans les fons brefs
& iégprs,, 6c que la gravité étoit au contraire
un des'caraCtères du diale d e hébraïque. On peut
le remarquer encore par le genre de Pôéfie que
lès rabbins; fe:. font fait , où ils ont admis toutes
les différentes ( ï) mefiges des grecs & des latins ,
8c où ils ne font néanmoins preique aucun ufage du
d a d y lé , dont le caradère cit la légèreté.
C e que nous venons de dire lür la Poelle moderne
des juifs , nous avertit' qi/ï ïiôus n’avôns rien-
dit de l ’ancienne Poéfie de leurs pères. Nous ne
pouvons douter qu’une langue aiifii poétique n’aic
été pourvue dé cet art qui fe trouvé même chez
les iàuvages. On foupçonne avec beaücoup de
raifon , que les cantiques de Moïfe & de David ,
& même qu’une partie du livré de Job , contiennent
une véritable verfification ; quelques-uns ont
cru y trouver, une cadence réglée , & même la
Rime : mais là-deffus nous avons moins des découvertes
que des iilufions. Cette Poéfie &. fes repies
ne nous font point .connues ; l ’on ignoré tout à
fait fi elie fe règloit par la Quantité ou par le
nombre de fyilabes.^.. & les juifs mêmes ont totalement
perdu les principes de leurs anciens poètes.
C ’eft .pour y fuppléer. qu’ils fe font fait un nouvel
art poédque , avec lequel iis ont quelquefois ver-
fifié en langue fàinte , en adoptant la Quantité des
grecs- & dès.'latins, à iâquellë ils n’ont pas oublié
d’ajouter' la Rime , fille dé cès .allufions fi. fréquentes
dans leur Profe. C ’étoit un agrément qui
leur étoit trop naturel pour qu’ils ayent pu s en
palier : ils la nomment ch a r ù f, c’ eft à dire , collier
de perles ; & i l réfuite de cette alliance -de la
Rinïe avec la Quantité, que. leur Poéfie r.effemble
à celle de nos anciennes' hymnes, ■ aui_ont de même
adopté l ’une & l ’autre.
Comme i l nous .eft arrive plufiéurs fois dans
cet article de parler de' l a J p luralité des fens donc
" font, fufeeptiblés la plupart dès mots die la Langue
hébraïque ,, foit -par eux - mêmes foit par l ’incertitude
où l ’on eft quelquefois de leur racine , nous
croyons devoir ajouter ici quelques remarques à ce
fujel , pour que qui que ce foit né s’induife en erreur
d’après-, ce que nous avons dit en littérateur & en
fiinple grammairien. On né doit pas s’imaginer à
l ’afpeèfc de ces difficultés, ou que la Bible n’a jamais
été 'bien' traduite, ou qu’elle pourroit être méta-
morphofée en toute autre chofe. Nous repréfen-
terons d’abord qu’i l n’en eft pas des anciens traducteurs
comme d’un traducteur moderne , auquel
; on demanderoit une verfion de la Bible , fans lu i
permettre d’autres feeours que ceux d’une grammaire
& d’ un dictionnaire hébreux car en fuppofant que
(1) ïambe, fpondée, bacchique, crétois, niolofle.