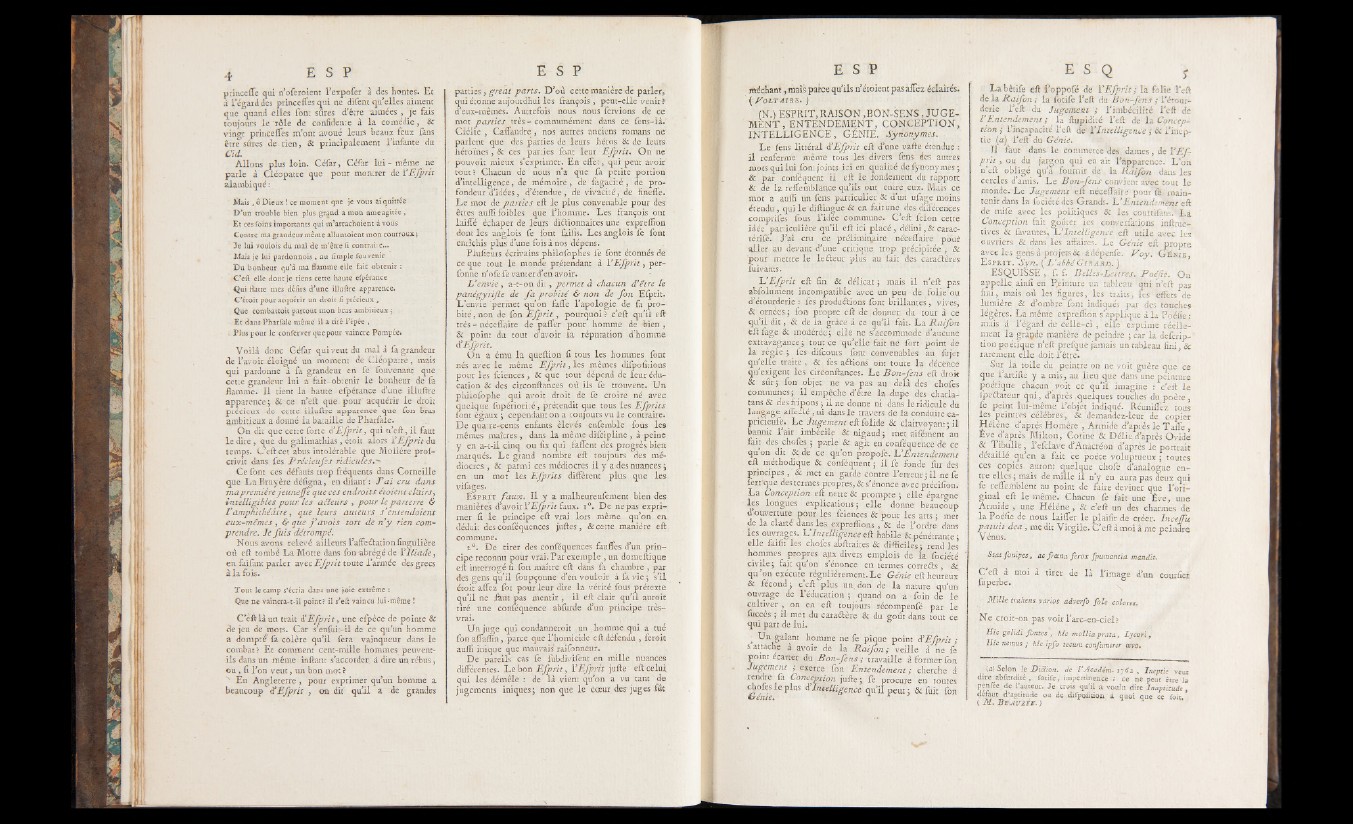
princeffe qui n’oferoient l ’expofer à des liontes. Et
a l ’égard des prince ffes qui ne difent q u e lle s aiment
que quand elles font sures d’être aimées , je fais
toujours le rôle de confidente à la comédie, &
vingt princefles m’ont avoué leurs beaux feux fans
être sures de- rien, & principalement l ’infante du
Cid.
A llon s plus loin. Cé far, Céfar lui - même ne
parle à Cléopâtre que pour montrer de YEfprtt
alambiqué :
Mais , ô Dieux ! ce moment que je vous ai quittée
D ’ un trouble bien plus grand a mon ame agitée ,
Et ces foins importants qui m’arrachoient à vous
Contre ma grandeur même allumoient mon courroux ;
3 e lui voulois du mal de m’être fi contraire...
Mais je lui pardonnois , au /impie fouvemr
Du bonheur qu’à ma flamme elle fait obtenir :
C ’eft elle dont" je tiens cette haute efpérance
Qui flatte mes défirs d’ une illuftre apparence.
C ’étoit pôur acquérir un droit fi précieux ,
Que combattoit partout mon bras ambitieux ;
Et dans Pharfale même il a taré l’épée ,
. Plus pour le conferver quepour vaincre Pompée.
V o ilà donc Géfar qui veut du mal à fa grandeur
de l’avoir-éloigné un moment de C léopâ tre, mais
qui pardonne à fa grandeur en fe Touvenant que
cette grandeur lu i a fait obtenir le bonheur de fa
flamme. I l tient la haute efpérance d’une illuftre
apparence ; & ce n’eft que pour acquérir le droit
précieux de cette illuftre apparence que fon bras
ambitieux a donné la bataille de Pharfale.
O n dit que cette forte S E fp r it , qui n’eft , i l faut
le dire, que du gàlimathias, étoit alors Y E fp r it du
temps. C eft cet abus intolérable que Molière prof-
crivit dans fes Précieufes ridicules
Ce font ces défauts trop fréquents dans Corneille
que L a Bruyère défigna, en difant': T a i cru dans
ma première jeunejfe queces endroits étoient clairs,
intelligibles pour les acteurs , pour le parterre &
Vamphithéâtre, que leurs auteurs s ’ entendoient
eux-mêmes, & que j ’ avois tort de n’y rien comprendre.
Je f u i s détrompé.
Nous avons relevé ailleurs l ’affeélation fîngulière
oii eft tombé L a M otte dans fon-abrégé de l ’I lia d e ,
en faifant parler avec E fp r it toute l ’armée des grecs
à la fois.
Tou t le camp s’écria dans une joie extrême :
Que ne vaincra-t-il point? il sr*eft vaincu lui-même !
C ’eft là un trait S E fp r i t , une efpèce de pointe &
de jeu de mots. Car s’enfuit-il de ce qu’un homme
a dompté fà colère qu’i l fera vainqueur dans le
combat? Et comment cent-mille hommes peuvent-
ils dans un même inftant s’accorder à dire un rébus,
ou | fi l ’on veu t, un bon mot ?
x En A n g leterre, pour exprimer qu’un homme a
beaucoup $ E fp r it , on dit qu’i l a de grandes
parties, great p arts. D ’où cette manière de parler,
qui étonne aujourdhui les françois , peut-elle venir?
ci eux-mêmes. Autrefois nous nous fervions de ce
mot parties très - communément dans ce fens-là.
C lé lie , Caffandre , nos autres anciens romans ne
parlent que des parties de leurs héros & de leurs
héroïnes, & ces parties font leur Efp r it. O n ne
pouvoit mieux s’ exprimer. En effet , qui peut avoir
tout? Chacun de nous n’a que fa petite portion
d’intelligence, de mémoire, de fagacité , de profondeur
d’idées, d’étendue , de vivacité, de finefie.
L e mot de parties e.ft le plus convenable pour des
êtres auffi foibles que l ’homme. Les françois ont
laiffé échaper de leurs dictionnaires une exprelïïon
dont les anglois fe font faifis. Les anglois fe font
enrichis plus d’une fois à nos dépens.
Plufieurs écrivains philofophes fe font étonnés de
ce que tout le monde prétendant à V E fp r i t , per-
fonne n’ofèfe vanter d’en avoir.
L ’ envie , a-t-on d i t , permet à chacun d’ être le
panégyrijle de f a probité & non de fo n Efprit.
L ’envie permet qu’on fafle l ’apologie de fa probité,
non de fon E fp r i t , pourquoi? c’eft qu’i i eft
très - néceffaire de paffer pour homme de bien ,
& point du tout d’avoir la réputation d’homme
d’Efprit.
O n a ému la queftion fi tous les hommes font
nés avec le même E fp r it , les mêmes difpoficions
pour les fciences, & que tout dépend de leur éducation
& des circonftances où ils fe trouvent. Un
philofophe qui avoit droit de fe croirè né avec
quelque fupériorité, prétendit que tous les E fp r its
font égaux ; cependant on a toujours vu le contraire.
De quatre-cents enfants élevés enfemble fous les
mêmes maîtres, dans la même difcipline , à peine
y en a-t-il cinq ou fix qui faflent des progrès bien
marqués. L e grand nombre eft toujours des médiocres
, & parmi ces médiocres i l y a des nuances ;
en un mot les E fp r its diffèrent plus que les
vifages. £
Esprit fa u x . I l y a malheureufement bien des
manières d’avoir Y E fp r it faux. i ° . De ne pas exprimer
fi le principe eft vrai lors même qu’on en
déduit des conféquences juftes, & cette manière eft
commune.
z°. D e tirer des conféquences faunes d’un principe
reconnu pour vrai. Par exemple , un domeftique
eft interrogé fi fon maître eft dans fa chambre , par
des gens qu’i l foupçonne d’en vouloir à fa vie ; s’i l
étoit affez fot pour leur dire la vérité fous prétexte
qu’i l ne ;&ut pas mentir , i l eft clair qu’ i l auroit
tiré une conléquence abfurde d’un principe très-
vrai.
U n juge qui condanneroit un homme qui a tué
fon aflamn, parce que l ’homicide eft défendu , ferôic
auffi inique que mauvais raifonneur.
D e pareils cas fe fubdivifent en mille nuances
différentes. L e b o n E fp r it , l ’E fp r it jufte eft celui
qui les démêle : de là .vient qu’ on a vu tant de
jugements iniques ; non que le coeur des-juges fût
méchant, mais parce qu’ils n’étoient pas affez éclairés.
( V oltaire. ) "<:■
(N.) E S P R IT , R A I S O N ,B O N -S E N S , J U G E M
E N T , E N T E N D EM E N T , C O N C E P T IO N ,
IN T E L L IG E N C E , G ÉN IE . Synonymes.
L e fens littéral à’Efp r it eft d’une vafte étendue :
i l renferme même tous les divers fens des autres
mots qui lui font joints ic i en qualité de fynonymes ;
& par conféquent i i eft le fondement du rapport
& de la rèffemblance qu’ ils ont entre.eux. Mais ce
mot a aulli un fens particulier & d’un ufage moins
étendu, qui le diftingue & en fait une des différences
eomprifes fous l ’idée commune. C ’eft félon cette
idée particulière qu’i l eft ici p la c é , défini, & carac-
térifé. J’ai cru ce préliminaire néceffaire pouf
a lle r au devant d’une critique trop précipitée , &
pour mettre le leéteur plus au fait des caractères
l'uivârits.
L ’E fp r it eft fin & délicat ; mais i l n’ eft pas
abfolument incompatible avec un peu de folié ' ou
d’étourderie : fes productions font brillantes, vives,
& ornées j fon propre eft de donner, du tour à ce
qu’i l d i t , & de la grâce à ce qu’i l fait. L a R a ifo n
eft fàge & modérée j elle ne s accommode d’aucune
extravagance ; tout ce qu’elle fait ne fort point de
la règle ; fes difcours font convenables au fujet
qu’elle traite , & fes aérions ont toute la décence
qu’exigent les circonftances. L e B on -fen s eft droit
& sûr j fon objet ne va pas au delà des chofes
communes y i l empêche d’ être la dupe des charlatans
& des fripons ; i l ne donne ni dans leridieule du
langage affcété , ni dans le travers de la conduite ea-
pricieufe.. L e Jugement eft folide & clairvoyant ; i l
bannit l ’air imbécile & nigaud; met aifément au
fait des chofes ; parle & agit en .conféquence de ce
qu on dit & de ce quon propofe. lu Entendement
eft méthodique & conféquent ; i l fe fonde fur des
principes , & met en garde contre l ’erreur; i l ne fe
lert'que des termes propres, & s’énonce avecprécifion.
L a Conception, eft nette & prompte ; e lle épargne
l p longues explications ; e lle donne beaucoup
d’ouverture pour les fciences & pour les arts ; met
de la clarté dans les expreffions , & de l ’ordre dans
les ouvrages. U Intelligence eft habile & pénétrante ;
e lle faifit les chofes abftraites & difficiles; rend les
hommes propres ajix divers emplois de la fociété
civile ; fait qu’on s’énonce en termes correfts, &
q u ’on exécute régulièrement.Le Génie eft heureux
& fécond: c eft plus un, don de la nature qu’un
ouvrage de l ’éducation ; quand on a foin de le
cultiver , on en eft toujours récompenfé par le
fiicces ; i l met du caractère & du goût dans tout ce
qui part de lui.
, U n galant homme ne fe pique point S Efp r it y
s attache a avoir de la R a ijo n y v eille à ne fè
point ecarter du B o n -fen s y travaille à former fon
Jugement y exerce fon Entendement y cherche à
rendre fa Conception jufte ; fe procure en toutes
g ^ l e p l u s à Intelligence qu’i l p eu t; & fuit fon
L a bêtife eft f ’oppofé de Y E fp r it y là folie l ’eft
d e là R a i f o n la îbtife l ’eft du B o n -fe n s y l ’étourderie
l ’eft du Jugement y l ’ imbécilité l ’cft de
l ’ Entendement y la ftupidité l ’eft de la Conception
y l ’incapacité l ’ eft de Y Intelligence y & l ’ineptie
(a) l ’eft du Génie.
I l faut dans le Commerce des daines, de l ’E f p
r i t , ou du jargon qui en ait Tâpparence. L ’on
n’eft obligé qu’a fournir de la R a ifon dans les
cercles d’amis. L e B o n -fe n s convient avec tout le
monde. L e Jugement eft néceffaire pour fe maintenir
dans la fociété des Grands. L ’Entendement eft
de mife avec les politiques & les courtifans. L a
Conception fait goûter les converfàrions inftruc-
tivés & favantes. L ’Intelligence eft utile avec les
ouvriers & dans les affaires. L e Génie eft propre
avec les gens à prôjets& àdépenfe. V o y . G é n ie ,
E s p r it . Syn. ( L'abbé G iraud ,. ).
E S Q U IS S E , f. f. Be lles-Lettre s. Poé fie . On
appelle ainfî en P.einture un tableau "'qui n’eft pas
fini, mais où les figures, les traits, les effets de
lumière & d’ombre font indiqués par des touches
légères. L a même expreffion s’applique a la Poéfie :
mais à l ’égard de ce lle -c i , e lle exprime réellement
la graçde manière de peindre ; car la defcrip-
tion poétique n’eft prefque jamais un tableau fini, &
rarement e lle doit l ’être.
Sur la toile du peintre on ne voit guère que ce
que l ’artifte y a mis, au lieu que dans une peinture
poétique chacun voit cé qu’i l imagine : c’eft l e
ipeélateur q u i, d’après .quelques touches du poète ,
fe peint lui-même l ’objet indiqué. Réunifiez tous
les peintres célèbres, & demande z-leur de copier
Héiène d’après Homère , Armide d’après le Taffe ,
Eve d’après M ilton, Corine & Délie.d’après Ovide
& Tibuli'e, l ’efclave d’Anacréon d’après le portrait
détaillé qu’en a fait ce poète voluptueux ; toutes
ces copies, auront quelque chofë d’analogue entre
elles ; mais de mille i i n’y en aura pas deux qui
fe reffemblent au point de faire deviner que l ’original
eft le même. Chacun fè fait une Êve, une
Armidë , une Hélène , & c’eft un des charmes de
la Poéfie de nous laiffer le plaifir de créer. Inceffu
p a tu it d eà , me dit V irg ile . C ’eft à moi à me peindre
Vénus.
StatfonipeSj ac frctna ferox fpumantia mandit.
C eft a moi a tirer de là l ’image d’un couriier
fuperbe.
Mille trahens varios adverfo foie colores.
N e croit-on pas voir l ’arc-en-ciel?
Rtc gelidi fontes , hic mollia prata, Lycori,
Rie nemus y hic ipfo tecuir. confumerer oevo.
(a) Selon le Diction, de l ’Académ. 1762 , Ineptie veut
dire abfurdité , fotifey impertinence : ce ne peur être la
penfée de l’auteur. Je crois qu’il a voulu dire Inaptitude ,
défaut- d’aptitude ou de difpofîtion ■ à quoi que ce foie
( M. B eavzée. ) ^