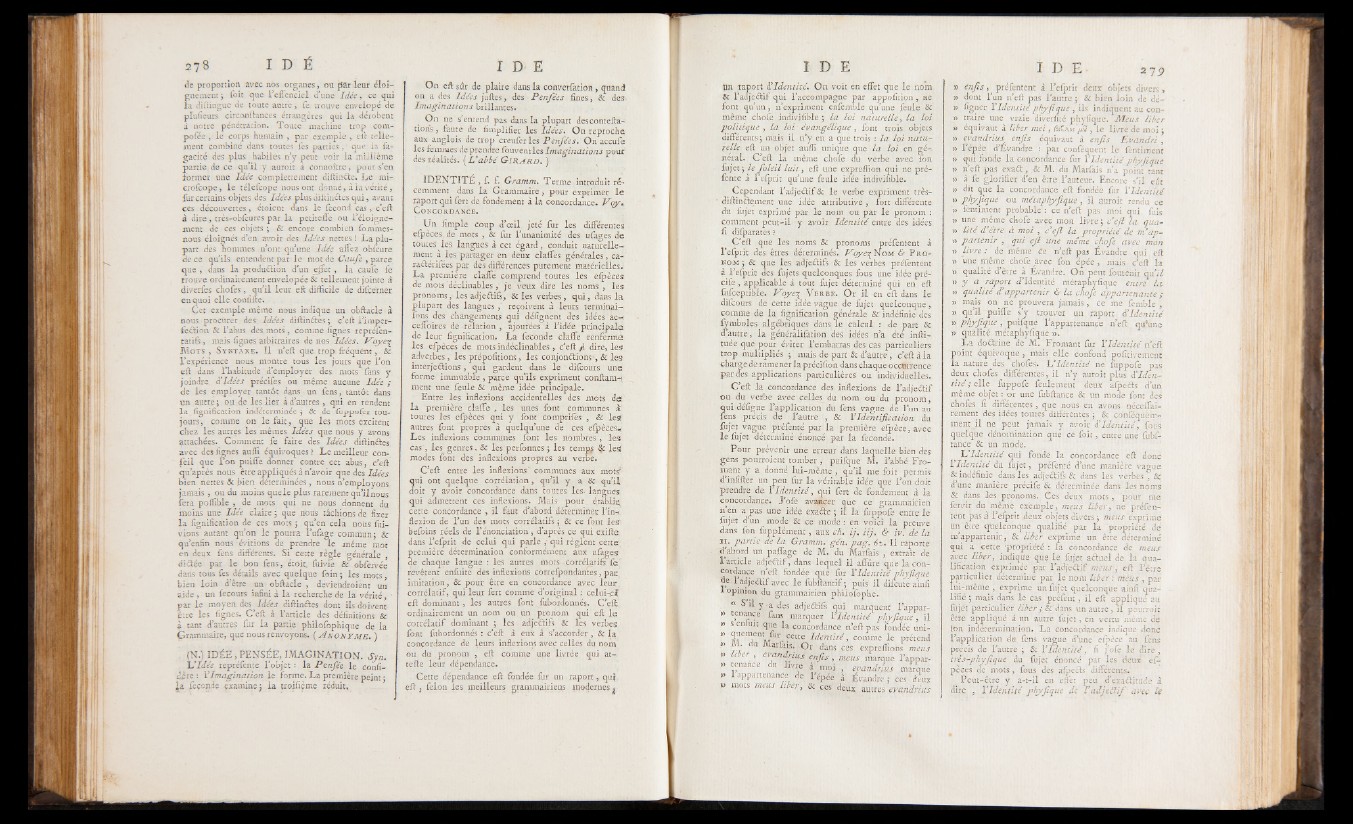
de proportion avec nos organes, ou par leur éloignement
; foit que l ’effenciel d’une Id é e , ce qui
la diftingue de toute autre, fe trouve envelopé de
plulieurs circonffances étrangères qui la dérobent
à notre pénétration. Toute machine trop com-
p o fé e , le corps humain , par exemple , eft tellement
combiné dans toutes fes parties, 1 que la fugacité
des plus habiles n’y peut voir la millième
partie, de ce qu i l y auroit à connoître, pour s’en
former une Idée complètement cliftincte. L e mi-
crofcope, le télefcope nous ont donné, à la v érité,
fur certains objets des Idées plus diftinéles q u i, avant
ces découvertes, étoient dans le fécond ca s, c’eft
à dire, très-obfcures par la petiteffe ou l ’éloignement
de ces objets ; & encore combien fommes-
nous éloignés d’en avoir des Idées nettes ! L a p lupart
des nommes n’ont qu’une Idée allez obfcure
de ce qu’ils entendent par le mot de Caufe , parce
que , dans la production d’un effet , la caufe fe
trouve ordinairement ehvelopée & tellement jointe à
diverfes chofes, qu’i l leur eft difficile de difcérner
en quoi elle confifte.
Ce t exemple même nous indique un obftacle à
nous procurer des. Idées diftinCles ; c’eft l ’imper-
fedtion & l ’abus des.mots, comme lignes repréfen-
tatifs, mais lignes arbitraires de nos Idées. V o y e£
Mots , Syntaxe. I l n’eft que trop, fréquent, 8c
l ’expérience nous montre tous les jours que l ’on
eft dans l ’habitude d’employer des, mots fans y
joindre &Idées précifes ou même aucune Idée ;
de les employer tantôt dans un fens, tantôt dans
un autre ; ou de les lier à d’autres , qui en rendent
la lignification indéterminée ; 8c de fuppofer toujours,
comme on le fa it , que les mots excitent
chez les autres les mêmes Idées que nous y avons
attachées. Comment fe faire des Idées diftinétes
avec des lignes aulfi équivoques ? L e meilleur con-
fe il que io n puiffe donner contre cet abus, c’ eft
qu’après nous être appliqués a n’avoir que des Idées
bien nettes & bien déterminées, nous n’employons
jamais , ou du moins que le plus rarement qu’i l nous
fera poflible , de mots qui ne nous donnent du
moins une Idée claire ; que nous tâchions de fixer
la lignification de ces mots ; qu’en cela nous fui—
vions autant qu’on le pourra l ’ ulage commun j &
qu’enfin nous évitions de prendre le même mot
en deux fens différents. Si cette règle générale ,
diétée par le bon fens, étoit. luivie & obfervée
dans tous fes détails avec quelque foin ; les mots
bien lo in d’être un obftacle , deviendroient un
aide , un fecours infini à la recherche de la vérité, •
par le moyen des Idées diftinétes dont ils doivent
être les lignes. C ’eft à l’article des définitions &
à tant d’autres fur la partie philofophique de la
Grammaire, que nous renvoyons. ( A n o n ym e . )
(N.) ID É E , P EN SÉ E , IM A G IN A T IO N . Syn.
XJÏdée repréfente l ’objet : la Pen fé e le confî- 4ère : Y Imagination le forme. L a première peint •
fa fécondé examine ; la troifiçme réduit.
On eft sur de plaire dans la converlatioh, quand
on a des Idées juftes , des P en fé e s fines , & des
Imaginations brillantes. •
On ne s'entend pas dans la plupart descontefta-
tions, faute de Amplifier les Idées. On reproche
aux anglois de trop creufer les P enfées . On accufe
les femmes de prendre louventles Imaginations pour
des réalités. ( L ’ abbé G i r a r d . )
IDENTITÉ , f. f. Gramm. Terme introduit récemment
dans la Grammaire, pour exprimer le
raport qui fert de fondement à la concordance. VoyK
C oncordance.
Un limple coup d’oeil jeté fur les différentes
elpèces. de mots , & fur l’unanimité des ufages de
toutes les langues à cet égard, conduit naturellement
a les partager en deux claffes générales, ca-
raétérifées par des différences purement matérielles.
La première claffe comprend toutes les elpèces
de mots déclinables, je veux dire les noms , les
pronoms,- les adjeétifs, 8c les verbes, qui, dans la
plupart des langues ,' reçoivent à leurs terminai-*
Ions des changements qui défignent des idées ac-<
cefloires de relation , ajoutées â l ’idée principale
de leur lignification. La fécondé claffe renferme
les elpèces de mots indéclinables , c’eft $\ dire, les
adverbes, les prépofitions, les conjonctions-, & les
interjetions, qui gardent dans le ■ dilcours une
forme immuable , parce qu’ils expriment conftam-^
ment une feule & même idée principale.
Entre les inflexions accidentelles des mots de
la première claffe , les unes font communes a
toutes les elpèces qui y font eomprifes , 8c les?
autres font propres à quelqu’une de ces elpèces.*
Les inflexions communes font les nombres , les
cas , les genres, & les perfonnes ; les temps §c les?
modes font des inflexions propres au verbe.
C’eft entre les inflexions' communes aux mots'
qui ont quelque corrélation, q u il y a & qu’i l
doit y avoir concordance dans toutes les- langues
qui admettent ces inflexions. Mais pour établie
cette concordance , il faut d’abord déterminer l ’in-<
flexion de l ’un des mots corrélatifs ; & ce font les
beloins réels de l ’énonciation, d’après ce qui exifte
dans l ’efprit de celui qui parle qui règlent cette
première détermination conformément aux ufages
de chaque langue : les autres mots-corrélatifs fe
revêtent enfuite des inflexions correfpondantes, pair
imitation, & pour être en concordance avec leur,
corrélatif, qui leur fert comme d’original : celui-ci'
eft dominant, les autres font. fubordonnés. C’eft'
ordinairement un nom ou un pronom qui eft le
corrélatif dominant ; les adjeétifs 8c les verbes
font fubordonnés : c’eft à eux â s’accorder , 8c la
concordance de leurs inflexions avec celles du nom
ou du pronom , eft comme une livrée qui at-,
tefte leur dépendance.
Cette dépendance eft fondée fur un raport, qui
eft ; félon les meilleurs grammairiens modernes •
îm raport d5Identité. O n voit en effet que le nom
8c l ’adjcétif qui l ’accompagne par appofition , ne
font qu’u n , n’expriment enfemble qu’une feule 8c
même chofe indivisible ; la loi naturelle, la loi
politique , la loi évangélique ,, font trois objets
différents ; mais i l n’y en a que trois : la loi naturelle
eft un objet auffi unique que la loi en gé-/
neral. G’eft la même chofe du verbe avec fon
fu jet ^le fo le i l lu i t , eft une expreflion qui ne préfente
a l ’efprit qu’une feule idée indivifible.
Cependant l ’adjeétif8c le verbe expriment très-
diftinétement une idée attributive , fort différente
du fujet exprimé par le nom ou par le pronom :
comment peu t-il y avoir Iden tité entre des idées
fi difparates ?
C ’eft que les noms 8c pronoms préfentent à
l ’efprit des êtres déterminés, V o y e fH oM & P ro-
n o m ; 8c que les adjeétifs 8c les verbes préfentent
à Tefprit des fujets quelconques fous une idée pré-
c i fe , applicable à tout fujet déterminé qui en eft
fiifceptible. V oy e \ V erb e. O r i l en eft dans le
difcours de cette idée vague de fujet quelconque,
comme de la lignification générale 8c indéfinie des
fymboles algébriques dans l e calcul : de part 8c
d’autre, la généralifation des idées n’a été infti-
tuée que pour éviter l ’embarras des cas particuliers
trop multipliés ; mais de part 8c d’autre , c’eft à la
charge de ramener laprécifîon dans chaque occurrence
par des applications particulière^ ou individuelles.
C eft la concordance des inflexions de l ’adjeétif
ou du verbe avec celles^ du nom ou du pronom,
qui défigne l ’application du fens vague de l ’un au
fens précis de l ’autre , 8c l ’Identification du
fujet vague préfenté par la première efpèce, avec
le fujet déterminé énoncé par la fécondé.
Pour prévenir uné erreur dans laque lle bien des
gens pourroient tomber , puifque M. l ’abbé Fro-
mant y a donne lui-même , qu’i l me foit permis
d infifter un peu fur la véritable idée que l ’on doit
prendre de. 1 Id e n tité , qui fert de fondement à la
concordance. J’ofe avancer que ce grammairien
11 a }Pas une idée exaiSe ; i l la fuppofe entre le
fujet d’un mode 8c ce mode : en voici la preuve
dans fon fupplément , aux ch. i j . i i j . & iv. d e là
11. partie de la Gramm. gén. pag. 6z. I l raporte
d’abord un paffage de M. du Marfais , extrait de
1 article adjèétif, dans lequel i l affiire que- la concordance
n’eft fondée que fur l ’ Identité phyfique
de l ’adje&if avec le fubftantif ; puis i l difcute ainfi
1 opinion du grammairien phiiofophe.
« S i l y -a des adjeétifs qui marquent l ’appar-
» tenance fans marquer Y Identité phyfique , i l
» s enluit que la, concordance n’ eft pas fondée uni-
* T-ieiTJent fur cette Id e n tité , comme le prétend
» M. du Marfais. O r dans ces expreffions meus
» liber^ , evandrius ehfis , meus marque l ’appar-
» tenance du livre à moi , evandrius marque
» 1 appartenance de l ’épée à Évandre ; ces deux
» mots meus liber, 8c eés deux; autres evandrius
» enfis. j préfentent à l ’efprit deux objets divers >
» dont l ’un n’ eft pas l ’autre ; 8c bien loin de dé-
» ligner Y Identité phyfique , ils indiquent au con-
» traire une vraie divermé phyfique. M eu s liber
» équivaut a liber m e i, /3iC\o« /Yé, le livre de moi j
» evandrius enfis équivaut à enfis E van d r i ,
» l ’épée d’Évandre : par conféquent le féntiment
» qui fonde la concordance fur Y Identité phyfique
» n’eft pas e x a é l, 8c M. du Marfais n’a point tant
»? à fe glorifier d’en être l ’auteur. Encore s’i l eut
y dit que la concordance eft fondée fur l ’Identité
» phyfique ou métaphyfique, i l auroit rendu ce
» fentiment probable : ce n’eft pas moi qui fuis
» une même chofe avec mon livre ; c’ e fl la qua-
» Il té d’ être à m o i , c e f i la propriété de m’ap -
» partenir , qui eft une même chofe avec mon
» livre : de même ce n’eft pas Évandre qui eft
» une même chofe avec fon ép é e , mais c’ eft la
» qualité d’être à Évandre. O n peut foutenir qu’//
n y a raport Identité métaphyfique entré la
» q ualité d ’appartenir & la chofe appartenante ;
» mais on ne prouvera jamais , ce me femble
» qu’i l puiffe s’y trouver un raport d’Identité
» phyfique , puifque l ’appartenance n’eft qifune
» qualité métaphyfique ».
L a doétiine de M. Fromant fur Y Identité n’ eft
point équivoque , mais e lle confond pofitivement
la nature des chofes. U Identité ne fuppofe pas
deux chofës différentes, i l n’y auroit plus d’Identité
; e lle fuppofe feulement deux afpects d’un
même objet : or une fubftance 8c un mode font des
chofes fi différentes, que nous en avons néceffai-
rement des idées toutes différentes ; Sc conféquem-
ment i l ne peut jamais y avoir d’Id en tité , fous
quelque dénomination que ce fo i t , entre une fubftance
8c un mode.
U Identité qui fonde la concordance eft donc
Y Identité du fujet-, préfenté d’une manière vague
•8c indéfinie dans les adjeétifs 8c dans les verbes, 8c
d une manière précife 8c déterminée dans les noms
8c dans les pronoms,; Ces deux mots , pour me
fervir du même exèmple, meus liber, ne préfentent
pas a l ’efprit ,deux objets divers ; meus exprime
un être quelconque qualifié par la propriété dé
m’appartenir, 8c liber exprime un être déterminé
qui a cette propriété : la concordance de meus
avec liber> indique que le fujet a&uel de la qualification
exprimée par Tadjeétif meus , eft l ’être
particulier déterminé par le nom liber : meus , par
lui-même , exprime un fujet quelconque ainfi qualifié
; mais dans le cas préfent, i l eft appliqué au
fujet particulier liber ; 8c dans un autre, i l pourroit
être appliqué à un autre fu je t , eh vertu même de
Ion indétermination. L a concordance indique donc
l ’application du fens vague d’une efpèce au fens
précis de l ’autre ; 8c Y id e n t it é , fi j’ofe le d ire ,
très-phyfique du fujet énoncé par les deux efpèces
de mo ts, fous des afpects différents.
Peut-être y a-t-il en effet peu d5exactitude a
dire , . Y Identité phyfique de l ’ a d je c t i f avec le